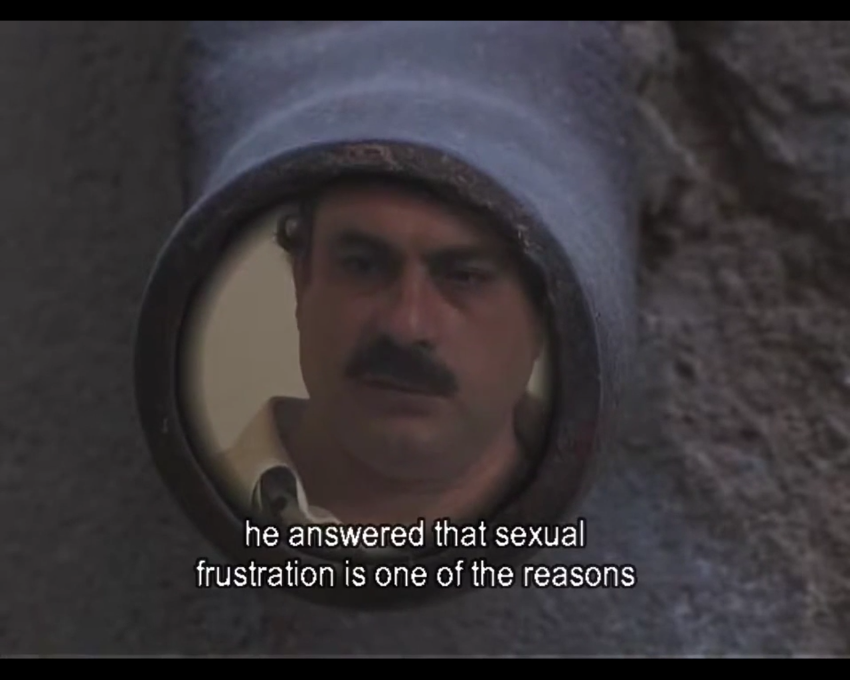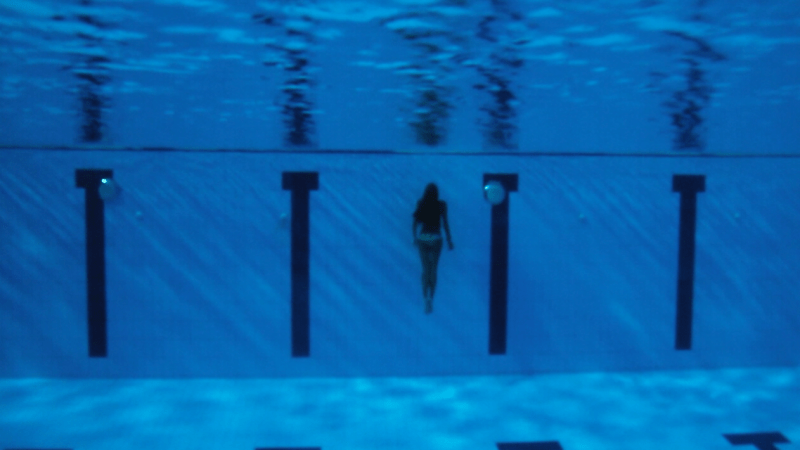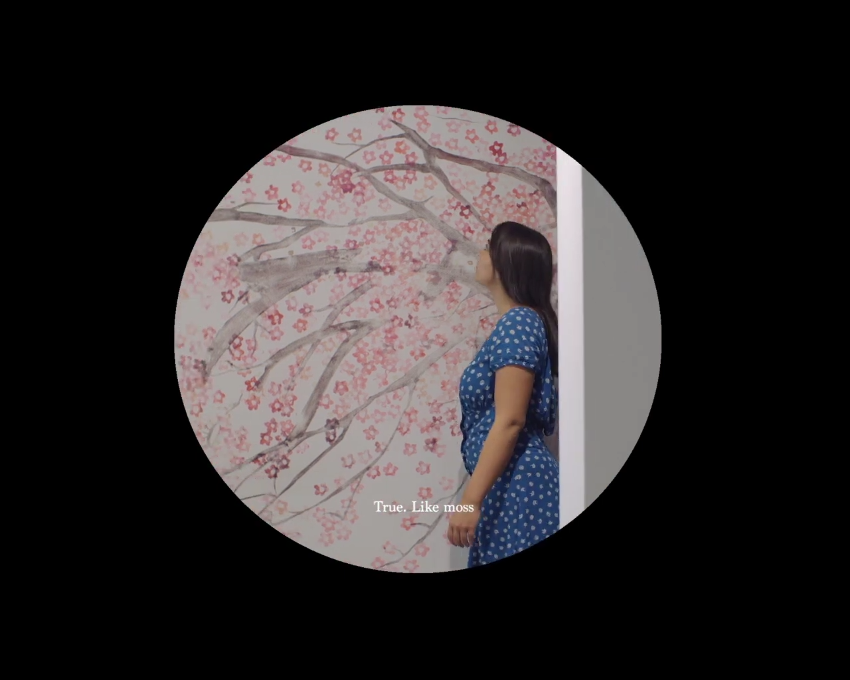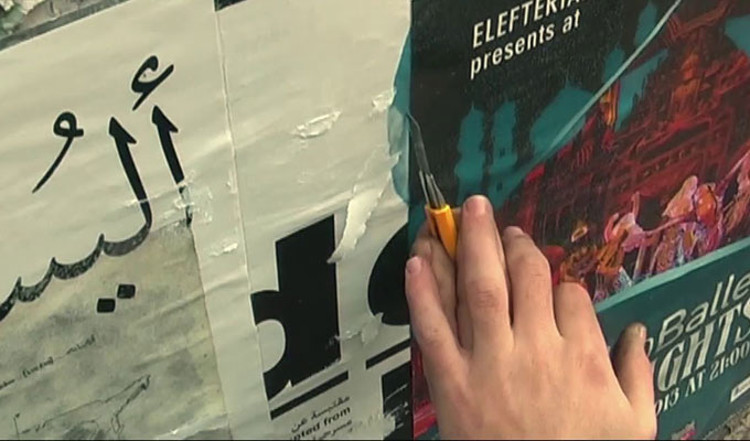INTERVENANT :
Lieu
L'Ancri'er, Florac Voir sur la carteBienvenue au pays du miel et de l’encens, bien que ce souvenir y ait été remplacé trop souvent par le mélange tragique de la poudre et du sang. Mais le miel, collant, tenace, mélancolique pour faire écho au titre du livre de Dima El-Horr, joue encore son rôle d’attraction et sert à maintenir ensemble ce qui reste d’un pays meurtri, plus particulièrement depuis la guerre civile de 1975 à 1990, puis au gré des différentes occupations jusqu’à la récente explosion du port de Beyrouth dont la perte a ébranlé toute une population. Des séquences destructrices qui ne doivent pas faire oublier non plus la situation économique et sociale catastrophique que connaissent les libanais depuis trop longtemps et qui impacte leur quotidien. Autant d’images que de drames, d’histoires que de destins dans ce pays plus friand de recherches audiovisuelles que de productions commerciales, en tout cas du côté des créateurs plutôt que des simples spectateurs. « L’art de construire en ruines » écrivait à une époque Raphaël Millet, s’attaquant à la mélancolie des cinématographies méditerranéennes. Ou plutôt l’art de reconstruire morceau par morceau, comme l’ont si bien prouvé les trois dernières décades de productions indépendantes libanaises.
L’histoire du cinéma dépend ici plus qu’ailleurs des soubresauts historiques. Ancienne province syrienne multi-ethnique et multi confessionnelle, le Liban en tant qu’état est une création artificielle sous mandat français. Quoiqu’ayant systématiquement soutenu les chrétiens maronites depuis le 19ème siècle, les français ont tenu à ce que la constitution du pays respecta l’esprit démocratique, introduisant notamment une répartition des postes clés du pouvoir sur un modèle français (une seule chambre néanmoins), mais selon l’appartenance religieuse aux principales communautés. Aux Chrétiens, la présidence, aux Sunnites l’exécutif et enfin aux Chi’ites la présidence de la chambre. Aux autres – on recense au Liban pas moins de 18 communautés -, des responsabilités de chefs de clan, à commencer par l’importante communauté druze qui aimerait bien abolir ce système pour une meilleure représentativité de tous les libanais (et bien qu’il leur garantisse 8 sièges à la dite assemblée).
À cause de la beauté de ses paysages, de son littoral, de sa lumière et de sa capitale agitée, le pays a toujours trimballé l’impression d’une douceur de vivre largement entretenue par les occidentaux qui y projetèrent leurs helvètes fantasmes et y injectèrent beaucoup d’argent. Mais le Liban était aussi un pays de commerçants prospères, son port un pôle d’attraction pour tout le Proche-Orient et son régime moins autoritaire permettait aux dissidents des pays voisins de s’y réfugier, d’où ce proverbe entendu notamment chez Bagdadi : « Chaque arabe a deux maisons, une chez lui, une au Liban » ! De nombreux conflits ont émaillé sur son sol l’histoire libanaise, dissipant alors l’illusion française. Mais c’est surtout après la création de l’état d’Israël et la Naqba des palestiniens de 1948 que la région devient définitivement instable, le Liban accueillant plus que ses voisins jordaniens, syriens ou irakiens, un grand nombre de réfugiés qui vinrent grossir les bidonvilles créés par l’exode rural et les vagues migratoires précédentes.
Car ce masque de pays modèle cachait aussi aux pays étrangers la misère d’une société à deux vitesses, avec une population libanaise largement sous le seuil de pauvreté quand les richesses circulaient entre les mains d’élites réparties dans toutes les communautés. Un mélange fortune-pouvoir tout à fait égal aux pays arabes voisins avec des régimes et des dirigeants installés par les anglais, mais ici, cette orientation pro-occidentale maintint un temps le Liban en position d’observateur dans les conflits entre arabes et juifs.
L’histoire du cinéma libanais contient trois grandes époques : de la naissance à l’âge d’or ou l’avant. De la veille de la guerre civile à sa fin, ou le pendant. Du retour de la paix aux multiples conflits qui ont précipité comme chez nous quelques décennies plus tôt, le cinéma libanais dans la modernité. L’après.
Ces périodes un peu arbitraires doivent elles-mêmes être nuancées. Il y a une préhistoire du cinéma qui, comme chez l’encombrant voisin égyptien, doit beaucoup aux immigrés italiens, ici au service de familles chrétiennes qui, d’abord au muet puis au parlant, vont faire quelques tentatives. Le modèle égyptien devient vite la norme dans toute la région, mais à Beyrouth, les cinéastes et producteurs du Caire vont trouver de remarquables distributeurs qui régneront sur la diaspora arabe et bien sûr libanaise (Brésil…). Selon Sadoul, vers 1950, on y compte une cinquantaine de salles pour plus d’un million de tickets vendus annuellement, ce qui plaçait alors le Liban en tête des pays d’Asie mineure. Cette effervescence va entraîner la construction d’un certain nombre de studios (parmi lesquels le plus récent, Baalbeck, du nom des célèbres ruines antiques à l’honneur dans le cinéma des premiers temps, mais aussi dans toutes les productions internationales à la recherche d’exotisme, puis dans les films d’action locaux) qui à l’âge d’or du nassérisme et de la nationalisation du cinéma égyptien, voient débarquer des cinéastes en recherche de meilleures conditions fiscales ou d’une plus grande liberté de travail. Le Liban devient alors synonyme de facilité pour la fabrication de séries B égyptiennes (des comédies chantées comme par exemple Zamane ya hob avec le grand Farid el Attrache, d’ailleurs décédé à Beyrouth en 1974), des mélodrames, comédies ou films d’action, mais aussi pour de nombreux producteurs occidentaux (par exemple Lautner y tourne sa Grande sauterelle avec Mireille Darc et Michel Constantin).
La fille du bédouin
Dans leur sillage, on va trouver des productions plus franchement libanaises (on dénombre 24 films « libanais » réalisés entre 1953 et 1962), bien que toujours coupées des réalités sociales et politiques du pays. Bien qu’elles prennent des libertés avec l’histoire (l’occupation ottomane dans Safar Barlek d’Henri Barakat), les trois films tournés par l’immense star libanaise de la chanson, Feyrouz, tournées par les deux plus grands cinéastes égyptiens (Youssef Chahine et Henri Barakat), relèvent plutôt de productions libanaises. Assy Rahbani, époux de la star du monde arabe, est en effet considéré avec son frère Mansour comme le père de la musique libanaise moderne. Après des débuts radiophoniques, les frères Rahbani fondent le théâtre musical libanais pour lequel ils écriront une bonne trentaine de pièces. Leur collaboration avec Feyrouz sera exclusive pendant près de 25 ans. Ils sont ici scénaristes et paroliers de la trilogie de Feyrouz. Mais dans un esprit 100 % arabe, elles dépassent largement les clivages nationaux et celui des langues, ces différents dialectes qui compliquent la donne pour l’exportation des films (égyptien, bédouin, syrien, arabe des émirats ou maghrébin, sans parler de quelques tentatives parlées en arabe littéraire, vite vouées à l’échec).
La voix triste de Feyrouz emmène le spectateur dans un espace purement poétique et même mythologique, que Dima El-Horr nomme « village utopique ». Joyau du cinéma mondial, Le vendeur de bagues (1965) est un film de la maturité pour un cinéaste mondialement reconnu depuis Gare centrale sept ans plus tôt. Rivalisant avec les plus beaux films indiens, élaborant une sorte d’expressionnisme mizoguchien multicolore, dépliant son univers de conte en miniatures, le film égratigne pourtant de façon prémonitoire le mythe de la communauté villageoise qui vit une harmonie de façade – les deux voleurs ne sont que des trublions mais leurs actes ont néanmoins des conséquences graves – et déjà stigmatise l’« autre » en l’accusant de tous les méfaits. En dehors de quelques ébats chorégraphiques sous les pinèdes à l’esthétique bien socialiste, il dit aussi quelque chose de fondamental dans la destinée des filles et qui passe dans le regard de Feyrouz aussi bouleversant que sa voix est vertigineuse : l’esprit de sacrifice et de conciliation découle d’une bonté et d’une forme de pureté qui caractérise ses personnages et l’idéal féminin de l’époque.
Safar Barlek (1966) se situe à l’opposé, esthétiquement et même thématiquement. Il y a une certaine rigueur au niveau du récit dont la teneur pan-arabe est évidente et recoupe la production multiculturelle du film. Syriens, égyptiens et libanais se voient obligés de collaborer au début de la première guerre mondiale pour résister à l’occupant ottoman et approvisionner en blé les villages libanais pillés pour l’effort de guerre. Barakat étonne avec un grand sens du picaresque, passant de la gravité à la légèreté (les blagues sur les Vaillants, toujours prêts pour le coup de feu!) avec une grande maîtrise. Formellement, le film est aussi d’une belle tenue. Une photo du français Claude Robin (qui retravaillera dans la région avec Youssef Chahine pour Sables d’or en 1971) qui privilégie les beiges sépias et gris, où éclate le rouge de la robe d’Ada. Seules quelques belles scènes chantées emballent alors la caméra (un travelling enneigé sur la première chanson de Feyrouz où monte la complainte « l’oiseau si tu pouvais chanter ma douleur », quelques beaux mouvements sur le chœur des hommes…), autant de moments qui ont fait la réputation du film dans la région et assuré son succès à la veille de la guerre des six jours. Bref, du solide cinéma populaire historique, digne des américains (même si le coup de poing n’y a pas tout à fait la pesanteur des films de Hawks, mais ce n’est pas gênant) ou des italiens (Cottafavi), avec par ailleurs de beaux paysages libanais
Hors ces films, il faut citer Les ailes brisées, biopic du grand poète libanais du début du vingtième siècle, Khalil Gibran et son ouverture dans les superbes paysages locaux. Le film est réalisé par l’égyptien Youssef Maalouf mais sans grands éclats et en respectant les traditions du mélodrame. En règle générale, et même réalisés par des libanais, les films se tournent la plupart du temps en dialecte égyptien et ne s’intéressent jamais aux réalités locales.
Pour un cinéma national
C’est justement en cherchant à se démarquer des codes popularisés par les égyptiens que le pionnier Georges Nasser débarque à Cannes avec Vers l’inconnu (1957), salué alors par Georges Sadoul comme un film dans la mouvance néo-réaliste qui « avait, comme premier pas, une valeur. Il pouvait être le point de départ d’une nouvelle école nationale ». En effet, avec une absence de moyens et en totale indépendance, Nasser a réussi à trouver la justesse pour dépeindre la vie rurale et traiter le thème de l’exode qui a profondément affecté les campagnes libanaises. « On ne croira plus à la sagesse »… Dès son ouverture, on sent le besoin, plus que de montrer, de lire le paysage et d’y incruster les activités humaines et la dialectique littoral-montagne. Le tableau des conditions de vie n’est pas excessif, la misère est montrée de façon réaliste, bien dans la tradition italienne dont l’esthétique domine l’époque et ce, même si Nasser a été formé à la UCLA !
Dans le passionnant documentaire qui lui a été consacré, Un certain Nasser (Antoine Waked et Badih Massaad, 2017), le vénérable cinéaste se souvient avec émotion de la réaction enthousiaste de George Stevens sur son film. C’est en effet une vraie référence! Nasser y rappelle que les situations et dialogues viennent de moments vécus lors de son propre exil et de ces libanais qu’il a lui-même croisés en Amérique. Pour un premier film, le résultat est remarquable, même si de rares moments sont un peu plus juste techniquement et qu’on se perd aujourd’hui un peu parmi les relations interpersonnelles des protagonistes. Il faut saluer la beauté du début, par exemple la course des enfants à flan de colline qui a la pureté d’un Pather Panchali, la sobriété générale, la belle tenue de l’ensemble qui fait de ce coup d’essai un bijou du cinéma libanais. Mais bien qu’il ait repris le thème fondateur de l’immigration, le film reste néanmoins un acte manqué et ce en dépit de son excellent accueil à Cannes, à cause de la mainmise à l’époque du cinéma égyptien dont les pontes bloquent la sortie libanaise de Vers l’inconnu, finalement diffusé dans l’unique salle de l’Opéra où il connut un échec cuisant à cause du rejet d’un public éduqué au dialecte et aux codes égyptiens.
Si l’Histoire a fait de son premier film un chef d’œuvre et du second un échec, il faut relativiser ce jugement. Certes, le grand historien français du cinéma fut déçu du Petit étranger (1962), œuvre versant selon certains dans le sentimentalisme ou pour d’autres, dans l’imitation européenne et occidentale. Le film est réellement handicapé par un tournage en français qui annihile un peu son authenticité. Mais ce choix de l’auteur s’explique comme l’unique option pour pouvoir sortir le film au Liban en tant que film étranger. Il y a pourtant ici un tel plaisir à faire du cinéma, à se connecter à son époque et sans doute à certains auteurs que Nasser a pu admirer. Oui, ça sent parfois la France. La visite à la prison connaît un découpage et des enchaînements que n’aurait pas reniés Bresson. Le rapport de l’adolescent à son cheval a le lyrisme de Crin-Blanc et certaines scènes fleurent bon le cinéma populaire des années 50, notamment dans leur vision morale de la femme, objet de toutes les convoitises et alibi de bien des erreurs des hommes. L’érotisme est celui de Riz amer avec ici, la beauté naturelle de ses travailleuses des salines sur lesquelles le chef et ses sbires exercent un droit de cuissage. Toujours au plan social, le film traite tout de même du chômage et de l’exploitation des travailleurs par un patron en cheville avec la loi, mais aussi de la prostitution comme moyen inéluctable de soutenir la famille du frère du héros emprisonné.
S’il n’est peut-être pas « réussi », dans le sens où la copie n’est pas le montage souhaité par Nasser qui connut un conflit avec son peu scrupuleux producteur, les raccords de montage à moitié expérimentaux (c’était déjà presque le cas du montage sériel de plans d’une seconde et demie dans Vers l’inconnu), témoignent d’une progression de Nasser dans sa recherche, et des scènes très pensées (le jeune héros joue la comédie à sa mère et on ne filme alors que leurs pieds durant tout leur dialogue) succèdent à des scènes émouvantes (l‘algarade entre les deux garçons où Dory apprend comment est payée son éducation) et simplement belles. La narration se dilue parfois dans les personnages secondaires qui amoindrissent alors l’itinéraire initiatique de l’adolescent. Mais qu’importe : il y a en plus une superbe photographie (due à un chef op français) et des audaces typique des années 60 (la chevauchée sous l’avion, l’irruption de la couleur) et qui prouvent que Nasser avait tout pour devenir un grand maître.
Las, l’absence de soutien étatique et la non reconnaissance publique ont saboté sa carrière. Il ne tournera plus qu’un film à la veille de la guerre civile, Il suffit d’un seul homme (1975) et qui témoigne des préoccupations géopolitiques des libanais : le soutien aux Palestiniens. Les lignes consacrées à Georges Nasser, vite catalogué père fondateur pour mieux l’évacuer (mais ausi pour être à l’origine de plusieurs structures professionnelles et ne jamais avoir cessé de solliciter le gouvernement libanais), étant assez sporadiques, il faut saluer le travail de Abbout productions et de Cannes classics pour la réalisation de ce documentaire, comme pour avoir restauré et projeté Vers l’inconnu, pour enfin rendre à Georges Nasser ce qui lui est du dans l’Histoire du cinéma. L’émotion de Thierry Frémaux est alors partagée et on comprend le talent et la force de caractère de cette belle personne dont on attend une plus large réhabilitation et la sortie en DVD qu’il mérite dans la foulée, en espérant que les institutions internationales entreprennent bientôt de restaurer son Petit étranger.
Des acteurs populaires et des films
Durant ces premières années, le développement du cinéma populaire va bon train avec Georges Kahi et autour du très prolifique Mohammed Selmane, et plus tard de Samir al-Ghoussainy, inusable pourvoyeur de nanars populaires depuis les années 60 et durant toute la guerre civile – mais aussi jusqu’au début des années 2000! – à l’instar du semi-culte Les chattes de la rue Hamra (1972), genre de Mondo fictionné, ou de Grand prix (1974), assez représentatif de son style et des ses thématiques avec des bikeuses sexy en cuir, un personnage comique au jeu très exagéré et surtout ses catcheurs et en tout premier lieu son acteur fétiche, le lutteur Jean Saadeh (des fameux Saadeh’s brothers avec son frère Andriyya), champion du monde en 1970, duo dont les expressions sont même passées dans le langage de tous les jours des libanais. Il s’agit ici comme bien souvent d’une histoire de revanche à prendre après un combat. À noter qu’ils ont ensuite fait une carrière française comme cascadeurs car il faut avouer que ces légendes ont une sacrée carrure !
À leur actif encore, le croquignolet Le retour du héros en 1982 avec le même cinéaste. Ce film d’action à la mise en scène fort efficace, se vautre dans les travers de son époque : violence exacerbée qui se manifeste dans quelques plans gore dont celui sur lequel s’affiche le titre et où un professeur se voir éborgné par un boxeur, de nombreux emprunts aux kung-fu flicks de l’époque (les arts martiaux, avec notamment une combattante, des effets d’accélération, un scénario de série B ou plus) ou aux polars italiens musclés, meilleur côté du film où Samir al-Ghoussainy se révèle alors un efficace artisan, avec des séquences bien montées soutenues par des mouvements de caméra qui dynamisent l’ensemble. Toutes proportions gardées on pourrait songer à Castellari ou Michael Winner. Quant à certaines scènes, elles lorgnent aussi assez directement vers Les spécialistes de Patrice Leconte.
Sauf que le réalisateur cherche à gagner sur tous les tableaux de l’exploitation : filmer des filles sexy, avec une scène de viol qui s’étale bien longtemps et trouve son apothéose sur l’étranglement du violeur par le méchant du film dans un plan assez orgasmique et dérangeant au vu de l’époque où il est tourné. Recherche de la catharsis ? Car au goût des armes, des explosions (nombreuses voitures piégées) et de la flamme, il faut ajouter celui des larmes où le cinéaste ne connaît hélas pas de retenue et c’est bien là où le bât blesse le plus. On a aussi une longue chanson qui tombe à mi parcours comme un cheveux sur la soupe, mais il faut bien distraire les gens en temps de guerre et notamment les nombreux figurants. C’est d’ailleurs le principal mérite de cette production que de s’accrocher au cinéma coûte que coûte et ça, ce n’est pas si mal. Il faut signaler également dans la veine très populaire l’apport de Rida Myassar (Le palestinien révolté (1969), Des filles à aimer (1972) ou encore Un rossignol du Liban (1982).
Selmane, très critiqué dans le livre de Dima el Horr, est crédité par le français Thoraval et l’anglais Armes, comme le réalisateur du très léger et pimpant Des héros et des hommes (1968), ailleurs attribué par elcinema.com ou IMDB au très important cinéaste indien des années 60, Nassir Hussain. Cette histoire de drogue, de drague et de frères lutteurs, s’inscrit dans l’esprit des productions internationales tournées ici mais marque au delà du rythme, par son talent pour le découpage, l’humour débridé du cinéma populaire, un goût certain pour l’érotisme, adoptant même les codes du nudie américain pour de nombreux strip-teases surprenant pour l’époque, la censure libanaise étant considérée comme rigoureuse (mais tout de même pas aussi hystérique et mortifère qu’en Syrie ou en Jordanie). Lorsque la température grimpe un peu trop, le réalisateur se réserve le droit de quelques interludes aquatiques, dont les motifs paraissent justement bien indiens (la cascade écumante!). Un fleuron pour les amateurs de cinéma bis qui apprécieront notamment sa scène de danse dans un bar sous les coups de fouet d’un nain plus sadique que lubrique. Tourné dans les années 70, le beaucoup plus kitsch L’île aux femmes (Faisal Al-Yasiri, 1974) est un divertissement de série B bien de son temps.
À noter l’apparition d’un érotisme assez poussé chez Samir Khoury, à qui l’on doit deux films de genre sexy, rocambolesques et assez bien tournés. La dame aux lune noires (1971), premier film libanais interdit aux moins de 18 ans, affiche clairement ses influences (italiennes entre autres, avec par exemple le trauma d’enfance de l’héroïne) et Franco et Eurociné ne sont pas loin quand le scénario prend lui le contre-pied moral de Belle de jour. Il y a d’abord une incroyable ouverture dans une partie fine dont les convives féminines sont masquées et qui évoque bien avant l’heure un Eyes wide shut ou en France, les films sadiens à venir d’un Scandelari. Le manque de moyens force Khoury à travailler dans la pénombre, à utiliser les ombres, les couleurs saturées et toutes sortes d’anamorphoses psychédélisantes. Il est probable qu’il s’agisse ici d’une version soft et que l’originale ne soit pas loin du même cinéma de genre grec de la même époque. Les critiques libanais en feront peu de cas en raison du scénario, mais la passion amoureuse éclate tout de même à l’écran, alors que le suicide final laisse un goût d’inachevé et de trahison propre aux films d’exploitation, jamais trop engagés. Il ne s’agit en tout cas pas d’un film anecdotique au plan de la mise en scène.
Les loups ne mangent pas la chair fraîche en 1972 est encore un pur film d’exploitation, limite ragoutant, notamment par l’utilisation de stock shots du Vietnam, avec vues de cadavres d’enfants, racoleurs et vomitifs, prémonitoires, et une intrigue où un journaliste dégoûté de la corruption des politiques de l’époque devient contrebandier au Koweit – le pays de la débauche et donc prétexte au plus grand nombre d’actrices nues ! Le problème est ici de monter ces archives et ces nus, souvent vus à travers un rideau de perles ou avec les plans d’une femme languissante, tirant sur son fume cigarette en écoutant toute la misère du monde. Une démarche excessive propre au mondo italien, deux autres pôles d’influence étant le giallo (la fausse vieille en fauteuil roulant et couteau ensanglanté ou la scène de la baignoire renvoie à La baie sanglante plus qu’à Psychose. Malheureusement Khoury ridiculise cette dernière par le gag de la savonnette, précipitant alors l’ensemble dans la farce.
Pour le reste, c’est un défilé d’excès filmiques (caméra à l’envers, cadrages obliques, retournements, mouvements en tous genres, compositions esthétisantes tirant vers le baroque et même l’abstraction !) dans une trame de polar musclé (des scènes bien montées comme celle de l’abattoir ou des poursuites en voiture correctes, mais qui tirent un peu la langue) ou enfin des scènes érotiques avec émirs et compagnie, là encore dignes de Jess Franco. Et que penser de ce plan final de malabars courant vers la caméra en agitant les bras comme des oiseaux avec leurs masques à têtes de mort ? Le manque de sérieux handicape sérieusement le film, au contraire du précédent. Durant la guerre civile, Khoury tournera un OVNI qu’on découvre un peu circonspects. Amani sous l’arc en ciel (1984), film sans doute adressé aux enfants, se déroule sur fond de guerre civile pendant laquelle un groupe de gamins doit trouver un abris. Vraiment un drôle de truc qu’on ne sait par quel bout prendre.
« Il est fou mon Liban » : les militants fourbissent leurs armes
Puis à la fin des années 60 et comme en Syrie, l’important courant des westerns fedayins se développe et irrigue le Liban. Il est difficile à appréhender car peu de copies circulent encore. Notons que des cinéastes importants comme Garabedian (auteur de Gharo, 1965, polar néo-réaliste encensé par Thoraval) y officieront bien volontiers. La guerre civile viendra en écorner le mythe.
Le tableau est donc contrasté : fragments très épars d’un authentique cinéma d’auteur d’un côté, contre douceur surannée, apolitique et passe-partout du cinéma commercial qui règne en maître absolu à l’opposé du spectre, le tout avec une nette augmentation du nombre de films. Mais nombre de critiques ou d’enseignants se refuseront toutefois à parler de véritable cinéma libanais avant la guerre civile.
La Défaite de la guerre des six jours en 67, le bombardement de l’aéroport de Beyrouth par les israéliens en 68, l’arrivée massive d’une nouvelle vague de réfugiés palestiniens après Septembre noir en 1970 dans un pays où la population chrétienne était déjà dépassée par la population musulmane et surtout, l’arrivée de l’OLP et d’Arafat qui a fait du Liban sa base arrière, augmentent les tensions et l’engagement des uns dans le soutien à la lutte des Palestiniens (les ouvriers, les intellectuels, les étudiants ou les dissidents arabes), des autres dans la formation de milices. La mort de Nasser, la guerre israélo-arabe et les accords de Camp David où Sadate reconnaît l’état d’Israël, ont enterré le projet d’un grand état arabe progressiste au profit des problématiques locales des uns et des autres. Dans un contexte repli sur soi, naît néanmoins le courant des Nouveaux cinémas arabes qui irriguera bientôt le Liban, une mouvance engagée et soucieuse des luttes se déroulant sur d’autres territoires, comme de celle des fedayins…
Diplômée en anthropologie sociale et journaliste de formation, Heiny Srour, réalise le court-métrage Pain de nos montagnes (1968) au Liban, après son passage à la section audiovisuelle de Nanterre fondée par Jean Rouch. Elle dégaine la première sa caméra au Dhofar (Oman) pour L’heure de la libération a sonné (1974), présenté à Cannes et qui documente la guérilla du FPLGAO et son soulèvement contre le nouveau sultan, porté au pouvoir par un coup d’état fomenté par les anglais. Le film est tourné sous les bombardements et il faut arpenter le désert. « J’ai pu réaliser ce film uniquement parce le FPLGAO était d’un féminisme extraordinaire, chose rarissime dans la gauche arabe … » Ce film militant à la beauté concrète, partiale mais authentique, est emblématique de nombreux autres qui vont suivre, par la forme comme par le fond, comme au Liban Cent visages pour un seul jour (1972), film politique collectif autour d’un groupe de communistes, réalisé notamment par Christian Gazi).
Citons aussi le très efficace Kafr Kassem (1974) de Bohrane Alaouié sur les exactions de l’armée israélienne, film réquisitoire réalisé d’après les comptes-rendus des procès et qui donne matière à penser. Première femme cinéaste du monde arabe sélectionnée dans un festival international, Heiny Srour se retrouve bloquée à Londres durant la guerre civile, continuera sa route en réalisant Leïla et les loups (1984) (qui vient d’être restauré par le CNC !) sur la condition féminine. «… Ma culture est alimentée par les contes des Mille et Une Nuits, transmis par ma grand-mère, une divine conteuse. Cette œuvre, d’une imagination et d’une pertinence avant-gardiste dans sa critique sociale, était profondément anti-despotique, anti-esclavagiste, anti-zèle religieux, et surtout immensément féministe. Voyager librement à travers le temps et l’espace pour critiquer la version coloniale et masculine de l’Histoire a donc été, pour moi, un automatisme inconscient venu de cette lecture déterminante de l’enfance. Leïla et les loups cherchait à embrasser huit décennies d’événements historiques d’un point de vue féministe, sans jamais oublier que le patriarcat opprime aussi les hommes. » Une carrière aussi courte qu’essentielle.
Le point de non retour est atteint au Liban et se catalyse dans sa capitale Beyrouth, elle qui concentre la moitié de la population du pays. Elle transparaît dans le film de Maroun Bagdadi, Beyrouth ô Beyrouth, qui annonce à qui veut le voir que le soit disant âge d’or est sur le point de finir. La guerre survient et avec elle un cinéma d’auteurs concernés. Bagdadi tout d’abord, va documenter le conflit, engagé politiquement certes, mais surtout poétiquement. Parmi ses documentaires, il tourne Murmures (1980) avec la poétesse Nadia Tuéni. Le film est marquant à plus d’un titre : par cette voix off, par les rushes de son cameraman et complice Hassan Naamani, par ce voyage dans la mémoire collective de cinq ans de conflit car « Quelqu’un qui a perdu quelque chose se met à l’apprécier plus ». C’est un road movie, genre qu’on aurait pu alors croire impossible, de Beyrouth à la Bekaa, de Tyr à Baalbeck où sa série d’entretiens brosse autant de portraits.
Le côté didactique prend peu à peu le pas pour mettre en avant une autre frange de la société libanaise, celle optimiste, pressée de bâtir un avenir économique plus radieux. « Nous devons continuer à construire »… Ici s’instaure cette dialectique propre au cinéma libanais : destruction/reconstruction. En effet, en peine guerre civile, on met déjà en place des plans de reconstruction, entrant dans un cycle infernal qui ne finit jamais sauf sur la fameuse ligne verte qui fend Beyrouth en deux. « Avec le temps, les ruines deviennent belles. Mais moi je ne m’habituerai pas » prophétise la poétesse. Tant pis pour les esthètes de la guerre, celles et ceux qui en éprouvent la fascination vénéneuse et s’égarent dans sa contemplation. Entièrement déterminée par la guerre, l’œuvre documentaire de Bagdadi bifurque discrètement vers la fiction.
Vers Petites guerres (1982) et on retrouve certains personnages du réel de Murmures enrôlés dans la fiction, tel Nabil Ismail, jouant ici un personnage noir et grandiloquent, mythomane et dangereux, à l’image de certains libanais ayant sombré dans la guerre civile. Premier chef d’œuvre du jeune cinéma libanais de fiction, à la mise en scène remarquable et à l’écriture fluide, nous maintenant en permanence dans l’angoisse. On peut ici parler d’une « libanisation du récit » plutôt que de choralité et de narration un peu éclatée plus que vraiment déconstruite. Tout ça reste très organique parce que Bagdadi carbure à l’amitié et que c’est avant tout l’histoire d’une communauté partagée entre différents destins et que le conflit va faire exploser. Ça a presque valeur d’étude, notamment avec le fils du Bey, Tabbal, devenu chef de clan et donc de guerre par honneur et aussi pour marquer une rupture générationnelle avec la génération de sa mère et ses compromissions, quitte à avaliser la reconduction du pouvoir patriarcal. De nombreuses scènes fortes marquent le spectateur dont celle de l’enlèvement, celle de l’hôpital et de la grenade, celle de l’enseigne lumineuse Thompson qu’on descend à coup de fusil pour s’amuser, celle de la rançon et une magnifique scène de forêt aux couleurs flamboyantes de l’automne. Sans oublier le final westernien dans les ruines. À chaque fois, la mise en scène fait sens, le montage est impeccable et la musique de Gabriel Yared nous emporte jusqu’au vertige. Les personnages sont forts, inoubliables pour certains. La cerise sur le gâteau, c’est d’avoir une héroïne dont le gros plan clôture le film.
Puis Maroun Bagdadi tourne le beau polar mélancolique L’homme voilé (1987), où un médecin français ayant partie liée au conflit, se retrouve tueur à gages pour exécuter à Paris des combattants du bord adverse, au service d’un Michel Piccoli mu par la vengeance. Le film brille par son atmosphère bluesy, son talent de conteur et une douleur à peine voilée qui nous fait chavirer. Bagdadi réaffirme ses liens avec la France pour son prix du Jury à Cannes, Hors la vie (1990), où Hippolyte Girardot devient otage et nous replonge dans la sombre époque des JT français. Tourné de façon réaliste dans des vestiges de la guerre civile déjà en voie de recyclage, le film suit le quotidien d’un otage du Hezbollah avec minutie, attentif à leur méthodologie. Il n’est d’ailleurs en rien caricatural dans les personnages, tous très divers, tous impliqués pour le pire dans la lutte. Hors la vie est un film qui se vit en temps réel. L’enlèvement et la disparition deviennent là encore des thèmes inusables du cinéma national car si la guerre civile a fait environ 250 000 victimes, elle a aussi rayés de la carte 17 000 disparus ! Après un beau film d’évasion écrit avec Michel Vaujour (La Fille de l’air), Maroun Bagdadi retourne au Liban pour achever sa tétralogie mais se tue mystérieusement dans la cage d’escalier de la maison familiale. Il avait 42 ans.
Une carrière écourtée mais fondatrice de cet « autre cinéma », selon l’appellation du critique et excellent cinéaste lui-même Mohammed Soueid (Civil war en 2002), qui à l’opposé du cinéma commercial lénifiant, idéalisant la nation libanaise et ses forces de l’ordre et où surtout la guerre civile constitue le point aveugle, tend à mettre ce quotidien et parfois sa fugacité au centre, aussi rude, triste ou traumatisant soit-il. 1982 est pour Soueid l’année où se cristallisent les deux courants du cinéma libanais, le commercial et le cinéma d’auteur. « Autre » mais aussi qualifié de « cinéma de l’intelligentsia » selon l’enseignant et documentariste Hady Zaccak, agrégat informel d’intellectuels. En effet, la plupart de ces nouveaux cinéastes ont étudié en Europe : Paris pour Jean Chamoun, Jocelyne Saab (Une vie suspendue en 1985) ou Randa Chahal Sabbag (Nos guerres imprudentes, Civilisées) ou à Bruxelles pour Bohrane Alaouié (Il ne suffit pas que Dieu soit avec les pauvres, Beyrouth la rencontre, La lettre du temps de guerre, A toi où que tu sois) ou Jean-Claude Codsi, ou plus tard Layla Assaf en Suède. Vivant parfois en exil et financés par des fonds étrangers, ils sont comme tous les intellectuels de l’époque, sensibles à la cause palestinienne.
Des femmes et la guerre
L’autrice la plus importante de la période est Jocelyne Saab. Issue de la bourgeoisie chrétienne beyrouthine, Jocelyne Saab n’en fut pas moins une militante de gauche acharnée, d’abord engagée dans la voie documentaire au Liban comme ailleurs, suivant les pas de sa consœur marxiste léniniste Heiny Srour. Outre les premières œuvres de Saab (Le Liban dans la tourmente en 1975), sa trilogie de Beyrouth (que Nicole Brenez qualifie dans les Cahiers d’ « essai spéculatif le plus personnel » raconte « sa » guerre dans des documentaires courts et déchirants. Dans Beyrouth jamais plus (1976), une femme s’avance dans la rue en buvant son café, aussi absente à la caméra que ce chat pelé. Toujours avec l’indispensable Naamani, Saab filme la destruction de la civilisation, substituant d’abord aux corps des mannequins, pour faire réapparaître un pied humain gangrené près d’enfants s’ébattant dans l’eau polluée.
Lettre de Beyrouth (1978) commence sur un tout autre ton, littéraire, en une sorte de journal filmé préfigurant l’œuvre à venir de Chantal Akerman, à la différence que Saab s’y met en scène, d’abord en train d’écrire. Mais cet aspect épistolaire est un leurre et la voix-off s‘en écartera souvent ; la cinéaste filme des lieux inédits de cet autre Beyrouth qui continue de vivre à la marge de la guerre, sur la Corniche (« la plus belle fille de la Méditerranée ») ou au champ de courses ou à l’université américaine de Beyrouth. Un marin raconte à des amis ses escales et l’évocation du voyage fait rêver. Des discussions surprenantes s’ébauchent dans les bus, même si l’on comprend rapidement que la grande majorité préfère désormais se taire que d’avancer une opinion en public. Ils n’auront par la suite que trop raison. Ils laissent la place au conciliabule – à peine aménagé ! – des journalistes internationaux ou à l’expression murale florissante. L’auteure manie bien l’ironie, comme à son habitude, particulièrement dans la vie à la prison où un nombre conséquent de gardiens surplombe le petit troupeau humain qui arpente la cour des promenades. Un état libanais à la dérive y affirme son autorité tant qu’il le peut. Il y a aussi ici la notion de retour, de pèlerinage sur les ruines encore fraîches du camp de Tall el zaatar ou aux pieds de la vierge blessée qu’on a érigée à l’endroit du massacre des 27 palestiniens passagers du bus. Et surtout elle filme comme des archives le déplacement très récent des réfugiés, puis leur retour deux mois plus tard dans un pays où désormais, tous sont réfugiés. D’autres régions n’ont guère changé : déjà les habitants du sud Liban n’ont plus que des préfabriqués de fortune pour logement. La région est quadrillée par un réseau de check points kafkaïens (10 pays en cinq heures !). Car le film est tourné dans une légère et courte accalmie du conflit, à ce moment où les adversaires se regardent en chien de faïence : palestiniens à la marge qui festoient avec Arafat le dimanche et dont le rapport à la caméra apparaît sans fards, à peine narquois, phalangistes dans le sillage de Tsahal qui refusent le passage à l’armée libanaise ou aux playmobiles de l’ONU qui font de la figuration. Ce « ni guerre ni paix » s’achève sur la grande roue du destin qui n’a en effet pas fini de mal tourner.
En toute logique, le troisième volet concerne donc l’autre grand tournant de la guerre à Beyrouth, celui où après l’invasion israélienne de 1982, se construit le mythe de Beyrouth ouest assiégé comme dernière enclave de liberté multi-culturelle. Beyrouth ma ville (1982) débute sur la cinéaste elle-même au milieu des ruines de sa maison, puis par une longue et insupportable séquence de corps carbonisés et d’enfants blessés. En deuil, Jocelyne Saab laisse place à un narrateur-auteur qui raconte cette aventure épique jusqu’au dénouement particulièrement émouvant, quand vient le départ des fedayins palestiniens et la tragédie qui s’ensuit. Un opus qui achève de consacrer cette trilogie inoubliable du cinéma libanais.
Jean Chamoun s’associe à son épouse, la palestinienne Mai Masri pour une série de documentaires qui frappent par la beauté de leurs images et l’empathie pour la population civile, notamment les enfants. Le style est plus direct. Children of war, Enfants de Chatila, War generation Beirut sont autant de témoignages de cette enfance en danger durant la guerre civile. Leurs films engagés montrent des moments forts de la survie de ces gamins, les reconstituent en assumant politiquement la méthode. Des enfants racontent dans War generation Beirut (1989) cette scène chez le boulanger qu’on retrouvera fictionnée par Ziad Doueiri dans West Beyrouth. La figure du jeune milicien karatéka reviendra elle dans nombre de films, preuve que le réel pèse alors sur les imaginaires. Parfois, le réel a même trop d’imagination. Ou pas. Un sniper décontracté ne voit ainsi aucune différence entre le fait de tirer et celui de manger un bonbon ou d’embrasser une fille. Ces films enregistrent une vraie fascination pour la guerre, voire une douceur, comme ces candidats au martyr qui fument tranquillement leur joint. Mais toujours la caméra de Mai Masri (elle gère également le montage) trouve des étincelles de vie et d’espoir dans ce marasme. Après tout, la guerre donne une famille, une situation, une raison de se lever à tous ceux qui n’en avaient pas, jusqu’aux femmes et aux enfants. Une des raisons de filmer du célèbre duo est leur engagement aux côtés des palestiniens et la séquence du départ des combattants est une des plus tristes, car elle nous renvoie directement aux massacres qui ont suivi. Le couple ne connaît pas la résignation et les miliciens sur le front rêvent de fraternisation. Avant de recommencer à s’insulter et à tirer. Mais à bout, la population n’en peut plus de cette guerre. Le film se clôt sur sa revendication pour le changement social.
Sans doute avec moins de recul, la situation est moins claire pour le spectateur étranger que dans Beyrouth ma ville. Sous les décombres (1983) enrage du siège de Beyrouth coincé sous un déluge de feu israélien. Professeur aux Beaux-Arts de Beyrouth, Chamoun avait d’ailleurs débuté par l’engagement politique aux côtés des Palestiniens et à ce titre, Tall el zaatar (1977), dernier film tourné par L’institut du Cinéma Palestinien et coréalisé entre autres avec MustapahaAbu Ali, documente le siège du camp palestinien du 22 juin au 11 août 1976, majoritairement peuplé de chrétiens palestiniens, avant le massacre de 2000 personnes par les phalangistes qui s’ensuivra le lendemain. L’assaut est ici soutenu par l’armée syrienne, elle-même occupant certaines zones du Liban pour barrer la route aux palestiniens, pensant ainsi éviter l’invasion du Liban par l’armée israélienne.
La fiction ne revient en force que plus tard, quand la guerre est déjà bien installée. Outre les beaux films de Bagdadi, on retiendra Une vie suspendue (1985), magnifique première fiction de long-métrage de Jocelyne Saab dans lequel jacques Weber est un peintre reclus dans son appartement, qui noue une idylle tout à fait platonique avec une jeune adolescente profitant d’une liberté de mouvement gagnée sur le chaos. La mise en scène est d’un beau classicisme, magnifiant l’abstraction de la décrépitude et des débris épars, créant des espaces oniriques à la nostalgie fanée et des digressions surréalistes dans ce présent trop cruel. La réalisatrice tire le meilleur parti de l’inscription du récit dans son décor ruiné naturel et y intègre quelques rushes documentaires, maintenus à distance par cette parenthèse enchantée qui colle à l’inspiration créatrice de l’artiste et calligraphe Karim. Celui-ci sera rattrapé par la réalité quand Samar (la très jolie Halla Bassan) garde la grâce et la vivacité pour passer entre les balles.
Conflit de génération après phase de séduction, car comme l’écrivait avec lucidité George Naccache dès 1949, « deux négations ne font pas une nation ». Ce film porte déjà la passion de la réalisatrice pour la féminité, la danse, le travail chorégraphique et tous les arts en général. Dans un cadre de coproduction franco-québécoise (qui leur vaut le titre inspiré de L’adolescente sucre d’amour) qui a permis de garder une distance salvatrice durant le périple en zone de conflit, la réalité est toujours transcendée par le regard de l’artiste bâtisseur pour un hymne à l’amour intemporel. Un des plus beaux films du temps de la guerre et qui constitue pour Dima el-Horr, le poste avancé de la ligne de démarcation de cet autre cinéma avec Petites guerres et Beyrouth la rencontre.
Il faut saluer aussi chez les hommes la démarche du très important auteur, metteur en scène de théâtre et comédien Roger Assaf (la voix et l’auteur du texte de Beyrouth ma ville !) qui tourne en 1985 un unique film, en 16 mm et avec les acteurs de sa troupe al Haawati, Maaraka (Bataille), sur une série d’événements qui ont eu lieu dans le sud du Liban occupé après l’invasion israélienne, dont le soulèvement d’Achoura à Nabatiyeh où de grandes foules étaient rassemblées pour les célébrations. Il n’est pas étonnant qu’Assaf se soit intéressé à des événements dans lequel le théâtre chi’ite, à la fois sacré et populaire, était très impliqué, les représentations constituant des actes politiques qui marquèrent le début de la résistance. Ces scènes ont dans le film une grande force documentaire. Dans une première partie, le film fait la part belle aux chants de résistance et à la culture chi’ite tout en conservant un aspect réaliste. Les scènes de foule sont très impressionnantes et témoignent de l’implication politique de la population, assez logique après la fin de l’occupation. Il y est également question de la prison d’Ansar, ouverte en 1982 par les israéliens, un mois après l’invasion, pour y enfermer les palestiniens et les libanais. Il est étrange que ce qui constitue à l’époque l’œuvre de fiction la plus importante sur l’invasion israélienne de 1982 ne soit pas plus souvent mentionnée et analysée très sérieusement. Assurément un des films importants de la décennie.
Un an après ce film, ce marxiste fervent défenseur de la cause palestinienne et donc du Sud-Liban « et de ceux qui le représentent » se convertira à l’Islam, car de tous temps, il fut solidaire des classes populaires, donc plutôt musulmanes ou palestiniennes. Né en 1941 d’un père libanais et d’une mère française, Assaf a débuté tôt le théâtre, puis a reçu une bourse pour étudier à Strasbourg. Il sera ensuite à l’origine de la renaissance du théâtre libanais (Atelier d’art dramatique en 1968, à vocation populaire et d’expression arabe) qu’il va même tirer vers l’expérimental à l’Université. Maronite (il a été membre de la Jeunesse Étudiante Chrétienne ), mais marxiste et brechtien, il partage la vie des réfugiés des camps. En 1975, il participe à la commune de Mreijé dans cette zone plutôt mixte, plus tard martyrisée à plusieurs reprises, puis cofonde le théâtre de Beyrouth à Ain Mressé. Sa pièce Majdaloun sur l’implication de l’OLP au sud Liban sera interdite après trois jours de représentations. À Beyrouth, il participera intensément à la vie culturelle et luttera contre l’ « urbanicide », cette tendance à reconstruire des tours partout. Plusieurs de ses pièces seront reconnues sur la scène internationale après 1977, d’autant qu’il sonde la mémoire collective avec des œuvres engagées tout en redonnant la primauté à la forme et à l’art du conteur arabe. Une position opposée au culte des martyrs, à l’image du travail du peintre Alfred Tarazi favorable à une mémoire humanisée du deuil.
Assaf a été une des figures importantes de l’incertitude de l’après-guerre et ne cessera désormais de s’interroger sur l’ « état de guerre » qui emprisonne toute une société. En 1999, il fonde l’association Shams dédiée à la solidarité interconfessionnelle. En 2008, il recevra un Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière à la Biennale de Venise. Cette même année, il a publié une importante Histoire du théâtre, des hommes et des œuvres qui va de l’Antiquité à nos jours et qui constitue une première Histoire universelle du Théâtre qui s’intéresse à toutes les cultures. « Je me suis battu pour que survive une certaine idée du Liban, celle de la diversité, de l’enrichissement mutuel par la solidarité, non pas celle du consensus national qui est une foutaise. Ce rêve n’en est pas un parce que je l’ai toujours vécu dans des espaces qui n’avaient pas toujours la même dimension. Actuellement, cette dimension est de plus en plus réduite à des options individuelles. » (in L’orient littéraire, Jaad Seman, juillet 2009)
Essais d’ici et d’exil
De leur côté, artistes, performeurs et vidéastes commencent à exprimer en temps réel la distance qui les sépare de leur pays en guerre. Parmi eux, la résidente européenne, palestinienne originaire de Beyrouth, Mona Hatoum tourne les films et donne les performances les plus spectaculaires. Elle était à Londres dans une école d’art au moment où éclate la guerre civile et la continue jusqu’en 1979. Sa situation d’exilée en provenance d’un pays du tiers-monde constitue la matière première de son travail et son propre corps, l’outil pour en dénoncer l’oppression et ici, l’impossibilité de se faire entendre en tant que membre d’une minorité. Il y a d’abord l’effroi et une impossibilité à l’exprimer dans So much i want to say (1983) , comme s’il fallait étouffer ce cri, trop douloureux pour être entendu. Le film débute sur de la neige, balayage d’un écran où ce qui se passe au Liban n’apparaît pas. Puis une tête et surtout une bouche que dix doigts de mains d’homme s’empressent de bâillonner. Surimpressions-déformations et itérations visuelles et sonores toutes les huit secondes – une même voix de femme répète à l’infini le « je voulais tant vous dire » en titre, gel de l’image et retour final au néant. Difficile de faire plus sec dans le concept !
Eyes skinned (1988) est un court tiré d’une performance live, qui joue sur l’endurance du spectateur, sur ses nerfs et son empathie. Il met en scène un dessillement, celui des images d’actualité qui se déversent dans les médias du monde entier, dont celles de l’éradication des palestiniens du Liban. Son exil, à moins que ce ne soit l’identité de Mona Hatoum elle même, est pareil à cette toile qui l’empêche de respirer. Le prix à payer, la souffrance du réel des autres et c’est cette violence que ce court film performe à la pointe du couteau. Measures to distance (1988) évoquait avec une photographie et les lettres d’une correspondance avec le pays, écrite de la main maternelle, la distance qui se crée avec le pays d’origine et le recul inévitable mais peut-être salutaire, même si le corps de l’artiste s’y retrouve mis à nu, sa figuration élaborant l’échelle qui la sépare du Liban de la guerre civile. La nudité au cœur de la relation maritale et exclusive propriété du mari, est ici reconquise par les femmes quand dans le discours de la mère, il est question des joies et plus particulièrement de la jouissance sexuelle dans le mariage. Dans ce dialogue déphasé se joue le passage de l’intime à l’universel.
Après une enfance dans les salles obscures beyrouthines durant le siège israélien de 1982, Hisham Bizri part étudier aux États-Unis, puis travaille avec Stan Brakhage, croise Raoul Ruiz ou collabore en Hongrie avec Miklos Jancso. Au Liban, il travaille un temps pour Future Tv, la chaîne du premier ministre Rafic Harari et du Future movement sunnite – le clan Bizri en est une des plus influentes familles et ce, depuis l’empire ottoman – et Orbit communications company (Rome, Dubaï, Le Caire, Beyrouth), avant de diriger Levantine films à New York puis d’enseigner au États-Unis durant de longues années. En 2005, il cofonde avec notamment le syrien Omar Amiralay, l’Institut Arabe du film à Amman (Jordanie). Sa carrière filmique débute en 1989 et il se consacre au court-métrage, plus d’une vingtaine réalisés sur différents supports (16mm, 35, Betacam, DV…). Son travail a fait le tour des structures et festivals les plus réputés. Ses courts exaltent la culture arabe (City of Brass, Asmahan, Sirocco (2011) et son fascinant travail de réexploration du film La momie) et en 2007, Bizri retournera au Liban tourner un film muet et silencieux sur la mort de ses voisins vingt ans auparavant : Song for the death ear (2008), un film au trois quarts muet, mais dont le montage rythmique obsessionnel n’est pas dépourvu de musicalité. Parmi les images de guerre qui recouvrent vite les autres, ce gros plan sur un visage de jeune fille où on ne sait pas vraiment s’il s’agit d’un cadavre ou d’une poupée, motif représentatif d’un film où l’atroce ne cesse de se dérober, avant que ne revienne la skyline beyrouthine d’une blancheur mortifère sur un littoral émeraude. Le film prend de la hauteur et le son revient sur une note plus rock’n roll, espérant chasser les fantômes d’une horreur pas même enterrée.
Et au lendemain de la guerre civile, la production est exsangue. La vitalité audiovisuelle va alors se développer dans les formes autres : documentaire, courts-métrages, art vidéo, cinéma expérimental, performances… Des liens se tissent dans le bouillonnement culturel qui s’empare de la capitale et font écho à la reconstruction accélérée par le vide. Souvent considéré comme le premier vidéaste libanais, le grand critique Mohammad Soueid, remarquable analyste du cinéma libanais, trouve une voie très personnelle dans quelques films précieux : Absence (1990) est un bel essai sur le deuil qui montre un cinéaste obsédé par l’esprit des lieux, un poète de l’image qui fixe la béance de telle embrasure tellement graphique. Toutes ces vues plutôt inédites, signées par son chef opérateur Fouad Sleiman, renouvellement la façon de filmer la ville pour traiter de la disparition et de la perte. Parmi ces témoignage, le plus émouvant est peut-être celui consacré au décès du cinéaste Gary Garabédian. On interroge la nature même des condoléances, des rituels socialement imposés. Soueid joue tout autant du son : feuilletons américains et autres ambiances, car le son lui reste quand « un écran noir et tu oublies tout ». Une approche très singulière du cinéma des fantômes, qui concrétise très précisément ces absences dans le souvenir de celles et ceux qui les souffrent.
En 1994, il fait le portrait de Khaled el Kourdi dans Cinema Fouad, un jeune trans syrien et danseur vivant à Beyrouth et qui rêve de payer son opération. Un jour, il rencontre un combattant palestinien, tombe amoureux. Ce qui caractérise ce portrait et à l’opposé par exemple du film de Shirley Clarke, Portrait of Jason (et surtout parce que son véritable sujet était le mensonge et non le portrait puisqu’impossible), c’est son humanité, son empathie pour la personne, assez attachante, la sobriété et la chaleur de la mise en scène, qui révèle néanmoins un underworld beyrouthin peu représenté auparavant. La même année, Soueid réalise 34 épisodes de courts expérimentaux de 5mn, Being Camelia. Cette commande de Télé Liban sur le thème de la nourriture devient avec lui une série satirique pointant l’absence de changements dans l’après guerre civile. En 1998, Tango of yearning est un autoportrait qui se focalise sur l’ombre de la guerre civile et l’oubli. Dans Nightfall (2000), il revisite son militantisme aux côtés des palestiniens dans la brigade étudiante de l’OLP en se rendant sur les lieux de mémoire et de défaites.
En 2002, il réalise avec Civil War sur la disparition de son collaborateur Mohamed D’Abis ce qui est peut-être son film le plus important, plus universel tout en étant plus personnel puis qu’il brouille les frontières de l’individuel et du collectif et les temporalités (11 septembre vs tour El-Murr), du réel et de la fiction. En 2006 dans The sky is not always above (2006), il se rend au sud Liban juste après la guerre avec Israël et rend au passage un hommage à John Ford. Soueid tourne encore How bitter my sweet (2009) ou My heart beats only for her (2009), plus une superbe collaboration avec Ghassan Sahlab, Le voyage immobile (2018) et continue plus que jamais avec des projets de très long format et réalisé au long cours comme The insomnia of a serial dreamer (2021) autour des rêves qui nous hantent. Soueid est un des grands cinéastes du cinéma des fantômes. Une œuvre qui mériterait une large rétrospective.
La fiction repart en guerre
En 1990, on a donc décidé que la guerre était finie. L’amnistie et l’oubli sont décrétés et le pays s’enfonce dans une fièvre de reconstruction. Mais reconstruire les êtres est autrement plus long. C’est dans cette incrédulité que naît une nouvelle génération de cinéaste qui va s’imposer internationalement avec un style et un ton souvent mélancoliques. Un certain nombre d’œuvres continuent de traiter directement de la période de la guerre. Le plus marquant est sans conteste West Beyrouth (1998), un premier film de Ziad Doueiri qui a passé sa jeunesse en exil aux États-Unis où il a intégré le milieu du cinéma, travaillant notamment avec Quentin Tarantino. C’est justement sa fougue, son plaisir de cinéma et la virtuosité de sa mise en scène qui font le prix de cette évocation picaresque, nostalgique mais finalement douloureuse. Le film contient notamment la reconstitution de la scène de l’assaut du bus palestinien avec la mort des 27 personnes qui a été le déclenchement officiel de la guerre civile. Si l’évocation de cette jeunesse chaotique est juste, notamment grâce à ses jeunes acteurs, l’évocation du bordel de Beyrouth est moins intéressante, quand bien même elle a une importance symbolique, au contraire de tout ce qui concerne l’évolution de l’état moral de la famille ou des scènes de passage de la ligne de démarcation.
Dans une veine similaire mais un style et une narration radicalement différents, Josef Fares raconte dans Zozo (2005), la mort de ses parents et son départ pour la Suède, suivi d’une intégration pas simple lorsqu’on a été traumatisé par la guerre. Le jeune acteur est sympathique et l’idée de filmer à hauteur d’enfant était bonne mais le film force sur les effets notamment mélodramatiques, là où les situations étaient déjà suffisamment tendues.
L’autre grand film, une féroce satire des forces en présence et plus particulièrement des miliciens et autres snipers, c’est le Civilisées (1999) de Randa Chahal Sabbag qui passe elle aussi à la fiction après quelques documentaires (Pas à pas, 1978), Le Liban autrefois (1980), Le Liban survit, 1981) très réputés et un film d’exil à thématique internationale, Écrans de sable (1991). Diffusé au début de la chaîne Arte, Civilisées a beaucoup fait pour la réputation du cinéma libanais. Il a par contre subi les foudres de la Sûreté générale qui l’a amputé du tiers, soit disant pour ne pas susciter de haines confessionnelles !
Plus encore que Jocelyne Saab, Danielle Arbid se révèle être la grande cinéaste du désir. Dans un premier temps, c’est son goût des autres et l’envie de comprendre qui la guide. Mais ses documentaires Seule avec la guerre (2000) ou Aux frontières (2002) ne lui permettent en rien de faire la paix avec ce pays. C’est en France qu’elle va trouver asile et reconnaissance.
D’abord pour Dans les champs de bataille (2004), remarquable récit d’une jeunesse beyrouthine au début de la guerre. « Pour retrouver le goût de cette période épique de ma vie, pour incarner ce chaos intime, j’imagine un décor fragmenté, comme les visages des personnages montrés souvent en amorce. Je ne voudrais pas déceler la géographie des lieux pour la bonne raison que je fais du cinéma pour raconter des sensations, des émotions, par petites touches et puis aussi par ce qu’on se trouve dans l’œil du cyclone, au centre d’un monde, dans la tête d’une petite fille. On vit dans un trou sombre et clos, le drame de la mort dans la vie se trouve dans la chair même des personnages (…) mes personnages sont tous morts quelque part. » Cinéaste sensuelle, elle excelle à filmer la vulnérabilité des corps et à suivre à la trace l’éclosion de cette jeune fille, ses interrogations, ses révoltes aussi. L’alchimie avec sa comédienne est totale. Le film traite en outre du comportement d’une certaine bourgeoisie incarnée ici par le personnage de la tante (Lauri Arbid Nasr) ou celui du père joueur, société décadente et renfermée sur elle-même et qui prive de liberté la jeune domestique syrienne. Danielle Arbid reprend ici la ligne de démarcation de la lutte des classes qui s’interpose entre les deux adolescentes, un conflit également né de la frustration et de l’envie.
Son film suivant, Un homme perdu (2007) joue à nouveau avec les contours d’un pays, cette fois à travers le regard un peu désabusé d’un photographe français (inspiré par Antoine d’Agata et incarné par Melvil Poupaud) qui se perd dans ses fantasmes, les liaisons sans lendemain et les bordels du Moyen-Orient, parfois au mépris des réalités locales. Arbid excelle à filmer les corps, à faire reculer les tabous et à confronter les cultures. Sa rencontre avec un disparu libanais sans identité et sans mémoire va l’entraîner jusqu’à Beyrouth. Arbid progresse vite dans sa manière de représenter le désir quand le film va lentement et encore une fois, elle n’a pas de mal à nous emporter et à nous retourner.
Cette même année, elle tourne le court-métrage documentaire This smell of sex (2007) qui pulvérise les tabous en donnant la parole à de jeunes hommes et de jeunes femmes pour parler librement, en voix off, de leur sexualité et de leurs phantasmes. À l’image, des plans d’une jeune oie blanche, mutine mais pudique, et qui n’ose pas se déshabiller face à la caméra. Petit à petit, de fondus au noir en fondus au noir, les stéréotypes s’estompent et les déclarations se font moins hétéronormées. « En général mes films exposent des secrets. À cause de cela beaucoup de gens estiment que je suis une provocatrice, que je pose la caméra là où ça dérange, que je le fais avec une impertinence jouissive. Et que je ne suis pas du tout représentative du monde arabe d’où je viens. Moi je trouve même dans cette détestation, une force pour faire encore des films. Car au-delà de la provocation pure, c’est la désobéissance qui m’intéresse. » Un court osé et passionnant.
De plus en plus à cheval entre ses origines et son pays d’adoption, elle tourne néanmoins pour Arte un Beyrouth hôtel (2012) au Liban qui sera malheureusement interdit de diffusion par la censure libanaise, prétendument pour des raisons politiques liées à l’assassinat de Rafic Hariri, un des éléments de l’intrigue. Peu probable si l’on se souvient que ses scènes de sexe avaient valu des limitations au moins de 18 ans à Dans les champs de bataille et Un homme perdu avait été jugé obscène et mutilé. Elle enchaîne ensuite par le magnifique et très français Peur de rien (2015) avec la jeune Manal Issa, puis Passion simple (2021).
La guerre avec Israël dans le sud Liban a inspiré Philippe Aractingi pour Sous les bombes (2007), un voyage dans une zone détruite entre fascination des ruines (tout est évidemment tourné en décors réels, il ne faut pas oublier qu’à l’époque où Mai Masri et Jean Chamoun tournaient, Aractingi débutait à seize ans comme reporter photographe sur les fronts de la guerre civile) et reconstruction d’une communauté libanaise utopique (avec la présence toujours rafraîchissante de Georges Khabbaz face à la très belle Nada Abou Farhat). Il y recrée le chaos suscité par 33 jours de bombardements intenses et plus d’un millier de morts, l’arrivée des casques bleus… La perplexité face au Hezbollah aussi. Il n’est pas étonnant que le film ait représenté le Liban aux Oscars. Caméra à l’épaule ou plutôt fixe pour recomposer des relations humaines, Aractingi reprend le schéma du road movie qui avait fait le succès de Bosta (2005). Comme si tout se répétait, encore et à jamais dans ce pays.
Parmi ceux qui traitent de la guerre civile, Dima El-Horr souligne qu’on revient à une trajectoire plus linéaire que les récits tournés durant le conflit. L’ombre de la ville (2000) permet au grand Jean Chamoun de passer à la fiction et de traiter entre autres « de la reconstruction inhumaine de la ville » (Laila Hotait) à travers l’histoire d’un enfant arrivé du sud Liban à 12 ans avec sa famille et que l’enlèvement de son père fera basculer vers les milices musulmanes. « J’ai fait L’ombre de la ville pour les jeunes générations qui n’ont pas vécu la guerre et veulent savoir ce qui s’est passé. » (entretien avec Amélie Arnaudet). Également venu du documentaire, Jean-Claude Codsi traite lui du retour d’exil dans un Liban en guerre avec Histoire d’un retour (1994) où le le protagoniste finira par se réconcilier avec son pays.
Dans Le tourbillon (1992) de Samir Habchi, un des cinéastes les plus importants de la génération de l’après-guerre, un étudiant de retour de Moscou va tomber dans l’engrenage de l’engagement pour lutter contre les injustices. Il devient un homme nouveau, à l’image de ces miliciens iconiques qui ont envahi le cinéma libanais. Le film a été en partie censuré. La ceinture de feu (2004) de Bahij Hojeij aborde lui, le difficile quotidien des blessés, moins souvent traité, avec un héros qui sombre dans la dépression, puis la folie.
Balle perdue (2011) de Georges Hachem n’aborde la guerre que de façon détournée, tout le scénario étant centré sur le mariage d’une jeune femme interprétée par Nadine Labaki et sur l’enchaînement de détails et de circonstances qui sur une journée vont la voir changer d’avis et refuser le mariage imposé. Une scène d’exécution glaçante est le pivot du film. Son second long, Still burning (2016) enfonce le clou dans ce récit sous forme de mise en abyme, où deux amis d’enfance passionnés de cinéma se retrouvent à Paris pour évoquer leur jeunesse durant la guerre civile et leur amour d’une même femme.
Khallas (2005) s’intéresse à trois personnages dans un récit éclaté, ponctué par les traumatismes de la guerre et le cauchemar récurrent lié à une fiancée qui a rompu. Le cinéaste filme la ville-personnage de nuit comme écrin à cette incommunicabilité et à la hantise de souvenirs qui ne sécrètent que mélancolie, lui préférant à la fin l’exil, comme toujours chez Bohrane Alaouié.
Côté documentaire, on peut opposer dans une même frontalité de témoignages, Massaker (Lokman Slim, 2005) à Khiam (2000, Joreige et Hadjithomas) dans la mesure où dans le premier, les bourreaux de Sabra et Chatila resteront masqués au contraire des libérés de Khiam.
« Filmer c’est appartenir à un territoire »
Pour les cinéastes de l’après-guerre, ce territoire c’est la mélancolie.
« Quelle place pouvons-nous trouver dans ce monde ? Quand on n’a plus de territoire, on est perdu, comme les animaux. Quel est mon territoire ? Dans Beyrouth fantôme et Terra incognita, le sens est dans la perdition. La guerre civile a chamboulé les repères. La différence avec une guerre «classique », c’est que, dans une guerre civile, on fait la guerre à son propre corps. C’est très compliqué et « passionnant ». Quand l’ordre apparent est rompu, on se rend compte que l’ordre était fragile, précaire. Ça s’écroule. Dans le quotidien, on cherche toujours l’ordre, mais c’est impossible, et cela conduit à la perdition. » Ghassan Salhab (entretien avec Amélie Arnaudet)
Ghassan Salhab est le cinéaste le plus important du Liban (et selon Dima El-Horr, le plus exigeant !), bien que son enfance fut sénégalaise et en exil pour cause de guerre civile, ou sa formation française : « disons que je travaille beaucoup l’incertain et que l’incertain me travaille ». Il commence à tourner des courts au milieu des années 80 dont les plus connus seront Après la mort (1991) et Afrique fantôme (1994), mais c’est en 1998 Beyrouth fantôme qui marque une date dans le cinéma national. Ici la trace du passé agit en filigrane sur tous les protagonistes. Ils vivent dans un Beyrouth très organique, où les travellings voiture modernes le disputent à la verticalité de ses immeubles qui ne seront jamais mieux filmés ailleurs. Un film à la fois passionnant, ouvert, presque un outil de débat à l’usage des libanais, donc générationnel. Le cinéaste sollicite la participation active du spectateur pour décrypter ce récit plein de trous qu’il doit lui-même combler selon son propre vécu, parce que « nos histoires sont plurielles ». Salhab va de plus en plus utiliser toutes les techniques du médium pour faire remonter les fantômes et questionner. Dans Terra incognita (2002), il y est dit que Beyrouth change de peau, d’où la perpétuelle agitation de son urbanité.
Parmi ses films moins connus, citons le merveilleux Dernier homme (2005), présenté notamment au Cinemed de Montpellier, qui offre une relecture brillante du mythe vampirique dès son plan introductif où les flots d’une Méditerranée colérique se jette à l’assaut de la jetée dans un lyrisme que n’aurait en effet pas renié Murnau. Dans ce film au tempo entravé, qui progresse par blocs comme affects, angoissé et onirique, la collaboration avec Mohamed Chahine, grand acteur de ces vingt dernières années, atteint son apogée, celui-ci faisant passer toute la détresse que procure une contamination lente mais totale et fatale, à la mélancolie. Salhab travaille ici plus que jamais le contraste entre la lumière et la couleur éclatante d’une mer nourricière dont émergent les mythes et l’obscurité, opérant beaucoup entre chiens et loup, rejoignant les cinéastes qui de par le monde profitent du numérique et des nuances qu’il permet, pour offrir une nouvelle manière de sous-éclairer les scènes et les personnages (ici ce « front invisible » selon la belle expression de Jacques Mandelbaum), ce qui donne ces atours gothiques discrets mais somptueux, l’auteur utilisant pour le mailleur, c’est à dire pour le plus symbolique, explicite mais surtout plastique, la couleur rouge sang et avec toute sa portée historique. La manière d’enchaîner les scènes reste très moderne, parfois presque expérimentale, jusqu’à la mise en scène qui permet d’évoquer la guerre à la manière des installations vidéo, art pour lequel l’artiste est aussi renommé sur la scène internationale. D’un côté, Salhab propose ses variations sur les codes : le néo vampire apparaît dans les miroirs, est fatigué par le plein soleil. Par contre, on ne peut pas le filmer ; il renifle son « alpha » joué par Aouni Kawas, acteur fétiche de Beyrouth fantôme. De l’autre, le cinéaste joue avec les images, comme le permet par exemple l’imagerie médicale, le microscopique, mais aussi le choix de la saison avec un Beyrouth battu par la pluie ou illuminé par l’orage. Cette dévolution intérieure est aussi changement de perception, avec une intense scène de bar toute au ralenti. Il y a enfin ici l’idée d’un voyage à travers la société libanaise, puisque sont représentés ces étrangers travaillant dans les basses tâches ou la défaite de toute forme d’autorité. Livré a lui même, l’individu peut alors involuer. Un film qui n’a pas reçu en France l’attention qu’il aurait mérité mais n’a rien perdu, bien au contraire, de son pouvoir de fascination et de réflexion.
Salhab enchaîne (ce qui n’a pas grand sens lorsqu’on considère son énorme production de courts, de vidéos et d’installations qui voient progresser cette œuvre colossale de façon très organique – et Mandelbaum de parler très à propos de « libanisation du cinéma » – et naturelle) sur une trilogie sur le Liban produite par Abbout productions : La montagne (2010), film conceptuel et minimaliste, dont le noir et blanc et la sécheresse prennent le contre-pied des représentations habituelles, souvent nostalgiques, des terres de l’intérieur pour gagner plutôt l’essence de l’être, puis avec La vallée (2014) et ses ramifications complexes, semblent sonder la mémoire individuelle et collective ( à ce stade, c’est du marteau-piqueur !) et surtout remonter aux sources puisqu’ici tout conflit n’est qu’un éternel recommencement. À l’aveuglement du héros et de ses congénères répond l’instinct des bêtes (dont parle le cinéaste dans un essai transitoire mais fulgurant, L’encre de Chine (2016)), à la quête du héros le repli sur soi communautaire, à la montagne, la vallée de la Bekaa et in fine, au Liban contemporain, l’état d’Israël. Il poursuit cette trilogie avec The river (2021), qui malgré sa présentation à Locarno, n’a pas trouvé de distributeur français digne de s’y risquer ou comme si l’aspect spectral de son voyage était étouffé par la trop grande concrétude des conflits contemporains.
« Le cinéma me permet de sentir avant tout, et non pas de croire qu’il suffit de soit-disant comprendre ». Heureusement, pour les amoureux de cinéma, la face la plus personnelle, donc précieuse, du travail de Ghassan Salhab est en partie disponible sur sa chaîne Viméo. Ces essais personnels et pertinents entretiennent un dialogue à la pointe du sens et de la nature de l’image avec les plus grands auteurs du cinéma mondial et en premier lieu Jean-Luc Godard à qui Salhab a consacré un entretien filmé. Il part de son expérience personnelle du monde pour la confronter à sa réflexion sur le cinéma (il cite dans L’encre de Chine le rapport au réel d’Ozu, proche en cela des réflexions de Kiarostami parvenu au même constat à la veille de sa mort) et des images de cinéma ayant déjà mythifié et poétisé la nature humaine elle-même (Pasolini à travers l’icône Pierre Clementi, l’impossibilité de l’innocence personnifiée). Mais il se trouve ici que Salhab prolonge la geste godardienne de la plus belle des manières, le langage, l’écriture, plus que jamais son anti-cinéma post colonial répondant et rimant avec son œuvre écrite (le sublime Fragments du livre du naufrage), la poésie arabe ayant depuis bien longtemps analysé les dilemmes qui s’offraient à l’Humanité, ayant proposé des clés pour sentir le monde, les poètes hélas minoritaires en leur propre pays (« seuls les poètes ? »…). Plus encore que chez Godard, il y a une polyphonie de voix qui se mêlent dans le temps de l’histoire. Il se peut même que la création sonore soit la première matière de Ghassan Salhab d’où l’importance du mixage, de la prosodie et des atmosphères. « Il n’y a pas d’autre monde », mais d’autres manières de vivre.
« Si ce qui nous entoure nous constitue », mieux vaut plonger dans l’œuvre de Ghassan Salhab et tenter d’y demeurer, mais aussi de ces autres cinéastes et artistes libanais qui vont fleurir dans une époque boostée par l’urgence de créer.
Nettement plus populaires chez nous, quoique pas assez visibles en salle même si portés par les meilleurs festivals, le duo Joana Hadjithomas et Khalil Joreige est le plus important de sa génération. Repérés dès leurs débuts (Autour de la maison rose (1999), puis par le court-métrage Cendres (2003), marquant par son ton), pour être reconnus dès A perfect day (2005), considéré comme l’un des films les plus puissants de l’après-guerre. Il y a chez eux une habileté à couler la modernité dans un récit acceptable par un public plus conventionnel. Pour autant, la réflexion est présente partout (réflexivité) et la représentation du monde contemporain sert de toile de fond constante.
À travers un jeune homme narcoleptique (Ziad Saad), lancé dans une quête pour solder la mort de son père disparu, se pose la question de la finitude d’une époque dans le trop présent d’une autre. Le rythme ou la cartographie de Beyrouth (point commun avec Beyrouth fantôme et conséquence d’une ligne verte et de multiples partitions ayant en permanence obligé les beyrouthins à se demander où ils sont – et avec qui !-) cheminent ou embrayent sur la pop libanaise très présente dans le film, des langoureux et obsédants morceaux de Soapkills aux accords de Scrambled eggs. C’est aussi le début de l’âge d’or pour Julia Kassar, grande actrice libanaise partout présente durant deux décennies et qui a représenté toutes les mères « courage » avec élégance et ce qu’il faut de rage sans le montrer. Ce film des cinéastes explore enfin une autre face de leur travail artistique (par exemple celle de la série de cartes postales Wonder Beirut) basée sur cette latence qui flotte à Beyrouth depuis la fin de la guerre, cette ville prise entre amnésie de la guerre et irréalité du futur proposé par les publicités et les chantiers immobiliers.
Des traumas, des blessures
À l’opposé, dans Tramontane (2016) de Vatche Boulghourjian, un jeune chanteur aveugle (joué par le non voyant Barakat Jabbour) ne peut plus vivre normalement dès lors qu’il apprend qu’il a été adopté pendant la guerre civile, dans des circonstances qui deviendront de plus en plus troubles au fur et à mesure que son road movie s’enfonce à l’intérieur du pays. Il doit retrouver les compagnons d’armes de son oncle, ancien chef de guerre qui l’a recueilli après avoir massacré son village. Ici, Rabih, le héros, se heurte au déni de mémoire qui a vu les belligérants fabriquer des faux pour pouvoir continuer à vivre en toute impunité. Mal voyant, il voit pourtant clair dans leur jeu et la route à suivre lui apparaît aussi évidente que monte la pureté de son chant lorsqu’il chantait jadis la beauté de cet oncle si admiré. Le récit est rythmé par de beaux passages musicaux, des rencontres souvent fortes comme celle d’un vieux cheikh philosophe et des lieux (monuments, maisons du sud Liban ayant péniblement survécu aux conflits…). La fin est amère : il n’y a pas de réparations et pas vraiment d’acceptation de la réalité. Reste le trajet et il en vaut la peine. « En réalisant ce film, j’ai découvert une forme de psychothérapie intitulée la « thérapie narrative », où les patients sont appelés à investiguer sur leur vie et à essayer d’en créer une autre version dans laquelle ils maîtrisent le cours des événements qui auraient pu la bouleverser. Cette thérapie pourrait être suivie dans un cadre professionnel, mais les êtres humains ont toujours créé des récits alternatifs ou parallèles comme instinct de survie ». (entretien avec Joseph Korkmaz).
Originaire de l’importante communauté arménienne et libanaise, Boulghourjian a été formé aux États-Unis, puis a officié dans le documentaire et l’expérimental dans divers pays du monde arabe. Son film de fin d’études, La cinquième colonne (2010 ) a été soutenu par la Cinéfondation.
Que vienne la pluie (2011) de Bahij Hojeij s’intéresse au retour d’un de ces 17 000 disparus dont les libanais n’ont pas de nouvelles. L’auteur brosse un récit familial simple où l’on s’est accommodé de cet état de fait, quand le mari revenu en piteux état ou une épouse sans enfants ne s’en remettent pas si facilement. On ne s’autorise plus à vivre normalement. Le film entérine donc dans sa mise en scène même, ce décalage entre une famille de l’après-guerre dans son quotidien et la quête des autres, cette population oubliée de l’état et qui ne sait à qui se vouer. Les rues de Beyrouth sont à l’image d’un pays devenu étranger. Les traumatismes sont traités comme des réalités parallèles qui ont infecté le subconscient des protagonistes, portés par le rôle de composition de son acteur principal (Hassan Mrad) et par la prestation de Julia Kassar et Carmen Lebbos qui donnent deux images de la femme libanaise, une qui doit continuer coûte que coûte, l’autre qui s’accroche au passé et refuse d’appartenir au monde du présent.
Enfin le film s’autorise aussi une digression, des séquences sur le témoignage presque fantomatique d’une femme qui décide peu à peu de ne plus attendre le retour de son fils et de se suicider, inspirée par le personnage de la journaliste Nayfeh Najjar dont la mort avait marqué la société libanaise. La fin est cathartique et pessimiste : il n’y a pas de retour en arrière car « si tu reviens, tu traceras le chemin de ta vie » écrivait Najjar. Ici, le fantôme c’est Ramez et au contraire du film de genre, son passage leur permettra à posteriori de vivre.
Dans le film de Dima El-Horr, Chaque jour est une fête (2009), les traumatismes n’en finissent pas de remonter et d’affleurer à la surface de la réalité, dès le prologue onirique ou un couple de jeunes mariés court dans un tunnel, échappée empêchée par les militaires libanais. Il faut préciser qu’on ne voit à peu près aucun film depuis la fin de la guerre civile qui leur donne le beau rôle, c’est dire la taille de la fracture qui les sépare de la population ! Se substitue alors à cette scène l’arrivée d’un troupeau de mères de disparus qui emplit tout l’espace. Dima El-Horr travaille beaucoup à brouiller les pistes des scènes en apparences réelles, par des artifices de mise en scène (le laveur de glaces lorsque Hyam Abbas téléphone dans la cabine) ou de montage. Elle bascule soit dans le thriller soit dans le fantastique avec l’assassinat brutal et absurde du chauffeur de bus. Plus loin, c’est encore l’accident de la camionnette transportant les poules…
Et partout autour de ces trois protagonistes, ces femmes se rendant à un parloir dans une prison située aux confins du pays, un territoire peu identifié mais où ressort le refoulé, des cortèges humains qui ne cessent de les croiser comme sans les voir, foules à la fois historiques et symboliques. Un film sans doute plus symbolique que véritablement moderne, coécrit avec Rabih Mroué. Né à Beyrouth, Rabih Mroué, artiste, comédien et metteur en scène utilisant archives et documents, photographies, séquences vidéo, car cette œuvre transdisciplinaire vise justement à remettre en question la place et l’autorité de l’archive et à les questionner. Chaque jour a beaucoup été acclamé internationalement mais c’est une œuvre peut-être plus cérébrale au regard d’autres films libanais, eux plus viscéraux et surtout, des performances de Mroué tournées vers un Body art exorcisant la violence faite aux corps des libanais.
Retour toujours. Il avait réalisé Hummus aux États-Unis en 1992, sur les difficultés d’intégration à un nouveau pays. Dans l’essai personnel Roads full of apricots (2001), Nigol Bezjian revient dans son pays après une longue absence, mais la quête des lieux de son passé demeurera inassouvie, noyée dans les ruines. Son itinéraire répète aussi le destin tragique de toute la communauté arménienne. Un cinéaste très apprécié au Liban, même s’il a peu tourné.
Dans Falafel (2006), Michel Kammoun s’intéresse à la vie nocturne libanaise et en particulier à celle du jeune Tou, un coursier en mobylette et à son idylle romantique de très courte durée avec la belle Yasmine rencontrée à une soirée. Kammoun, venu du court-métrage avec notamment La cabine (1999), impressionnant par sa prouesse technique, excelle à mettre en scène la ville de nuit. Les fêtes sont plus chaleureuses que jamais, l’envie de vivre est là. À un croisement, la caméra tire tout droit laissant son couple bifurquer à droite. C’est cette image de bonheur fuyant (en écho au conte autour du falafel en titre) qui s’impose alors. Car une étincelle de violence suffit pour bouleverser une existence et la ville paraît ensuite menaçante, électrique. La loi du plus fort domine encore les mentalités. Pour son cinéma, on pense à Carax et à Mauvais sang, car on y retrouve cette même urgence et l’épée de Damoclès au-dessus de sa jeunesse. Kammoun pointe ici le conflit de générations et la persistance des archaïsmes qui menacent de se transmettre et d’engloutir Tou. Plus loin, ce sont de mauvais souvenirs qui surgissent au coin de la rue, d’anciennes pratiques. La présence des armes à feu est certes grandement responsable de cette violence latente, mais c’est surtout une question d’attitude puisque le héros sombre au fil des rencontres dans une mélancolie qui a envahi la nuit. Heureusement, ici, la fin est plutôt positive, dès lors que le protagoniste échappe in extremis à un destin funeste tout tracé.
Ces tensions continuent de miner la vie sociale libanaise. Son retour s’est fait longtemps attendre, Ziad Doueiri réalisant le film romantique et un peu anodin Lila dit ça sur Marseille. Il retrouve le Liban pour L’insulte, qui s’inscrit pour moitié dans le genre film de procès et qui est au moins très intéressant sociologiquement puisqu’il traite de ce conflit de basse intensité qui règne encore entre les différentes communautés attisant les rancœurs à des fins électorales. Mais encore et toujours des traumas, ici le massacre de Damour, une petite ville du littoral au sud de Beyrouth, bastion du ministre de l’intérieur Camille Chamoun et des milices chrétiennes, par les milices palestiniennes (qui auraient participé, même s’il se pourrait que cela soit la branche al-Saiqa contrôlée par Damas qui ait organisé la tuerie) en représailles la boucherie de Karantina deux jours auparavant, une tragédie plus souvent occultée que celle plus meurtrière mais non moins violente de Sabra et Chatila. c’est par les affrontements psychologiques que refont surface ces conflits avec aussi un contexte politique très réaliste. Doueiri se focalise sur ses personnages et la direction d’acteurs y est encore une fois remarquable. Autant de qualités qui ont assuré un succès populaire, le film ayant attiré 120 000 spectateurs dès sa sortie, ce qui constitue un très beau score au Liban (3ème au box-office annuel).
L’exil et le souvenir des horreurs de la guerre est difficile à évacuer, surtout si au lieu de témoigner, on doit oublier. Raconter, fouiller, creuser l’Histoire, c’est bien le rôle du cinéma. Formé aux États-Unis, Assad Fouladkar y travaille pour Arab American TV et commence à tourner dans les années 80 plusieurs courts et documentaires dont le magnifique premier court-métrage (tourné en Betacam) Kyrie Eleison (1988), emblématique de la situation, c’est à dire du point de vue d’une communauté rurale, ici maronite, sceptique et un peu trop optimiste quant aux “événements”. Le film est un raccourci saisissant du déclenchement de la guerre civile et de la dégradation de la situation de la population civile beyrouthine, où l’on passe à travers les yeux d’un enfant de l’idyllique montagne à l’enfer des abris urbains. Un condensé de la souffrance d’un pays réalisé de façon autobiographique par un jeune ayant perdu sa famille et se trouvant en exil aux États-Unis, dans une très belle mise en scène et un ton d’une grande justesse.
Rentré au Liban, Fouladkar fait de la radio et devient critique de cinéma. Il tourne également des films institutionnels ou des séries télévisées, puis enseigne le scénario et la production. Il tourne enfin son premier long-métrage, dans une économie proche des productions télévisuelles, Quand Mariam s’est dévoilée (2001), film réaliste sur la condition féminine et plus particulièrement sur les répudiations pour cas de stérilité. Le récit est rythmé par les témoignages face caméra de Mariam, sans qu’on puisse deviner ce qui va arriver. L’intrigue est basée sur le retournement du mari qui prend finalement le parti de sa mère et décide de chercher une autre épouse pour avoir un héritier. Le film n’est pas tendre non plus avec l’héroïne qui s’enferme dans son propre piège, en décidant d’aider son mari à lui trouver une seconde épouse. Ils finiront par entretenir une relation adultère au sein de leur propre couple conjugal, ce qui la mènera au bord de l’abyme. Le scénario montre tranquillement comment se dégrade la situation telle que permise par les lois libanaises et commentv la famille et la société conduisent un couple marié amoureux, à sacrifier la femme par lâcheté, paresse et soumission. Un constat critique, basé sur une grande proximité avec les personnages et des comédiens excellents et très investis.
Hélas, Assad Fouladkar ne reviendra au cinéma qu’en 2015 pour Halal love, qui pose à nouveau un regard sur la société libanaise en traitant du mariage, à travers les expériences de trois personnages, un qui divorce, un couple qui trouve une issue à ses problèmes et une femme qui se met en quête d’une seconde épouse pour son mari, ne pouvant plus satisfaire ses besoins sexuels. Une carrière courte, mais néanmoins de qualité et courageuse.
Un cinéma de recherche qui ne faiblit pas
Le redémarrage de la production n’a pas signifié pour autant, et bien au contraire, l’arrêt des cinémas parallèles ou de la vidéo. Il y a un engouement pour une expression vraiment personnelle qui fait toute la singularité de cette cinématographie libanaise, quand chez nous ce sont des secteurs confinés dans les arts plastiques et imperméables au grand public.
Formé à l’Université américaine de Beyrouth en architecture, Akram Zaatari étudie ensuite les arts dans les médias à New-York. À la croisée des disciplines, ses pratiques mélangent le rôle de réalisateur, photographe, performer, archiviste, de théoricien et de commissaire d’exposition. En 1997, il a été à l’origine du festival Ayloul. Dans ses œuvres, il s’intéresse à la circulation des images en temps de guerre, plus particulièrement dans l’après-guerre au Liban. Dance to the end of love (2003) est tiré d’une installation où les vidéos sont projetées sur quatre canaux répartis sur l’écran. Il s’agit d’images filmées par des personnes des Émirats, d’Égypte, d’Arabie saoudite, de Palestine, du Yemen et de Lybie et toutes diffusées via You tube. La première séquence est à la fois drôle et dynamique. Des enfants semblent développer des super pouvoirs et s’affrontent de compartiment à compartiment dans un esprit jeu vidéo très années 80, avant que ça ne se transforme en images de guerre avec lance-roquettes… Par la suite, on verra un culturiste dont le goût pour la performance est mis en parallèle avec des pick up qui roulent sur deux roues, un ado danseur de hip hop, puis plusieurs, aux côtés de compteurs automobiles qui montent dans les tours. Un enfant s’entraînant à la guerre dans le désert. Jusque là, le rapport de force est axé sur les diagonales. Puis c’est une mosaïque d’écrans qui apparaît et on perd un peu le concept, un peu songeurs. Mais il faut resituer ce travail dans la perspective des nombreux travaux de Zaatari réalisés à partir de photographies.
Journaliste et poète né en 1978, Waël Nourredine tourne un brûlot visuel qui s’inscrit dans la « Poésie civile » définie par Pasolini, alliant des descriptions littérales à une critique des situations réelles. Pour lui, « une caméra c’est dangereux. Quand on prend des images, on les capture pour l’éternité, c’est une énorme responsabilité ». Ça sera beau (from Beirut with love) (2005) tente de recréer par le filmage, le montage-collage destructif et l’alliage sonore réagissant aux palpitations de corps sous l’effet du « cheval », mais aussi le conflit permanent qui se vit à Beyrouth et que Nourredine ressent lui-même, jusque dans la structure même de la ville et ces nombreux trous où les explosions trouvent une caisse de résonnance.
Et tout au long de ce court-métrage, comme un fil rouge sanguinolant, la jeunesse se délite dans la drogue au cours de séquences hyperréalistes éprouvantes. Nourredine y filme ses amis, sans jugement mais sans rien édulcorer. Cette violence faite à son corps est-elle pire que la violence d’état vécue chaque jour dès lors que l’auteur les monte en parallèle? Le film ouvre sur une séquence incendiaire et succombe à l’attrait des flammes, à cette esthétique qui n’en finit plus de se consumer. Parce qu’ici, personne ne peut plus aller nulle part, Nourredine se décide à parcourir sa ville en tous sens. Horizontalement avec le traditionnel tunnel beyrouthin si présent dans de nombreuxde films, brutalement vertical, avec ici un effet très immersif de chute pour évoquer celle des corps des miliciens balancés du haut de la tour El-Murr durant la guerre. Nourredine atomise la cartographie habituelle, conservant parfois les tremblements indésirables des débuts de prises, raccordant à la volée sur les ballets d’hélicoptères saucissonant le ciel. Il y a ici une manière, sans doute la plus noire possible de filmer cette tour, plus noire que la célèbre tour de Londres, qui semble peser comme un couvercle sur les immeubles en dessous. Au sol, des manifestants, cadrés d’une façon totalement inédite, participent à la clameur habituelle, exprimée par la musique légèrement décalée. Des miliciens agitent encore leur revolver, symptome d’une folie qui ne veut pas mourir. La longue, très longue, double séance de shoot est suivie d’une vue bleutée, voile de solitude urbaine, bientôt mangée par la nuit.
Produit par Emmanuel Agneray (Les films de l’israléienne Keren Yedaya) et Né à Beyrouth, ce film intense se clôt sur une citation d’Ulrike Meinhof non moins terminale. Le chaos est création. Même si le réalisateur aborde de la façon la plus franche le thème du suicide dans un dialogue en voix-off, le sang et la vitre qui explose de qui se tire une balle seront en tout cas un acte esthétique. Pour un one shot, on peut dire que Ça sera beau (from Beirut with love) s’imprime pour longtemps dans l’incosncient des spectateurs.
Du côté des vidéastes, de nombreuses réalisatrices passent à l’action. Caroline Tabet grandit à Montpellier où elle commence sa carrière de photographe, monte à Paris, puis revient à Beyrouth en 1993. En 2000, elle crée le collectif ART.CORE dédié aux musiques électroniques et au cinéma expérimental et passé à la postérité pour ses performances. Le court Stock témoigne de cette recherche minimaliste à partir du duel image vidéo / son. Son premier court, Faim de communication (2002), sort en 2003 dans le film omnibus Lust, entre cinéma indépendant et cinéma expérimental. Son travail photographique avec Engram peut-être apprécié dans le diaporama 290, rue du Liban (2012) sur l’histoire d’une maison beyrouthine et la mémoire des lieux.
Née en 1973, lauréate du prix Gilles Dusein en France ou du Uriot prize en Hollande, Nesrine Kodhr poétise l’intime et crée des séquences à la fois fortes et personnelles. I swam in the sea last week (2003), à la fois sublime visuellement et presque anodin en terme de représentation, traite dans un format très court, du changement à l’œuvre dans le corps d’une femme nageant dans l’eau. Lastfall (2006) raconte en quelques images brèves un premier plongeon dans une piscine, focalisant sur la mécanique du corps et sur la tension musculaire, moment très précis d’une vie, court et intense, le tout saisi en quelques plans très sobres en noir et banc, à dominante grise, où ce qui compte finalement, c’est la ligne que l’on dessine dans l’espace. À l’opposé, les lieux et les éléments l’inspirent. Que ce soit la rue al-Hamra (Ain al-Hamra, 2000), saisie du haut de son balcon, d’où elle s’arrête sur un trafic incessant, enregistrant les réactions d’incompréhension quant à son travail et à la notion même de ce que doit être un film. C’est du reste le meilleur tableau et le plus personnel de ce grand axe. Côté éléments, c’est le climat avec ces tempêtes filmées à travers les baies vitrées d’un immeuble de Beyrouth (Untitles -12 scenes of a disaster, 2008). Enfin, elle aussi a parlé d’exil (autant intérieur qu’extérieur) dans Enclosures (2004).
Née à Beyrouth également et d’un an plus vieille, Lamia Joreige est une des plus importantes figures du cinéma libanais expérimental et de recherche, tout en étant une artiste transdisciplinaire (écriture, peinture dont on sent l’influence sur le magnifique Beirut 1001 views, photographie, installations). Étant particulièrement axée sur le travail de la mémoire, elle utilise notamment l’archive, pour faire ressortir la violence des actualités libanaises durant la guerre civile. Dans le fascinant Nights and days (2007), elle reconstitue un genre de journal intime de guerre, puis dans la seconde partie montre les destructions au sud Liban. Elle s’y focalise notamment sur les détails qui font signe de la guerre en cours. Here and perhaps elsewhere (2003) s’attache à la mémoire des disparus suite aux enlèvements des deux côtés de la ligne verte. Elle a ensuite consacré A journey (2006) à l’histoire de sa grand-mère.
Pour Full moon (2007), elle creuse sa propre mémoire visuelle et sensorielle, tentant de retrouver les conditions d’une vision de la Lune aperçue sur la route, une vision qui suspendit le temps. Elle se met donc en tête de refilmer chaque soir de pleine lune, un même travelling voiture et ce durant plusieurs années, pour retrouver ce moment poétique, crucial dans son parcours personnel et artistique… Dans la même idée, elle réalise Sleep (2004) pour une exposition, où la répétition d’un même moment, toujours rejoué mais légèrement transformé, crée un rythme flottant, un halo propre aux perceptions durant le temps de sommeil. Tourné avec Ghassan Salhab acteur, Embrace (2004) est un fascinant exercice de style où une situation (un homme embrasse une femme assez violemment) devient de plus en plus ambiguë dès lors que la caméra s’en approche. Elle peut aussi réaliser des documentaires plus traditionnels comme Objects of war (2000), où des personnes témoignent à partir d’un objet, parfois iconoclaste, qui a pour fonction de raviver leurs souvenirs de la guerre. Lamia Joreige a aussi tourné avec les Films d’ici, la fiction And the living is easy (2014), une vision de Beyrouth à travers plusieurs portraits d’habitants, afin de capter la tension ambiante dans le calme apparent de 2011.
Fondatrice du collectif Polycephaly, Lynn Kodeih est une artiste passionnante qui mélange performances basées sur des lectures et différents niveaux de textes s’interrogeant sur la normalisation de la violence. Elle s’intéresse particulièrement à la capacité des mots à générer des images, à la vidéo et au son, au futur comme aux mythologies. Deux ex machina (2015) contient à la fois une réflexion sur cet événement imprévu qui bouleverse le cours d’une histoire. On y entend d’abord dans la chanson Il était un petit navire, que le narrateur va toujours « la-la-la-la recommencer » des fois que le sort frappe enfin le jeune mousse. Puis cette figure se retrouve dans l’histoire du tableau Le radeau de la Méduse de Géricault. Ici les flots méditerranéens sont sombres et agités, fluent, refluent, se jettent les uns contre les autres. L’atmosphère est électrique. Lynn kodeih apparaît comme une vision gothique, la lectrice vampirisant l’image malgré son ton laconique. Il y a par ailleurs ici un travail abstrait de représentation des corps, de l’enfance, du sentiment maternel, d’abord dans d’impressionnantes images en noir et blanc étirées et floues, puis à même la chair rosée d’un bébé fantôme qu’on lave. S’ensuit une plongée dans l’inconscient maternel, comme un ventre-prison, un liquide amniotique encombré de créatures aquatiques accompagné d’une bande originale grave. La naissance, « cursed », est celle d’un de ces animaux chers à Jean Painlevé tant il est vrai qu’ « il n’est pas possible de donner la vie en temps de mort » sans créer de démons. Et toujours cette impression d’être piégée dans l’espace temps, dans une sublime animation à l’aquarelle, comme des toiles de Zao Wou-Ki infusant dans la Méditerranée pour se transformer en marines 19ème, ramenant la voix qui en revient elle à la mythologie grecque et à Lamia, mère des mères, pour mieux replonger dans les flots recouvrant peu à peu le champ dans le fracas du monde. Un film d’une force plastique exceptionnelle. On n’a jamais vu la mer à Beyrouth filmée de cette façon ailleurs.
À l’opposé de son titre, 160 feet under pure blue sea s’intéresse aux significations possibles de la narration à partir d’un sentiment de perte. Perte des souvenirs d’enfance et de leurs images qu’elle tente de retrouver dans des images d’archives familiales. Ainsi, il est selon elle (entretien avec Barbara Coffy) possible de réécrire l’Histoire à partir de ces histoires individuelles, en prenant pour base ici une polyphonie de voix récitant un même hypothétique récit, dont chaque mot paraît pourtant éloigné. Ce que deviennent les mots après avoir été dits, les images qui ont été tournées et les sentiments éprouvés, c’est ce qu’elle tente de recueillir dans des corps réceptacles (qu’elle considère comme abritant la psyché), corps d’enfants, de baigneur.euses dont certains ne finissent jamais de tomber. Comme chez Salhab mais très différemment, il y a ici des évènements parallèles qui se croisent, se superposent. Un autre axe de son travail, c’est l’utilisation de la mémoire audiovisuelle pour Of heroes, Football and all that remains of my childhood (2012). Un film qui se demande ce que signifie être « révolutionnaire » dans une génération arabe où absolument rien ne change au fil d’un montage d’extraits de dessins animés, avant d’en venir à l’ahurissante émission pour enfant prêchant le martyre aux pieds d’une animatrice mielleuse et émerveillée, perverse, sorte de Martine Jacques à L’école des flammes. Un travail par ailleurs autobiographique et intime qui ressucite les croyances utopiques de l’enfance.
D’origine libano-arménienne, Chantal Partamian vit et travaille à Québec. Elle a produit beaucoup plus récemment quelques films intéressants souvent sur une base de films en super 8 qu’elle a tournés ou récupérés comme pour Tekrar sur la répétition d‘images et de sons de la guerre à travers les actualités. L’arbre (2021), une lettre de réclusion a posteriori, fixe l’image sur une pellicule usagée, d’un arbre observé durant de longues heures confinées. On peut citer aussi Beirut son fragment du film collectif 14 reels. Sandjak (2021) est une tentive de déconstruire l’espace du camp de réfugiés du même nom près de Beyrouth, où les fragments de trois périodes temporelles se superposent, bien dans la manière libanaise. Elle a tourné en vidéo Houbout (2020), sur les débris d’une relation à distance (« Être queer et suspendu entre les États et États-nations. »). On lui doit aussi des documentaires (Epistemic space).
On peut également citer le couple Rania (réalisatrice en solo du court de fiction Al-Sahen en 2008 et du documentaire Notes on love in Copenhagen en 2011) et Raed Rafei, plus particulièrement ‘74 (La Reconstitution d’une lutte) (2011), long-métrage hybride et expérimental primé au FID de Marseille, qui évoque une lutte étudiante vue à travers les yeux de jeunes militants d’aujourd’hui. Le couple a réalisé de nombreux projets vidéo (Prologue toujours en 2011, City rehearsals en 2021), des installations (Le purgatoire, en 2014). Rania Rafei est lauréate du projet NAFAS et prépare actuellement un second long-métrage.
L’underground s’exprime !
Enseignant, homme de télévision et brillante plume pour le mensuel Noun, Johnny Karlitch commence à réaliser des documentaires en 1995 pour le ministère de la Culture.
Début des années 2000, il passe à la réalisation de projets beaucoup plus personnels, que ce soit au cours de brefs voyages hallucinés dans la subculture libanaise (la fulgurance de plans volés dans Voyage 1 : Lumi/Lilly) ou empathiques chez les déshérités. Il y a aussi ce court-métrage, Aquarius (2002), tourné avec une caméra MiniDV qu’on sent totalement cinématographique et en même temps tellement littéraire. Une créature mythologique, une sirène, Athéna peut-être, sort de la mer pour venger la mémoire des victimes de tous bords (Karlitch croit aux mythes, il en est aussi question dans son Huitème passager à la forme de conte). Une conscience, un pur esprit sur lequel les automobilistes maléfiques de Beyrouth n’ont pas de prise. Armée d’un révolver ou d’un briquet, de sa répartie, de son culot et de sa tranquille assurance, elle va, seulement mue par cette unique quête. Un « être nouveau » comme le définit l’auteur.
Aquarius est ce drôle de revenge movie qui change les hommes en bêtes. Rémanence : les vagues avec au centre un corps qui s’y noie. Une femme surgit du fond de la nuit, le pas tranquille. Une allure provocante et surtout souveraine, car comme le dit le metteur en scène de son cours de théâtre, « c’est toi qui décides de cette matière qui t’environne ». Une situation qui se répète chaque soir, comme un cauchemar, jusqu’au climax dans une arène, où le bourreau est terrassé par les souvenirs, ce miel au goût de sang, les ombres, le remord ultime. Et pour tout acte politique,ces crétins de toujours, en meute, la rue, qui encouragent la souffrance d’autrui. Toujours la jungle… Alors comme disait Hojeij, « que vienne la pluie », ici en épiphanie… Des références de film noir, fut-il almodovarien, mais aussi en Mulholand drive jusqu’au grand Vertigo, planent sur ces « humains » et nous démontrent que ce Karlitch est d’ailleurs, exogène au Liban.
Où est parti Johnny Karlitch ? Avalé par l’autre côté comme un fantôme japonais dans Lost in Lynch? Chemine-t-il sur la ligne médiane en pointillés de la Lost highway, survolant en état de grâce son pays martyrisé, éreinté ? Comme lorsqu’il en capturait des instantanés comme personne dans Beyrouth, coeurs et corps (1999), documentaire autoproduit, libre, habité par les forces de la création, guidé par la morale, une philosophie et surtout, comme Pasolini, armé de la poésie.
Et pourtant, si présent comme va le montrer son parcours documentaire, marqué par une exemplaire sobriété. Ingrédients de Waiting for Mr arbitrary (2007) : force des témoignages, commentaire réduit à quelques intertitres muets, situations du quotidien de familles campant devant le quartier général des Nations Unies pour alerter sur l’incompréhensible : avec les accords de Taef, la Syrie s’est retirée mais a gardé dans ses geôles toutes les ressortissants libanais enlevés en zone occuppée. Vingt ans plus tard et plus, comment vivre l’absence de ces proches, celle de réponses, de soutien politique ni même humanitaire (les institutions internationales brillent tout autant par leur absence qu’un gouvernement libanais qui a préféré l’éloquence d’une interdiction totale du film, avouant par la même sa collusion avec l’ex occupant syrien). La caméra de Karlitch est une arme de témoignage, sobrement en phase avec leurs unique moyens : la lutte, la solidarité. Dignes militants d’une association pour nouvelle famille dans ce pays carnavalesque au simulacre d’état, vassal du sanguinaire Bachar : pour avoir soutenu les palestiniens ou l’être encore une fois, pour être passé par l’Irak, ces vies brisées témoignent de la violence d’un des pires régimes de la planète et par conséquent de l’absence totale de souveraineté comme de démocratie au Liban. Les témoignages l’avouent : les israéliens sont moins pires, c’est dire…
Karlitch filme le temps qui passe à côté, les gestes dérisoires d’un quotidien depuis trop longtemps enraciné dans cette zone de non droit, la pluie qui s’abât sur le square Khalil Gibran. Dix ans se sont passés depuis la révélation de l’ampleur des kidnappings dans le documentaire du même nom, Kidnapped (1997) de Bahij Hojeij. Il y a sans doute peu de chances que les geôles de Bachar libèrent des êtres humains en état de fonctionner à nouveau en société. Mais cette idée, Mahmoud, le boucher citoyen d’une Egypte indifférente au malheur qui a pourtant touché certains de ses ressortissants, serait bien incapable de l’accepter. Sa nouvelle famille continue à l’entourer. Alors le film l’immortalise dans sa résistance et sa dignité. Un sentiment d’impunité et hélas d’éternité, passe comme dans les films du chinois Zhao Liang (Pétition, la cour des plaignants).
Karlitch a ensuite réalisé Un jour de juillet, banlieue sud de Beyrouth (2006), puis le documentaire sur un centre désintoxication Une dérive vers la lumière (2011). Il expose ses photos et a publié plusieurs romans de Science -Fiction. Un électron libre et une personne essentielle à la vie culturelle libanaise, de par sa capacité d’indignation, sa liberté d’opinion, de ton et la recherche permanente d’une expression po-éthique unique et éveillée.
Il a aussi justement intitulé un article de 2009 sur Christophe Karabache, « La pureté du regard ». Au mépris de la critique établie qui le lui rend bien, ne voyant là que provocation passée de mode, « complaisance pour le vide » (Dr Orloff), « Brouillon (…) et bien trop précipité » (Critikat) , « moments bien réels arrachés à l’artifice d’une fiction assez faible » (le Monde, Sandrine Marques), quand il exorcise de manière plus qu’évidente, urgente, un rapport brutal à la patrie originelle. « Cruellement, brutalement, naturellement, les choses de la vie sont là » constate JK. Une conséquence inévitable pour une personne ayant perdu ses parents à l’âge d’un an dans un attentat à la voiture piégée. En voilà du vide. Le futur cinéaste allait alors être éduqué par une tante hystérique et on peut concevoir qu’élaborer son langage cinématographique découle de cette incommunicabilité pour toute référence.
Ancien membre du collectif expérimental français L’Etna créé en 1997, les premiers courts-métrages sont exemplaires de sa démarche : concilier une mémoire morcelée, des traumas individuels, familiaux et collectifs, arpenter les frontières… « En faisant du sampling créatif, Christophe Karabache marquait ainsi son territoire sémantique en se réappropriant le langage du cinéma, pour le déconsruire, le désintégrer exprimant un tempérament dadaïste qui a su se manifester virtuellement sur le plan de la représentation » écrivait avec justesse Johnny Karlitch à son sujet dans un premier article de la revue Noun en 2008.
Luttes (2003) propose des prises de vues extrêmement fortes et dérangeantes réalisées durant la guerre civile et les confronte avec des images militantes, pas seulement libanaises mais françaises également, opposant leurs conséquences aux idées de départ (« révolution essentielle »). Dans Distorsions (2003), le cinéaste travaille à nouveau la tension entre des images de la guerre civile, le regard qu’on leur porte quelques décennies plus tard et leur restitution, l’image télévisuelle et son grain quand elle est refilmée, recinématographiée. C’est l’hypnose de la croix de malte dans un précipité de gravats libanais, ça gratte jusqu’au sang, mais captive. Suxion propaganda (2005) est une essai expérimentalo pornogaphique dont la crudité et la frontalité obligent le spectateur à réagir, bien dans la manière d’un autre membre de l’Etna, Lionel Soukaz. Cette obsession sur le corps et sa maltraitance, notamment celui des femmes, va devenir une constante de ses longs-métrages ultérieurs.
Kinoptik : transit Beyrouth-Paris (2005) est cette fois une succession de tableaux à l’effet chamanique où est mis en boîte le rapport entre l’homme et le chimpanzé, le contact avec les morts et le passage au mixeur de l’archive pour déclencher une guerre audiovisuelle avec solarisations et larsen ultime, dont le but est d’en finir avec le jugement de Dieu, grâce à une extraordinaire voix off qui redonne sa pleine puissance au texte d’Artaud. Si le cinéma de Karabache est plus tourné avec l’infime dedans, c’est que le dehors, le Liban, a une forte propension à sa propre finitude ! Et si Dieu est de la merde, ce cinéma là assume sa matière fécale jusqu’au trop plein et à la logorrhée, afin de mieux célébrer par le rituel. Un film d’ailleurs dédié à Jean Rouch.
De Zone frontalière (2007) à Wadi Khaled (2008), Karabache confesse filmer toujours le même coin de désert. Zone frontalière est réalisé seulement six mois après le cesser le feu. Il porte partout ses stigmates, mais d’opérations militaires on ne verra que celles reconstituées avec des chars en carton par le cinéaste lui-même, onomatopées à l’appui. Pour le reste, considérations politiques, économiques ou juste surréalistes et plus besoin de choisir entre la fourchette et la cuiller, Karabache, on prend ou on lèche… Sa vie nocturne, symbole du Liban partout ailleurs, est totalement sous exposée, ridiculisée par la philosophie d’enfants en attente du grand incendie final comme partie intégrée de leur vie. Le finale, hallucinant de révolte et sa répression militaire, dit tout d’un pays qui porte sa propre frontière en lui. Car les frontières étant signes de guerre, pas de paix intérieure dans le monde du grand délabrement. Il y a, il y aura toujours ceux qui décapîtent les poulets et ceux qui non. Cette tranche d’émeute est génialement servie sur une ballade accoustique, Dojjè dojjè (ou du bruit, du bruit) par la mutine Rana Keserwany, accompagnée à la guitare par Charbel Khoueiry, chanson qui en dit plus long que les extraits d’opéra précédents.
Christophe Karabache ne doit d’autre que la vie et une origine à ses géniteurs. Il ne doit à Jean Rouch que la volonté de faire des films, et le discours de la méthode. Il peut donc se moquer à saciété du documentaire ethnographique à relents colonialistes dans Wadi khaled, hilarant pamphlet qui est pourtant œuvre documentaire. Enfin, peut-être ! Car la voix off, à la prosodie exceptionnelle, sublime et extrapole ce que l’on voit à l’image. À tel point que lorsqu’elle se tait, nous pressentons aussitôt le pire (la caresse sensuelle d’une chèvre et cette fois le geste ambigu semble confirmer la situation). Qualité du super 8 oblige, rien n’est si clair qu’il n’y paraît. Le mouvement n’arrange rien, le cinéaste filmant souvent à la volée. En fait de trafic d’armes, on ne verra que deux types et une kalashnikov, l’un transportant l’autre dans une brouette, une séquence pathétique dont le charme doit beaucoup au montage et aux raccords heurtés. Et enfin des baraquements de fortune sur la plage, bien réels. De ce lieu, terre réelle de non-droit, nous n’avons à peu près rien vu de son « cri avide d’une terre en sang », seulement un écho et ses traces, l’état de guerre habitant un libanais de l’après-guerre et sans identité.
Beirut kamikaze (2010) clôt peut-être une première partie de carrière centrée sur le chaos créatif, le brassage des images et une écriture toute personnelle. Une première séquence très forte met en parallèle un combat de coq et des affrontements de rue, puis des photogrammes guerriers. Les raccords sonores agressent volontairement l’auditeur, comme pour mieux réveiller les morts dans ce voyage parmi les ruines, rythmé avant tout par le chemin de croix terroriste d’un gars portant le fuselage d’un obus. Trace = carcasse. La caméra dépèce la ville quand le montage rapièce, Karabache alternant entre immeubles détruits et d’autres pas, des quartiers pauvres tagués « mafia » où le cameraman est pris à partie par des enfants et les hurlements off qui emballent la caméra dans un râle cinétique. Le réalisateur cite Artaud, Fassbinder, joue à filmer des enfants qui jouent à la guerre pendant la « guerre civile froide » (expression du poète et journaliste Bilal Khbeiz, cité par Dima el Horr), seule différence avec les mômes de Mai Masri ou Jocelyne Saab. Ce chaos résonne de poèmes dont l’un entend construire un navire « sans identité, fabrication locale ».
À mi-parcours, le film tente un résumé très subjectif des massacres pour mieux l’achever façon post punk avec deux filles délurées massacrant au marteau et au couteau des barbies dans une scène plus choquante que marrante. Christophe Karabache filme comme il respire. Fort. Difficilement. Fasciné par une gare routière fantôme, tableau incroyable de décrépitude et d’abandon mais où la végétation reprend ses droits comme jadis les chats et les chiens dans les décombres fumantes de la guerre civile. Les fantômes, c’est peut-être une belle fille solarisée, négative, étrangère au sexe et persuadée que le créateur existe. Ce créateur serait-il renard pâle du chaos beyrouthin ? Alors l’auteur de « vomir » sa nationalité, l’individu de s’extraire du troupeau comme dans cette séquence folle où un type qui ne l’est pas moins en fauteuil roulant, demeure indifférent au trafic routier qui le cerne de toutes parts. D’une menace à l’autre, Christophe Karabache, vautré nu dans un appartement boit pour oublier cette guerre qui gronde encore, sorte clameur-acouphène qui ne s’arrête à peu près jamais, comme ces jeunes libanais qui chient sur leur pays et lui préfère la drogue et à l’image un Kirie eleison trouvant son acmée sur la charogne dilatée de quelque rat géant. Une vision monstrueuse et inédite de Beyrouth, un cinéma qui agresse et secoue l’indifférence. « Agir avec un cinéma féroce, sauvage, vulgaire, barbare, brutal, médiocre, mais qui vibre la vie ! ». Personne ne peut contester que ce pari soit tenu.
Deux ans plus tard, « Christophe Karabache cogne passionnément sur sa ville natale comme sur les codes du cinéma usuel (…) Avec ce Too much love will kill you (2012), Christophe Karabache offre à Beyrouth un chant d’amour et de dépit. Amour d’une ville vibrante, riche d’histoire, d‘énergie, de fierté et de paysages lumineux. Dépit d’une ville ravagée par la violence, les conflits, la démesure de la reconstruction forcenée et des sentiments exacerbés. En collant sa caméra face à des personnages en crise, le cinéaste fait surgir le chaos qui secoue les fondations de la société libanaise. » (Michel Amarger, Africiné) Le portrait de cette ville passe à travers le regard parfois plein d’humanité, mais aussi désabusé et inquisiteur de la jeune femme russe jouée par Marina Kitaeva, venue à Beyrouth pour travailler dans un cabaret et se retrouve sous dépendance affective de son patron et proxénète, joué tout en puissance par le réalisateur himself. Leur relation borderline, autrement dit qui n’en est même pas une mais juste une enfilade de moments, constitue tout d’abord l’un des beaux points du film comme dans cette incroyable scène où Karabache qui doit en avoir long à expulser, vomit pendant qu’elle fait des vocalises lyriques. Cette bizarre harmonie est en permanence dérangée par le tumulte du monde extérieur. Les mêmes jeunes moitié-drogués, moitié racaille, les bagarres de rue qu’ici on jurerait documentaires, des vues de Beyrouth qui comme toujours chez Karabache n’ont rien à voir avec le Lonely planet, ni avec le petit futé des plans branchés, mais avec la vie même : embouteillages sous un pont, plan récurrent d’une façade vérolée par les impacts de balle.
Il faut se donner du temps (45 minutes plus précisément) pour que l’entreprise de décadrage de l’auteur agisse sur nos sens, lorsqu’il n’est plus nécessaire de comprendre sa démarche puisqu’on la vit enfin. Pami les plans rémanents, cette angoissante carte postale hivernale où un malabar cagoulé dépèce des cadavres au couteau. Quelques plans hystériques ( l’ancien amant du début, elle à moitié bourrée) et la fiction lutte avec la réalité d’une ville qui toujours la dépasse. De nombreux commentaires n’ont pas du flatter les libanais, tancés sévèrement, leur fierté mise à mal : « au Liban, il y a beaucoup d’impuissants » dit une belle femme bien en chair dont le fantasme est d’être violée par plusieurs hommes et donc condamné à rester inassouvi. « Je vais pisser sur la tombe de tous les martyrs » provoque le patron dont le cabaret vient d’être victime d’un attentat, les précipitant dans le chômage technique. D’où ce violent désir de castration ?
Le charme de Beyrouth n’est pas tout à fait absent mais diffus, comme cette skyline bleue en fond d’écran derrière la fille et le littoral, notamment celui du sublime plan final (où l’on croit reconnaître aussi la patte de Johnny Karlitch, un des trois opérateurs du film). Fiction encore et toujours trahie et contrariée par la réalité comme dans ce très beau plan où le couple se tient dans la moitié gauche du cadre, l’autre étant d’une blancheur léthale, pendant qu’en voix off s’égraine la lithanie des actualités d’une guerre qui ne finit jamais. À l’inverse, l’imbrication de plans volés dans le récit fictionnel entraîne notre perte de repères, le temps se dilatant volontiers dans la deuxième partie où l’errance moderne de la femme pourrait à voir avec les chambres de l’imagination de Sharunas Bartas (The house) ; celle de Karabache est plus malade encore et la fin emporte tout comme un torrent (elle se masturbe avec la carcasse d’une tête de mouton ensanglantée et ça n’a rien de complaisant, c’est simplement une autre manière de vivre son calvaire, n’en déplaise à la censure qui a interdit le film aux moins de 18 ans). « Nous pouvons nous suicider et nous pouvons rêver… »
Les longs-métrages de cette époque de Christophe Karabache sont paroxistiques. Autistes, ils traînent, travaillent l’ennui, sécrètent le néant social et bien évidemment politique (dans un geste paradoxalement éminemment politique, ça va sans dire), mais comme la mayonnaise, finissent par nous prendre et il est impossible d’échapper à l’apothéose. Assaut mental… Plus destructuré encore que le précédent, Dodgem (2013), dont le titre fait référence aux auto-tamponneuses dans un anglais ancien (selon l’auteur!), insiste sur la cohabitation impossible d’une modèle espagnole bloquée malgré elle à Beyrouth et dont on épouse assez souvent le point de vue et un travesti (lui même interprété par un danseur assez proche du personnage). Des scènes externes, notamment une agression dans la rue par un gars cagoulé et pratiquant le lance pierres sur ses victimes, qui semble venir ici avec la thématique syrienne, et celles d’une femme qui ouvre et réouvre son magasin de lingerie, éléments de décor d’une ville sans queue ni tête et d’un récit œuvrant à sa propre démolition. Ce qu’il en reste, ses oripeaux, insiste sur la relation triangulaire désagréable, car carburant au mépris et à la provocation gratuite et souvent violente, où l’amant du danseur passe sur lui ses humeurs sadiques, ce qui a pour effet d’exciter la collocataire. Des déclarations politiques bien senties ne sont là qu’en tant qu’alibi, pour susciter la punition par le viol (« les gens de ce pays meurent comme des mouches… »). Le travesti se défoule à son tour en tirant sur les passants, bien qu’il pourrait aussi s’agir d’un phantasme, au contraire du meurtre bien réel qu’il accomplira plus tard.
Il n’est pas tout à fait juste que les scènes ne fassent pas sens et que la narration ne s’en aille pas à l’inéluctable comme le veau à l’eau. Mais les temps forts sont souvent hors champ (le meurtre au couteau de l’amant). Nous devons cohabiter avec notre propre angoisse et notre impatience. Ici la scène qui représente un pallier dans le film est cette espèce de fête dégénérée et animale entre eux deux (une performance d’acteurs dégueulassement folle), sensuelle mais au final impossible, bien que nous autres, incurables, désirions secrètement voir apparaître une histoire tout en sentant confusément, physiquement, qu’elle ne pourrait que s’y fracasser avant même d’être née. Ce serait beaucoup s’avancer que de voir ici un symbolisme chrétien avec ce travesti en slip et sa dégaine de Jésus, être androgyne, innocent et meurtrier, bourreau et victime. La fin nous emmène dans un espace mental désolé, propre à l’être social privé de société car ouvrier de son propre anéantissement. L’incommunicabilité minérale vécue dans Twenty nine palms de Dumont (long et magnifique plan d’« enterrement » de tout ce qui précède ce moment), la solitude existentielle propre à l’enfant éternel de La cicatrice intérieure (dont toute psychanalyse est au contraire ici impossible puisqu’en guise de mère, il n’y a que la terre, ce serait trop facile !), l’individualité et la glace, le traumatisme bloqué, permanent avec ce plan final fou furieux qui revient à la charge et cette fois, semble ne jamais nous lacher. Définitivement désagréable, éminemment passionnant, divin marquis de Karabache !
Lamia (2014) paraît ensuite presque « adouci », les ellipses moins abruptes, les fosses psychogiques accueillant plus aisément nos interprétations, son trio fils-mère-amante plus lié. La narration y coule presque de source, de scènes clé en scènes clé (l’allaitement d’un poisson, un viol incestueux assez éprouvant et troublant, un meurtre « tranquille », organisé, une violence chorégraphiée et spiritualisée, le meurtre brut, simple, d’une prostituée). Les personnages sont peut-être plus « attachants », telle mère muette, telle jeune femme frustrée par un mari, aussi proportionnellement violent qu’il est impuissant. Et les plans sont souvent faramineux : hurlement muet et trouble de la mère entre Bacon et Munch, gros plan sur surimpression de ciel nuageux digne de Dreyer. Pour preuve, le finale constitue bien une montée mais avant tout esthétique puis émotionnelle avec la longue danse langoureuse finale. Lamia emporte tout sur son passage et peut être vu comme la fin d’un cycle infernal chez le tourmenteur Christophe Karabache.
« Tu as vécu et ta caméra avec toi »
Nadim Tabet, lui aussi exilé en France, fut d’abord l’âme de Né à Beyrouth cofondé avec le producteur Pierre Sarraf, structure de production et de programmation audiovisuelle autour du festival éponyme né au début des années 2000, qui fit la part belle aux courts-métrages de création et célébra la créativité libanaise mieux que personne. Jeune prodige très tôt productif et créateur d’images cinétiques hallucinées passant du super 8 à la DV, Tabet poursuit aussi une sorte de fantasme littéraire qui semble courir de Martine et Alia (2001) en passant par son adaptation de Proust (Violante, 2005) à A day in 1959 (2012), addict à une recherche visuelle très contemporaine à travers ses vidéos de mode (l’extraordinaire Full moon, avec Lili Marleen et la beauté fatale de la mannequi Eniko Mihalik) ou côté plus zen, des vidéos d’inspirations plus musicales ou des clips.
Réalisé à seulement 19 ans, Martine et Allia (2001) filme le quotidien dans un noir et blanc arty et neigeux et un ton très Nouvelle vague, de deux jeunes femmes en compagnie du dénommé Philippe. Plus proche de l’esprit Jules et Jim, la mélancolie en plus, le constat « on est libres en fait » ne créant pas de joie particulière. Le scénario pointe même l’artificialité de ce dialogue en français rejoué dans un arabe qui sonne déjà plus juste. Le film se présente presque comme un journal intime ou une chronique tant ces séquences sont bousculées soit par l’irruption du réel (une analyse politique de la situation par un chauffeur de taxi lucide) et que Nadim Tabet pousse parfois au tremblement jusqu’à un impressionisme documentaire, soit par des vues saturées de couleur et tournées en super 8, façon monde d’avant et Dolce vita en temps de guerre civile, qui rendent le bleu plus profond et la Perle de l’Orient plus blanche et aveuglante. Dans un geste méta, le récit intègre sa fabrication même, dans des scènes où apparaît entre autre le cinéaste lui-même dans ce qui semble être le casting ou des entretiens de travail. On imagine donc que la réécriture au montage avec Michel Tabet a pu être prépondérante, la musique jouant également un rôle important dans la narration, tout comme le son avec Charbel Haber, musicien, performeur et artiste visuel qui deviendra son collaborateur privilégié.
À ses débuts, Nadim Tabet essaie toutes sortes de choses parmi lesquelles le blog filmé (un parent des Carnets filmés de Gérard Courant) dans L’arche de Noé (2003), placé sous le sceau d’un de ces philisophes du quotidien, autoproclamé « roi de mars ». « Filme ce que tu peux, tu es dans le pays de l’Humanité »… Autre manière que celle de Karabache de dire « Tu es dans la merde ! »… Une manière plus littéraire donc, enfin comme on jette ses pensées sur la page ou ses notes de visionnage, la musique ayant ici pour fonction de chapitrer et d’opérer une sélection naturelle. Au rythme de la vie qui s’écoule à l’envers pour une Sonate au clair de Lune, Tabet passet très librement d’une séquence à l’autre, d’un rituel à un traumatisme collectif, jouant sur tous les tableaux de chaque rive de la Méditerranée. Ainsi, à la manifestation tricolore effrayante sous l’Arc de triomphe de l’étoile avant le second tour de l’élection présidentielle de 2002, les vociférations des Lepénistes sont vite couvertes par le rejet massif et joyeux des opposants (une autre époque…). Puis par les soutiens aux Palestiniens, de plus en plus jeunes et agressifs dès qu’on s’approche du territoire meurtri (l’appel à l’aide lancé au Hezbollah « ce n’est pas une guerre, c’est un massacre ! »). Mais toujours aussi important chez Tabet, la danse pour conjurer le sort, celle d’une jeune blonde aussi énigmatique que celle du regard caméra de la Lettre à Freddy Buache. Puis le jargon de Bobby Lapointe pour pointer le tragique et absurde de toutes nos peines (rappelons toutefois qu’il s’est suicidé !). Parmi les motifs, émergents, cette fille au couteau à la maigreur et à la pâleur mortelle dans les ruines antiques (Baalbeck?) et qui tisse un lien occulte avec l’héroïne de One of these days.
Dans Printemps 75 (2008) (ou Une famille libanaise), on assiste déjà à une scène fictionnelle (film tourné avec les Films Pelléas et parrainé par Olivier Assayas avec le quel le cinéma de Nadim Tabet a entretenu il est vrai quelques atomes crochus !). Tout repose sur la simplicité de trois séquences et d’une seule action, faire disparaître un cadavre, une scène à la Harry chez une famille notable libanaise bouleversée par les « événements », ou le début de la guerre civile lorsqu’un milicien s’introduit chez eux et que le père joué par l’immense Mohamed Chahine l’abat. Face à lui avec sa douceur maternante, Danielle Arbid pour un court où l’on sent plus d’incarnation que le récent film de Chloé Mazlo, même avec l’esprit qui règne avec ce couple ami (excellent Hassan Zbib) apportant un peu de décalage dans le drame avec cet étonnant passage de rires au ralenti. Il y a aussi une certaine critique vis à vis d’un gauchisme à la mode, il est vrai que ça n’allait pas toujours durer. « La guerre fut une occasion de critique pour les intellectuels, une réponse directe et concrète. Tout l’héritage intellectuel que l’on avait reçu était remis en cause. Les courants nationaux, gauchistes, la droite et la gauche qui ont dominé la vie politique libanaise pendant des années, tout ceci était remis en cause. Ces courants sont tombés par terre. En observant les polémiques et les destructions, la critique concrète de la réalité, le déroulement de la guerre a permis d’abattre toutes les idéologies. Il n’y avait plus rien. On se moquait de tout : de soi-même, de son passé, du patrimoine, de notre héritage, de l’esprit, des sentiments… » racontait le poète Abbas Beydoun (entretien avec Amélie Arnaudet). La pensée critique raccorde donc avec celle désabusée de la génération Bagdadi et c’est également en poète que Nadim Tabet termine cet essai, sur un plan de nature somptueux, un des plus beau de sa filmographie et digne de ceux, habités, d’un Brisseau période Céline.
Avec A day in 59 (2012), Tabet illustre un texte qui s’est absenté après une simple observation, « Le temps est chaud ». Tout est dit. Il est bien question de mémoire, mais seul l’anodin demeure, hormis la conclusion qui est déjà revanche, affrontement des mâles et guerre de classes. La distanciation passe à la fois par le traitement vintage de l’image, un peu à la manière du Miguel Gomes de Tabou. Ils ont aussi en commun une certaine ironie, ici très léger décalage quand le plus fort tient dans l’accompagnement musical, son choix, son volume. Les affres du mariage, sa rengaine, seront donc chroniqués et passent dans le vertige de la posture et du regard de Raia Haïdar. La beauté habite les moments creux, le crime n’est même qu’une simple virgule dans le trajet de vie de ces privilégiés, un temps mort. Presque un moment d’histoire sociale revue dans une perspective féministe sous couvert d’une sieste musicale.
Tranquillement, son cinéma mue vers une nouvelle peau. Cette fois, les visages et les carnations occupent l’espace sans rompre ce dialogue des muses engagé depuis les débuts, une nouvelle collaboration pour Summer 91 (2014), cette fois réalisé avec Karina Wehbe. Il y a toujours des intermèdes, et surtout l’un d’entre eux d’un beau fétichisme rock et cuir et l’extraordinaire beauté plastique de chaque plan, utilisant les flous, les aplats, la matière même de l’image, creusant à même la ville, dans la profondeur. Une sacrée maturité visuelle. La concrétude où la création devient preuve de l’existence de Dieu. Nadim Tabet innove encore et trouve avec son chef opérateur Thalal Kommy des angles pour tutoyer les cieux, élever le spectateur depuis le bitume. Comme dans un soap ou une websérie, deux très belles femmes (Caroline Hatem, Zelfa Seurat) conversent sexualité et amour en une langue très écrite ; retour à une perception particulière de la rue, un temps absent pour la disparue ou alors comme si ce qui comptait seulement étaient ces échanges, ces souvenirs qu’elle laisse, étonnants dans la bouche des compatriotes syriens qui la racontent et nous font rêver. Des bourgeoises de Beyrouth aux syriens de Palestine, ce qui conte, c’est d’abord cette belle double fusion des visages et des esprits. Après, Martyr, bientôt, en 2017, on pourra filmer les visages et les corps masculins chargés d’une nouvelle sensualité. Et ici, on a aussi des corps sans visages, fusionnés. La réalité peut aussi faire son nid dans les façades saisies, saucissonnées dans leur particularités, manière inquiète de rappeller que derrière ces yeux noirs, des anonymes vivent malgré tout. Tout, c’est l’incroyable : les libanais d’aujourd’hui courent après l’électricité, l’eau ou l’internet. Par contre, il reste des courses sur les hippodromes, de beaux restes rendus graphiques quand la normalité n’a elle plus cours.
En 2020, Nadim Tabet tourne avec Charbel Haber un diptyque (présenté à l’Opéra du Rhin à Strasbourg) qui a pour point aveugle l’explosion du 4 août et la destruction du port de Beyrouth. Le premier volet, Un dessin dans le ciel dit bien son projet : rendre hommage en musique et en images à Beyrouth et plus particulièrement à l’architecte Bernard Khoury. « Ce culot délicieux, ces postures décadentes, servies sur des plateaux rutilents, du haut desquels on déguste les merveilleuses catastrophes, la violence de ce que nous avons bâti sans avoir cherché à comprendre, sans vouloir expliquer… » Sur ses mots, Nadim Tabet prolonge la ligne claire et lancinante du son dans les courbes sinueuses des immeubles. Au départ anamorphosés, ils prennent presque corps des cordes que l’on caresse. Les immeubles sont beaux et il n’y à plus qu’à se laisser porter jusqu’aux piscines à leur sommet, là où se régénère déjà son cinéma. Le trafic est aussi magnifiquement filmé, c’est une toute nouvelle ville, lumineuse, qu’on n’a jamais vue sous cet angle ailleurs, sauf peut-être chez Elie Khaliffé. Mais les mots de Khoury s’avèrent bien prophétiques : « ce lieu est maudit, en attente d’une convalescence qui se fait trop attendre (…) En fond de scène, la montagne, vénérée, ravagée, un dit fleuve qui porte mal son nom, un filet d’égoût qui se déverse dans une mer, obsession toxique, vénérée, ravagée. » Ces mots, de la voix même de leur auteur, résonnent du monde d’après la catastrophe quand les images n’en illuminent pas encore les premiers feux.
Seconde partie, ce non moins formidable Enfin la nuit, toujours sur les volutes soniques de Charbel Haber et Fady Tabbal. Nadim Tabet ouvre son film sur un ballet lumineux, chimique, chromosomique peut-être, l’essence de la beauté. S’ensuivent la friction des corps (on reparlera de son rapport avec certains films de Larry Clark), leurs variations de température – pureté d’un bleu qui n’existe qu’au Liban. Le cinéaste capte chaque besoin vital de chaque existence en flashes jamais lassants, passant de l’individuel au collectif en un geste politique. Prenant le pas sur l’humain, les sublimes abstractions sur les structures décharnées du AHM, vestiges somptueux d’une nouvelle guerre qu’on veut transfigurer par le son. Le son palliatif, curatif, vital qui veut créer un espace résilient par les Arts. Une performance émouvante, d’une infinie tristesse aussi, noyée dans l’éternelle mélancolie de Beyrouth au bord du gouffre. Comme avant lui Salhab, Nadim Tabet a une manière unique, particulière de filmer les rues. Les immeubles s’y dressent, blessés, marqués ou flambants neufs, debouts, dervishes tutoyant les cieux. Les feux viennent allumer la nuit et le drapeau national flambé à l’éternelle jeunesse, mains qui frappent sans discontinuer à la porte d’un pouvoir sourd et éteint. Il y a de la grâce dans la manière de monter de Nadim Tabet, qui court toujours après la ligne claire, à la manière d’un calligraphe et ils valent bien les vers d’Eluard, autre accolade à l’autre bord de la Méditerrranée qu’embrasse l’existence ballotée d’un auteur constamment partagé, exilé mais qui va puiser là de nouvelles forces, tout son jus.
Depuis des années qu’il tutoie la fiction et qu’il n’était jamais meilleur que lorsqu’il la détournait pour expérimenter, il était logique que Nadim Tabet passe au long-métrage et tente un récit plus traditionnel. Pas de trahison de ses idéaux ici, mais il est vrai qu’on a pensé aux débuts d’Olivier Assayas, lorsque le rock irriguait toutes ses veines et son approche de la vie. C’est par l’observation de son duo de personnages féminins que Nadim Tabet raccorde avec le jeune homme qu’il a été et porte toujours en lui, même s’il jette bien des regards vers l’Europe et peut-être plus loin, vers les cousins américains et le coming of age. Comme à son habitude, la musique n’est pas accompagnement mais moteur de la narration (la ballade commence et l’autobus emporte Yasmine ailleurs ou a le pouvoir de ralentir la circulation sur le périphérique) et comme la caméra, elle colle aux personnages, les habille de sons rocks décharnés. Film initatique sur une jeune fille en fleur et l’autre presque déjà brûlée, quoique plus réaliste (impressionnante Yumna Marwan), One of these days (2017) prend la température de la jeunesse libanaise coincée entre la famille ou la mort, le vivre à fond que procure la drogue et que symbolise ce personnage séduisant de dealer au pied de la grande roue. Nadim Tabet filme brillamment la passion et les corps, pas en observateur objectif à la façon de Larry Clark dont la difficulté à vivre aurait pu rapprocher leurs personnages, mais en empathie, à leurs côtés et nous avec, épaule contre épaule. C’est tout à son honneur que d’avoir privilégié la qualité humaine et d’avoir plié son langage et sa recherche esthétique à l’itinéraire sentimental, amoureux, parfois autodestructeur mais sincère de ces jeunes protagonistes déjà bien marqués par le destin. Telle cette idylle gelée en photogrammes comme le récit de la rencontre des deux filles, à la manière de ce cinéma indépendant qu’apprécie aussi le réalisateur.
Cela faisait d’ailleurs bien longtemps qu’on n’avait pas vu un film rock qui parlait vrai, qui ne sente pas le réchauffé. Poésie, pop et héroïne, un coktail bien connu dans une contrée qui a toujours été une plaque tournante, à des prix plus abordables. Mais ce n’est pas le vrai sujet, the dream is not over. Idem pour le rêve politique, inventé avec de beaucoup de discussions. Le cinéaste observe avec chaleur, écoute et marche avec Maya au milieu des manifestants, la distance permettant de mieux saisir toutes les difficultés des jeunes militants libanais, le film ne prenant jamais qui que ce soit de haut, pas plus que la jeunesse ne prend les contrôles de police et l’état policier au sérieux. Mais c’est plus le rapport intime au temps, son passage plus que tout, que le cinéaste parvient à apprivoiser et à monter (et un simple travelling filmé du bus devient alors la plus belle des envolées lyriques). L’intensité d’une journée dans la vie de jeunes, un sujet universel comme la citation de Rimbaud qui claque sur la ville-monde à la complexité infinie. On plonge, et avec Yasmine replonge, mais pas plus loin que dans la vie. Cette réussite est due à l’écriture musicale et à la profonde complicité qui les unit depuis toujours et c’est sans doute l’une des plus belles collaborations entre un cinéaste et un compositeur (ici avec son goupe, les Bunny Tylers) de tout le cinéma mondial. Des artistes qui sont devenus adultes ensemble, pas en communauté mais qui se retrouvent à chaque étape stimulée par une nouvelle collaboration. Un film vrai, incandescent, qui nous laisse coi, dans le désir, si possible d’un prochain film avec Abbout productions et Georges Schoucair qui a initié ce souffle nouveau du cinéma libanais dont Nadim Tabet est peut-être le plus beau représentant.
Aux marges du pays
Cinéastes voyageurs, les réalisteurs exilés libanais ne cessent pour autant de tourner autour.
En 1991, Randa Chahal Sabbag réalise Écrans de sable, un film qui s’intéresse à la situation des femmes en Orient. Le cadre est une ville moderne du désert mais où les femmes vivent voilées, comme un remake du mauvais Harem d’Arthur Joffé dans un royaume où la technologie et le décor seraient des plus contemporains.
Après l’Égypte pour Dounia de Jocelyne Saab, Danielle Arbid emmène Melvil Poupaud dans les bordels et les chambres du Proche-Orient à la recherche de cet « amour à l’orientale » qu’on vantait tant en occident, dans une zone mâle définie mais où les corps deviennent territoires tout entiers. Le héros de L’homme perdu s’échine sans doute à vouloir réparer ce qui a été irrémédiablement défait, c’est alors qu’il perd sa boussole et se dissout dans les extérieurs.
Les marges, ce sont bien entendu les zones frontalières. L’ultime film de Randa Chahal Sabbag (qui succombe à un cancer à 55 ans…), Le cerf-volant (2003), met en scène une idylle entre un soldat israélien et une jeune fille druze mariée contre son gré à son cousin. La frontière y est une limite absurde, contre nature ou encore arbitraire et mouvante. Le film déploie son onirisme pour filer la métaphore, il a sans doute manqué d’un peu de cruauté et d’un peu moins de joliesse oecuménique. Pourtant, par principe, il n’a pas été du goût de la communauté druze pour laquelle un rapprochement avec un soldat israélien est juste chose inimaginable. Reste l’ébauche d’un portrait de jeune fille avec la têtue Lamia…
Le miel et les abeilles
Film phare des années 2000, Caramel (2007) est le premier long de la comédienne et réalisatrice de clips reconnue, Nadine Labaki. C’est comme dans le domaine musical, un film souvent à fleur de peau, en parfait accord avec son sujet. Un film qui gratte, picote et en fera crier certains. Un film mâture et important qui sera d’ailleurs un immense succès au Liban et à l’étranger, un record. Le caramel nous fait fondre quand le citron pique presque, un mélange redoutable pour traiter de la condition de la femme libanaise. Un film deterritorialisé car intérieur (la dédicace « à ma Beyrouth »), né dans l’intime et qui montre une ville tranquille, chaleureuse, hors du temps, dans des plans ciblés et bien serrés. Même chose pour le focus du salon à la fois traduit par cette ouverture circulaire sur la quelle on place le cache d’un store qui filtre le monde extérieur, et l’enseigne « Si belle » dont la lettre en déliquescence évoque l’image photographique inversée. Une radiographie de la société qui passe inévitablement par l’utilisation de stéréotypes. Nadine Labaki a préféré faire incarner ces personnages par les comédiennes (à l’image de sa Layal) plutôt que de développer de trop les personnages, se concentrant sur les situations. Elle brise ici avec courage un certain nombre de tabous : l’adultère fantasmé, désiré et assumé sur fond de rivalité féminine quand le mâle n’est qu’un enfant. La peur de vieillir jusqu’à l’hystérie, le mythe de la virginité, l’homosexualité féminine revendiquée, la responsabilité familiale et la non prise en charge de la folie. C’est dans la douceur, la photographie dorée à l’or fin que se fait le liant où vont se prendre les pépites et les paillettes d’un film presque choral qui se construit tranquillement mais dans une totale sérénité. Khormaz a raison lorsqu’il dit que le film incarne pour longtemps un pays mais sa comparaison avec Borat est simplement injurieuse. Le film est libanais jusqu’au moindre poil au contraire de la moustache factice de Sasha Baron Cohen dans sa parodie aussi facile que raciste coulée dans une fausse vraie bêtise mondialisée. Et puis la féminité de Labaki ne durcit pas elle avec le temps, au contraire du caramel.
Pourtant, certains reproches – en germes ? – adressés à Caramel se confirmeront dans les films suivants, maniant beaucoup moins bien le sucré et l’amer dans Et maintenant on va où ? (2011) qui part d’une bonne idée mais loupe la partie comédie musicale dans les traces de Bosta. Même embourgeoisement avec Capharnaüm (2018) dont la mise en scène et surtout la direction des jeunes acteurs ne sont pas sans qualités, loin s’en faut, mais qui manque totalement le coche en préférant le pathétique au politique dans son traitement, louable au demeurant, de la misère et de l’enfance en danger. La cinéaste a définitivement une fascination pour l’ordre, de préférence viril et mutique et l’émotion sécrétée avec les ficelles du cinéma populaire (l’Égypte n’est pas loin) manque de tourner à la Porno miseria bien plus qu’au néoréalisme. Bien sûr, l’ensemble du cinéma libanais entretient une non-communication polie avec la police et les forces armées à l’écran, exclusivement représentées comme des symboles de l’impuissance de l’état plutôt que comme des citoyens doués eux aussi d’une éventuelle conscience politique et donc capables d’évoluer, mais tous les films les utilisant comme « décors vivants » ne prétendent pas au discours social comme ce Capharnaüm qui frise la confusion. Ce n’est pas une partie de plaisir que de critiquer un film libanais, chaque acte créateur relevant presque ici du divin, ou au minimum d’une foi inébranlable. Mais même s’ils ont le mérite d’exister dans un contexte défavorable, que le film aborde un sujet peu représenté depuis les documentaires de la guerre et qu’on apprécie grandement la comédienne et la cinéaste de Caramel, on aimerait que Nadine Labaki retrouve l’engagement et l’inspiration des débuts, que la réflexion succède à l’empathie et d’ici là, que le festival de Cannes songe à programmer aussi d’autres grand.es cinéastes libanais.es en activité parmi la vingtaine au moins qui rentrent dans leurs cases !
Entre démolition et reconstruction
Dans Beyrouth ma ville, Roger Assaf écrivait que la guerre fait des trous, mais que la vie n’a de cesse d’essayer de les reremplir. Comme la marée, c’est le mouvement naturel du monde. Parmi toutes les thématiques privilégiées du cinéma libanais de ces trente dernières années, c’est sans doute, par la force des choses, une des plus représentée. La reconstruction des personnes chemine de concert avec celle des lieux. Comment alors prendre du recul et panser ses blessures dans un pays dont le cadre est en permanence bouleversé par les travaux qui tentent d’effacer les effets de séquences de guerre presque ininterrompus quoique dispersés ? « Le Liban d’après-guerre souffre d’une absence de temps, d’une écrasante suprématie de l’espace. La table rase de la reconstruction est une machine à effacer la mémoire et nous en venons à nous demander si cette dernière est vraiment nécessaire. » déclaraient Khalil Joreige et Joana Hadjithomas à l’époque de leur premier film. (Unifrance, Autour de la maison rose)
En 2008, le minimalisme de Khiam avec un concept basé sur des témoignages face caméra de personnes disparues et détenues dans les prisons syriennes, dresse une sorte de diptyque avec le road movie en sud liban Je veux voir, ou plutôt en zone chi’ite (puisque le voyage commence d’abord dans Beyrouth sud, cette banlieue qu’on n’a pas le droit de filmer). Catherine Deneuve y est elle-même, ici moins l’actrice célèbre qu’une personne qui veut voir les traces de la guerre et de l’occupation, Rabih Mroué un libanais comme un autre, le film jouant sur la naïveté de ce point de vue, voir pour croire quand la représentation télévisuelle n’est que banalisation et opium du peuple. La mise en abyme permet une distanciation salutaire avec la violence de ce qui nous est montré : un pays où l’on est presque jamais libres ! Je veux voir est enfin dans sa dernière partie un superbe film-essai de frontières, pas seulement nationales, mais aussi communautaires, idéologiques et individuelles puisqu’on y teste nos limites, ainsi qu’une représentation lucide du rapport avec le voisin israélien et qui interroge déjà la nouvelle donne et la place prise par le Hezbollah dans le paysage politique libanais. Le film est court. Sa dernière séquence est un impressionnant travelling avec le ballet incessant des camions et des grues, symbolisant le bouleversement en profondeur de milliers de vies, de toute une population qui à l’instar des palestiniens de la bande de Gaza, n’ont plus que la résistance et le martyr pour se dresser face à l’insupportable. La photo de la star française avec les casques bleus français dégage alors une amertume tenace au-delà du trait d’humour cinglant. L’indifférence mondiale face à la souffrance des petites gens des zones rurales ou aux déplacés va de pair avec le sauf conduit délivré par les Etats-Unis à l’état israélien, comme il en est de même à l’état syrien pour ne pas froisser la Russie. Les conséquences de cette géopolitique sont physiques et ici ON LES VOIT, pas forcément qu’on le veuille car c’est non sans une immense peine, mais au moins, on prend conscience. Alors Catherine Deneuve, quand on a vu, on en fait quoi ?
On le sait, le cinéaste le plus mélancolique et habité par les traces des conflits dès le moment où elles impactent le pays ou la ville, c’est Ghassan Salhab. Parce qu’il a saisi l’aspect cyclique des choses et les dimensions parallèles, ses couches visuelles, sonores, appartenant à un beaucoup plus vaste mouvement. « Privé de fiction » comme il se sent alors après l’attaque israélienne de juillet 2006, il conçoit un film comme une expérience. Film qui ne veut pas mourir, Posthume (2007) est réalisé à chaud. De longs travellings voiture parcourent la banlieue sud et ne cessent d’y croiser des axes routiers brutalement interrompus ou des ponts éventrés. « Beyrouth est une ville qui se métamorphose tout le temps, c’est aussi une perdition. » De la neige sur un écran télé, puis la sihouette familière d’Aouni Kawas qui en naît, hiératique et qui cède la place au gratte-ciel hanté El-Murr, cet immeuble fantôme qui domine encore Beyrouth, « ruine avant même les ruines » nous dit le carton. Filmer cet immeuble, c’est creuser la mémoire, excaver, d’où un plan obsessionnel de godet qui creuse. Retour aux attaques israéliennes par le biais des informations du journal télévisé, celles qui font de Beyrouth « une ville hors le temps », toujours après la catastrophe, en permanent recommencement. La silhouette du cinéaste s’y mêle mais on est loin des plans en macro organiques de Mon corps vivant, mon corps mort (2003). Des personnages dos, puis face à la mer. Réminiscences. Éternelle mélancolie méditerranéenne… Se pourrait-il que le mal soit alors source de la vie ? « Ce qui est véritablement irrationnel, qui n’a pas d’explication, ce n’est pas le mal, c’est le bien. » Une pensée triste se filme, en écho à Raphaël Millet et à son texte de présentation de la rétrospective Salhab à La Rochelle. Les couches se figent, le temps recule parfois, mais le film lance aussi un travelling de droite à gauche sur la reconstruction que cueuilleront au vol Joreige et Hadjithomas le rejoignant depuis le sud en un post scriptum.
Going home
Parmi les titres résonnant sans cesse, quand « Beyrouth » se tait enfin, un « home » se fait entendre. Car on ne compte plus les cinéastes libanais travaillant à l’étranger. Patric Chiha en Autriche pour le moyen-métrage Home (2006). Même la Suisse a accueilli Elie Khaliffé à ses débuts qui y a fait du Liban son miel, tout comme Fouad Alaywan (le court efficace Le vent de Beyrouth en 2002, Al surat al mustaqim (2015) sur Izil. Alaywan a même décrit la vie heureuse en Suisse d’immigrés libanais dans Ila Al Liqa’A, un moyen-métrage de 2006, avant de faire du retour la matière première de Asfouri (2012) où il s’agit de remettre sur pied le building de son enfance. Aux États-Unis, cohabitent le meilleur (Karim Kassem, un ancien DJ installé à Brooklyn où il devient cinéaste avec le court Red pearl (2012) et fera là encore du retour le sujet de son premier long Only the winds en 2020 présenté à Rotterdam) et le pire (le comédien Charles Kassatly qui tourne le film d’exploitation underground My pink shirt (2007), le producteur Sylvio Tabet qui passe derrière la caméra pour Dar l’invincible 2 : la porte du temps (1991), où le premier degré a remplacé la poésie de Coscarelli. Au Canada, l’artiste transdisciplinaire Jayce Salloum (Untitled part 3B : (as if) beauty never ends, 2002), en France pour beaucoup d’entre eux comme Rima Samman (également scénariste et lectrice, membre du comité de sélection de l’ACID…) qui réalise sur l’enfance le très intime Crème et crémaillère (1999, logiquement produit par le G.R.E.C), le sublime essai expérimental Rien que le bruit de ma mère (2012) ou le gothico-spectral Rien ne s’oppose à la nuit (2011), films hantés par le souvenir. On attend des nouvelles de ses deux premiers longs en préparation.
Déjà bien établie, et en France elle aussi, Jihane Chouaib revient aussi au Liban pour Pays rêvé (2011) et Go home (2015). Dans le premier, il s’agit d’un documentaire qui donne la parole à d’autres exilés : sa sœur Nada devenue danseuse, Wajdi Mouawad, les cinéastes Katia Jarjoura et Patric Chiha. Tous apparaissent dans des lieux qui font écho à leur état d’esprit (aéroport, ruines, arbre enraciné dans un paysage lunaire, sud Liban). Dans le cas de Jarjoura, c’est plus effrayant : la guerre reconnecte la cinéaste à son pays dès lors qu’elle y plonge (« ce mélange subtil de douceur et de massacre qui constitue notre pays ») et peut éprouver comme d’autres générations avant elle la fascination pour son esthétique, l’attrait de ses combattant en une sorte de fétichi’isme, jusqu’à chérir une balle dans le ventre qui la ferait ressuciter enfin libanaise et lui donne alors le droit de repartir. La sœur de la cinéaste retrouve elle une compensationà sa perte de repères, survenue avec l’oubli de la langue arabe, en pratiquant la danse du ventre. Wajdi Mouawad choisit l’exil perpétuel, le nomadisme, Chiha et l’auteure avouant ne plus se sentir libanais car « ici, l’identité est une prison, se définir, c’est tracer des frontières. » Dans Go home, une jeune fille revient dans la maison familiale abandonnée, métaphore évidente des liens qui l’unissent au pays d’origine. La question de demeures prophanées, mises à sac, restées souvent inoccuppées dès lors qu’elles n’ont pas été vendues est également caractéristique du pays (voir également le retour douloureux de De Gaulle Eid dans Chou sar ? (2009))
Comme Christophe Karabache, Jihane Chouaib choisit toutefois d’entretenir un dialogue avec ce pays aimé et haï. De partir de sa propre histoire dévoilée dans Pays rêvé, le souvenir d’une maison occuppée puis vandalisée, thème retrouvé chez Caroline Tabet (290 rue du Liban), ou version anéantissement chez Jocelyne Saab (Beyrouth ma ville). Pour Go home, elle choisit très symboliquement une actrice iranienne pour interpréter son héroïne libanaise de retour dans la maison familiale, laissée à la friche et aux fantômes. Et c’est une des belles idées de la réalisatrice que de l’aborder à la fois comme un drame intime et comme un véritable film de fantômes, de plonger aussi dans cette esthétique là qui va de pair avec le budget relativement modeste du film (produit par Pierre Sarraf) et son approche personnelle. Comme dans un film de genre italien, le traumatisme est répété, décliné sous toutes ses formes puis ajusté à une vérité « intelligible » par la protagoniste. Car il est question de la fabrication inévitable d’une mémoire, ce qui est le cas de la plupart de nos souvenirs d’enfance. Et qui dit film de fantômes dit cris et chuchotements, le non-dit comme matière première du récit. L’autre face de l’héroïne, c’est celle de la révolte contre l’ordre patriarcal qui a amené la guerre et qui empêche aujourd’hui son règlement. Jihane Chouaib compare ainsi Nada à Antigone, et son combat titanesque aux mythes, au royaume disparu de l’enfance. Un beau message d’outre tombe envoyé à son pays d’origine… Ces deux derniers films font de la réalisatrice une figure centrale de la création franco-libanaise contemporaine et une auteure rare, mais à suivre comme son ombre.
L’itinéraire de Chloé Mazlo est fort différent, puisque la jeune cinéaste de Sous le ciel d’Alice (2020) cherche à reconnecter avec le pays de ses parents, plus proche ici de l’héroïne du Memory box de Joreige et Hadjithomas, en toute logique puisque le sujet a l’âge de la nouvelle génération. Après une série de courts-métrages très créatifs avec en premier lieu son approche très singulière, ludique mais juste, d’une touriste débarquée dans un Beyrouth en guerre dans Deyrouth (2010), dont l’aspect bricolé prend tout son sens, un peu à l’image des courts-métrages d’ateliers de Bidayyat, le collectif syriano-beyrouthin. Un ton fantasque et presque rebelle qui se fait plus chaleureux pour le magnifique biopic sur Ismahan puis qui flirte avec le conte pour Contes de fées à l’usage des moyennes personnes (2015).
Le passage au long-métrage tente donc de conserver cette esthétique, tout en mettant en œuvre des moyens beaucoup plus importants, un casting international et un gros boulot de direction artistique. Mais ici le ton poétique pourtant assez en phase avec l’esprit de Wajdi Mouawad, ne parvient pas toujours à s’affranchir de la pesanteur. Il y a plusieurs lignes, la toute première étant le choix de l’épique, de l’épopée familiale sur le ton pop et coloré (ou plutôt acidulé ?), Mazlo faisant clairement référence à The lebanese rocket society comme un film fondateur pour fabriquer une autre image du Liban. La seconde étant le film romantique, l’ode à l’amour fou qui traverse la guerre civile, mais tout cela ne manque-t-il pas d’un peu de chair ? La guerre elle même n’est pas seulement utilisée de façon symbolique et cocasse (la ligne verte intérieure), elle est théâtralisée dans un esprit de distanciation qui autoriserait le surréalisme. Ici, c’est un peu selon les goûts car on ne pourrait reprocher ce choix à l’auteure qui cherche depuis toujours sur cette ligne escarpée, dans la lignée d’autres cinéastes en guerre avec le réel comme Kaurismaki (le parfois problématique Le Havre). Il faut donc abandonner l’idée d’un film libanais et l’apprécier plutôt comme un film de Chloé Mazlo, cinéaste qui teste les limites du médium et de son sujet avec au moins une belle effronterie et pas mal d’audace, mais aussi de vraies réussites.
Résistance par les armes
Au pays de la poudre et du sang, la présence des armes est soit un argument dramatique (Falafel), soit un arrière plan (One of these days), dans une zone géopolitique où les conflits se multiplient de chaque côté des frontières. Au lendemain de la guerre civile, on plaidait à juste titre pour le désarmement général. Vol libre au Liban (1991) est réalisé par Philippe Aractingi, court film dont il est le héros, au format reportage pour l’émission française Envoyé spécial. Il élève d’ailleurs un peu la qualité moyenne de l’émission dès la citation de Nadia Tueni « Là où l’homme s’arrête, les oiseaux passent encore ». Il s’agit pour le réalisateur de réaliser un rêve un peu fou : voler en parapente au dessus du Liban avec tout ce que ça comporte comme dangers vues les tensions locales. Le film s’ouvre avec une belle voix off, hommage aux documentaires de la guerre : « à force, je ne sais plus quoi dire ni par où commencer… » « Je sentais les ruines en moi ». Pour cette expérience – on sent que le processus compte plus que la performance ou même que le symbole « il est interdit d’être libre au Liban ». Aractingi a choisi une montagne dans une zone mixte où la foi est très présente (3000 habitants, 40 églises), à majorité chrétienne mais où les musulmans chi’ites sont également très présents. On y voit notamment le village d’Akoura. En réalité, le film veut surtout traiter de la libre circulation des armes au Liban et de leur usage intempestif comme une des causes principales des dérapages. Il commence par nous faire visiter le local d’un collectionneur d’armes fou furieux (avec une belle croix gammée plein cadre), qui a toujours une grenade opérationnelle à portée de la main, pour se protéger « au cas où ». Les pratiques des ruraux sont aussi épinglées, en particulier cette habitude de tirer en l’air pour un oui ou pour un non ( la réplique drôlatique « C’est un syrien qui vole, viens qu’on se l’abatte ! ». Enfin, il y a peut-être l’idée de relégitimiser les forces armées libanaises qui aident au projet. Malheureusement – format télé oblige – la dernière partie et la conclusion sont un peu rapides et frustrantes, il y avait là matière à prendre de la hauteur pour un vrai documentaire…
Mais comment mettre bas les armes quand certains continuent de pratiquer la lutte armée, aussi justifiée soit-elle vue l’attitude israélienne, le drame de la Palestine ou les magouilles syriennes, quand le terrorisme continue de gouverner la politique libanaise comme unique solution de faire bouger les lignes ? Élaborant ses propres clichés, s’organise un cinéma de la Résistance, qui hors du sud Liban et de Beyrouth sud s’appelle Hezbollah. Il était encore jusqu’aux législatives de mai dernier, la première force politique à l’Assemblée libanaise et reste encore le premier parti électoral à 22 % (pour plus de 40 % d’abstentionnistes, contexte presque simlilaire à la France), mais ils faut tenir compte du fait que les candidats réformistes issus de la société civile et du mouvement civique entamé en 2019, ne sont pas structurés au sein d’un parti unique. Il ne semble pas pour le moment que ce cinéma ait donné d’œuvre majeure, victime du ton propagandiste du Parti et de la faiblesse de son expression cinématographique, à la fois trop télévisuelle et populiste.
Adel Serhaan a étudié en Russie puis est devenu clippeur, réalisant plus de 350 clips pour les stars de la chanson moyen-orientale. Après quelques courts-métrages, il signe un Khalet wardeh (2011) assez soigné avec Hicham Abou Sleiman, produit par le Beirut international center dont le catalogue va du film ou série ou animé historique aux films sur la résistance et laisse un peu sceptique, aussi pauvre cinématographiquement que politiquement, mais devrait être considéré depuis la nouvelle donne géopolitique du Liban et la place centrale qu’occuppe le Hezbollah dans la vie politique libanaise depuis ses victoires militaires contre Israël. Par la suite, Serhan réalise Betroit (2012) à la gloire de la famille, à travers plusieurs destins éparpillés entre Beyrouth et Detroit. La même mouvance compte aussi 33 days (2012) de l’iranien Jamal shoorje sur la résistance du village d’Ayta ash Shab, réalisé avec la coopération de l’armée libanaise à la gloire de la Résistance (le Hezbollah pour faire court), ioit du cinéma de guerre à l’iranienne, très commercial avec de gros moyens et un scénario tire-larmes avec plein de relations sentimentales. Enfin, The buried secret (2015) de l’iranien Ali Ghafari est un bel exemple de matyrologie crétine, qui a le bon goût d’être plus épuré esthétiquement mais pour une l’iconographie la plus orthodoxe et caricaturale (la représentation des combattants, des femmes, de l’armée). Avec la censure exercée en interne par le parti de Nasrallah, il y a fort peu de chances qu’un bon film de ce genre apparaisse, mais on pourrait attendre au moins un film militant qui dénoncerait avec plus de subtilités les exactions israéliennes en territoire chi’ite.
On se demande si du côté de la frontière syrienne, on tourne les mêmes machins à la gloire de l’armée de Bachar. Il y en a sans doute, puisqu’au delà de leurs intérêts convergents et associations, la Syrie et ce, même durant la guerre civile, continuait de faire fonctionner sa machine de propagande à plein régime.
L’utopie artistique ou le rêve d’un Liban commun
La question du moyen d’unifier un Liban par le cinéma quand ce même pays a bien maltraité cet art auparavant, taraude la génération d’après-guerre. Loin de son travail documentaire, Philippe Aractingi tourne Bosta (L’autobus, 2005), virée d’un goupe de danseurs en tournée dans le pays. Le besoin de distractions se fait sentir sur les écrans libanais comme dans le film lui-même, d’où un beau succès en salle et qui a ouvert la voie à un courant de cinéma d’auteur et de comédie propice à séduire le public libanais. Avec sa structure en feuilleté temporel, ses intermèdes chantés et dansés volontairemnt tournés à la mode Bollywood et son voyage à travers le Liban rural, le film actuellement diffusé sur Netflix avait bien des atouts pour séduire : ses chorégraphies, ses couleurs, sa bande originale, son casting emmené par Nadine Labaki, en couple avec Rodney el-Haddad, aventure qui influencera grandement son œuvre de réalisatrice à venir, ton comique voire satirique, couleurs à foison… Une réalisation ambitieuse et dynamique dès la scène liminaire (qui a pu influencer Chazelle pour celle de La la land), montage à l’avenant, tout est réuni jusqu’à l’exagération pour séduire. Le roman photo ne nous épargne aucun chromo et certaines affétéries alourdissent parfois l’ensemble, le jeu parfois XXL et quelques limitations techniques aussi (beaucoup de plans à la grue mais avec une qualité photographique très moyenne…). Qu’importe, Bosta est avant tout du cinéma populaire survitaminé ! Ça ne l’empêche en rien d’offrir en prime un regard critique sur la tradition qui maintient le pays enfermé sur lui-même et sur son communautarisme, ici à travers le Dabkeh, danse traditionnelle se déroulant en ligne et où il faut suivre un leader (à l’image des zaïms libanais, les chefs de clan), mais sur le papier ouverte à l’improvisation. Ici, la danse est mixte et débridée, suffisamment pour conduire le pays tout entier à une prochaine métamorphose.
Rebondissant en permanence dans de nouvelles directions, le duo Joana Hadjithomas et Khalil Joreige consacre avec The lebanese rocket society (2013) un documentaire épique à la conquête spatiale libanaise à travers un collage pop à même de redessiner « un monde des possibles » qui existait alors. Sous l’égide du professeur de physique Manoug Manougian, un certain nombre d’étudiants dont certains autres d’origine arménienne, participèrent à une aventure relayée dans les médias de l’époque, puis totalement occultée. Khalil Joreige pose la question : « quelle est la mémoire de l’histoire ? ». Question préoccupante tant l’Histoire ne tient souvent qu’à un fil, au gré des réécritures par ses vainqueurs. Cette vraie utopie fut ici détruite par l’arrivée de la guerre civile et remplacée par l’industrie de la mort et la victoire des marchands d’armes. Quelle est donc la pérennité de l’image cinématographique ? Archives des années 60, clip musical façon épopée spatiale, pour retracer avec la fusée Cèdre le leadership libanais dans le monde arabe, animation, autant d’éléments et plus encore mis en œuvre – recherche des acteurs ou de témoins directs (le photographe) -, l’idée est d’enrichir l’imaginaire collectif libanais par ce kaleidoscope propre à recréer du mythe. Le ton est à la nostalgie, mais aussi empreint de dérision. Plusieurs degrés de lecture coexistent. Ce travail de réécriture d’une histoire libanaise au dessus des clivages politiques, ethniques et confessionnels est à la fois ample et modeste, majestueux et minimal. Assurément un film important dans le paysage du documentaire libanais, car aussi atypique que ses auteurs !
La danse est une expression importante dans ce pays, même si elle fut souvent commune aux autres pays arabes (danse du ventre…). Plus encore que dans Bosta, ce sont les films de Jocelyne Saab qui en parlent le mieux. Essentiellement Dunia (2005) film tourné en Égypte, extérieur au Liban mais commun à sa culture, certaines questions émancipatrices étant elles propres à l’Égypte et à un Islam plus rigoriste, comme l’excision ou l’interdiction des Mille et une nuits pour pornographie. Dunia souhaite étudier la poésie soufie et a trouvé un professeur passé maître en la matière. En parallèle, elle décide prendre des cours de danse, étant la fille d’une danseuse adulée, plus que par réelle passion. Il est ici question des limitations imposées aux femmes, dont celle de laisser s’exprimer leur corps dans la sexualité, comme dans la poésie ou dans la danse. Jocelyne Saab a à la fois tenu à rendre un hommage à toute la culture orientale mais aussi à sublimer les corps, les filmant de très près afin de mieux les mettre en valeur. Le film est magnifiquement cadré et monté, balayé par un souffle de liberté et habité par la beauté. Il enchaîne alors les scènes fortes, voire cultes. Autant d’éléments qui en font un des films les plus sensuels de tout le Proche-Orient !
En hommage à sa ville, balayée par de lents panoramiques à ras les toits, Jocelyne Saab tournera son ultime film, le très poétique What’s going on ? (2009), où il est à nouveau question de texte et de livre (et même d’un lit-vre!). Une idée qui culmine dans l’image d’un immeuble où toutes les personnes à la fenêttre lisent un livre. L’aspect chorégraphique très contemporain amène des moments dansés sublimes, comme cette scène sur le port de Beyrouth. Le film foisonne aussi de symboles et on croit dicerner un discours nature culture, où il s’agit d’irriguer l’un et l’autre. Des passages sont plus musicaux et proches du clip, excepté sur la chanson d’Amadou et Mariam qui agit comme un excellent leitmotiv, d’autres presque psychédéliques, organiques, la cinéaste intégrant l’imagerie médicale, peut-être préoccupée sans le savoir par la progression de la maladie à l’intérieur de son propre corps. Bref, c’est à la fois formel, personnel, testamentaire et un grand moment de cinéma libre.
Corps à corps
Les préoccupations sur le corps ne sont pas exemptes des films masculins. Après quelques court-métrages dont Cadillac blues présenté à Né à Beyrouth en 2002 ou A very dangerous man (2012), Mazen Khaled, cinéaste installé aux États-Unis frappe fort avec son second long-métrage, Martyr (2017), un film solaire et sensuel sur le culte du corps chez les chi’ites et qui présente la vie de jeunes d’un quartier défavorisé, entre bronzette et baignades sur la corniche, pression familiale, religieuse et vie communautaire mais exiguë et dont la peinture est exempte de clichés ou de raccourcis trop simplistes. Cette œuvre forte propose une réflexion sur la notion de martyr, sa voie émancipatrice et sa fonction sociale à partir du cas d’un jeune plongeur ayant trouvé la mort et dont la dépouille traverse le quartier. Tout l’art de Khaled est d’utiliser le son et l’image pour dépasser les non-dits, notamment dans les évolutions aquatiques où les corps se rejoignent, et rendre l’intériorité en phase avec la vie de ses personnages. Les corps y deviennent enfin des personnages à part entière, tout particulièrtement celui adoré du martyr, lavé longuement et minutieusement, rituellement, puis porté aux nues. Il s’agit tout simplement d‘un des plus beaux lilms libanais de ces quinze dernières années ! Un auteur désormais attendu comme le messie.
Par leur approche sensuelle, ces films retrouvent un équilibre entre le miel et le fragment quand d’autres penchent résolument pour une tradition mélodramatique ou une narration généreuse. Qui à part les libanais pourraient conserver la nostalgie de chanteurs de charme français totalement oubliés ? Mais qui se souviendra également d’Hany Tamba après un brillant départ avec Les barbiers de cette ville ( doc, 1997), Mabrouk again (2000), After shave (2004), César du court-métrage superbement mis en scène et le grand succès de son premier long Une chanson dans la tête (Melodrama habibi) au Liban en 2008 ? Comment expliquer que celui qui s’annonçait comme un brillant représentant ou même comme le rénovateur de la comédie libanaise ait ensuite totalement disparu des radars pour se consacrer à la réalisation exclusive de pubs et de clips, si ce n’est par la difficulté à monter des projets en son pays ?
On ne peut que le regretter à voir le film aujourd’hui, qui met en scène avec élégance et sobriété des personnages désabusés et inverse les stéréotypes liés à la mélancolie puisqu’ici, c’est le français qui est dépressif et les libanais plutôt plein de vie et d’amour, à l’image des personnages joués par Pierrette Katrib, Julia Kassar la mère et Lara Matar sa fille et sans leur registre et à leur manière les hommes joués par Gabriel Yammine et Pierre Chamassian. Il faut attendre la séquence finale et près générique pour que s’inverse le postulat et que les personnages révèlent au touriste égocentré le véritable visage de leur pays. La chanson très easy-listening « Quand tu t’en vas » voit en effet s’enfuir le bonheur avec l’invasion israélienne pour tout décor où se tient cette famille libanaise prospère et heureuse, dont seule la bonne asiatique fait tâche. Au bout du compte, c’est la guerre au Liban qui a ramené le français à la vie. Tout un symbole…
Il était une fois l’histoire libanaise
Des fragments du passé remontent à la surface grâce à la puissance créatrice. C’est du côté des femmes, comme souvent, que la mémoire peut redevenir un outil d’analyse et une étape bienfaitrice dans une acceptation de l’impossible résilience.
Le premier jalon en a encore été posé par Jocelyne Saab dès 1994 et son introspection cinématographique Il était une fois à Beyrouth, véritable kaleidoscope en noir et blanc et technicolor (ou Eastmancolor pour les européens) sur la représentation de Beyrouth dans l’histoire du cinéma libanais égyptien, américain comme européen. A contrario des historiens du cinéma vitupérant le colonialisme culturel, Saab embrasse d’abord le point de vue curieux de ses deux Shéhérazade, tout droit sorties de Céline et Julie vont en bateau pour plonger gaillardement dans le monde enchanté du cinéma populaire, ses intrigues, ses stars et ses excès. L’entame tient du conte, comme si le cinéma avait le pouvoir d’annuler les malédictions, à commencer par celle des enlèvements, puis celle de la destruction du patrimoine cinématographique, ici conservé par une légende urbaine, le dénommé Farouk. Tant que le film dialogue avec la fiction l’ensemble est frais, dynamique et même merveilleux. La réalisatrice parvient notamment à incruster les corps de ses héroïnes dans d’anciens films, parfois simplement reconstitués, recréant ainsi le monde intemporel du septième art.
Dans une seconde partie, cédant à ses impulsions didactiques de documentariste, la cinéaste fait affleurer une réflexion plus critique sur l’image des libanais véhiculées dans les films occidentaux. L’extrait d’un film français racialiste des années 30 est en cela éclairant et plus qu’écœurant. On voit bien comment les colons ont divisé les habitants pour s’approprier leurs richesses naturelles. « L’indépendance, patience… On finira bien par la reprendre un jour ». Jocelyne Saab ne se trompe pas de cible, elle ne s’attaque pas aux films ou à leurs auteurs mais bien au système dont ils sont la vitrine idéologique. Enfin, dans une cinématographie qui a tant cartographié sa capitale, l’auteure nous emmène sur des chemins différents et qui tranchent avec les artères habituelles, créant un dédale subjectif et mental, même si très cinématographique.
En 2021, Joana Hadjithomas s’inspire de son propre exil pour ouvrir la boîte de Pandore des souvenirs, la Memory box. Toujours réalisé avec son compagnon et alter et go Khalil Joreige, le film est plus accessible au grand public puisque basé sur la transmission du récit familial dans l’expérience de l’exil. Coproduction avec le Québec, elle n’évite pas l’écueil de la nostalgie mais l’accueille, le creuse et le transcende. Justesse des rapports humains et des personnages et dramaturgie tranquille se conjuguent avec une vraie recherche dans la mise en scène, l’image. Le duo n’a rien perdu de sa richesse là encore expérimentale et pluridisciplinaire, réalisant leur œuvre la plus émouvante et ouvrant peut-être sur une nouvelle période. Joana Hadjithomas a aussi beaucoup mis d’elle-même dans ce portrait d’adolescente durant la guerre civile, comme dans ce personnage de femme mûre frustrée, qu’elle aurait pu devenir si elle n’avait suivi la voie de son cœur et de la création et c’est aussi ce qui donne sa grande authenticité au film, succession de moments volés au travail inéluctable du temps. Pour ce faire la mise en scène innove constamment et propose même un digest de trente ans de création d’avant-garde libanaise à travers ses techniques et ses motifs (l’œuvre inspirante d’Akram Zaatari n’est pas loin).
Mais là encore le duo magique parvient à fondre ce travail ébouriffant dans un récit à deux temps, dont les raccords somptueux travaillent à l’abolir, et un ton pop qui leur colle désormais à la peau quand il n’était encore que circonstanciel (A perfect day, The lebanese rocket society). Comme pour A perfect day ou plus encore, la musique joue ici un rôle primordial, le véhicule de la mémoire affective et renvoie chaque spectateur à sa propre histoire et à ce qui nous aussi nous constitue. Love like blood. Et c’est ça le cinéma populaire ! Enfin, cette fois, avec ces retrouvailles, les fantômes reviennent d’entre les morts et la vie reprend ses droits. Tant mieux pour ce beau personnage de mère fatiguée, qui trouve alors grâce aux yeux de sa fille. Un film de réconciliation qui fait du bien ! Parmi les productions d’Abbout P., c’est aussi la preuve qu’on peut produire un cinéma en apparences plus conventionnel en restant fidèle à ses thématiques et à sa façon de faire. La critique française (Cahiers…) n’a pas hélas toujours pris la mesure de cette accélération.
Sur le versant documentaire, il faut évoquer le remarquable travail sur la mémoire de Lokman Slim, éditeur et activiste ayant étudié la philosophie en France. Il a tenté de faire subsister un courant réformiste et humaniste chez les chi’ites et son influence fut réelle de la Bekaa au sud Liban, en passant par Beyrouth sud. C’est en fondant Umam Documentation & Research que son travail sur la mémoire, d’abord à travers celle de la guerre civile, prend tous son sens : lutter contre le tabou historique et contre la transmission de la violence civile. Il est également responsable de l’exposition Missing, consacrée à partir de 2008 aux disparus et à leurs photos, en relation avec les familles et comités de soutien.
Il ne vient au cinéma que sur le tard, à partir de 2001 en produisant des films puis en co-réalisant Massaker (2005) avec sa conjointe Monica Borgman et Hermann Theissen, primé à Berlin. Le témoignage est brut, sans filtres, mais le dispositif cinématographique radical. La parole des bourreaux de Sabra et Chatila est audible mais ils restent invisibles aux yeux du spectateur, silhouettes tentant de décrire les faits, avec l’enthousasme enfantin de l’innocent qui les revit parfois. Une bonne partie de la presse française n’y a vu que pose artistique et opacité (« mascarade pénible » écrit un Frédéric Strauss traumatisé dans Télérama!), préférant sans doute la matérialisation d‘une barbarie propre à l’être humain, plus facile à évacuer philosophiquement, quand il n’y a encore ici qu’enchaînement de faits et de circonstances (comme durant toute la guerre civile libanaise !). Cette distanciation était absolument nécessaire pour éviter toute personnification du mal dont on a pu voir ailleurs les limites morales de sa représentation (The act of killing, certains films sur les commissions de réconciliation au Rwanda…). C’est sans doute difficile à soutenir mais irréprochable esthétiquement, donc moralement !
Lokman Slim a notamment milité pour la laïcité au sein du mouvement Hayya Bina, car il comparait en 2005 les différentes communautés religieuses « à des cellules dans lesquelles les libanais sont enfermés ». Ce même mouvement a participé à promouvoir l’éducation civique dans de nombreuses régions, notamment celles à majorité chi’ite, comme les cours d’anglais pour les femmes. Ils ont pu aussi se positionner contre les pesticides dans l’agriculture et pour une meilleure gestion des déchets, problème récurrent dans un pays aussi petit et aussi peuplé, et ce depuis la guerre civile (la mythique montagne de déchets de Saïda, haute de 58 mètres de haut dans les années 90!), devenu sujet brûlant dix ans plus tard lors de la fameuse crise des ordures (mouvement « Vous puez »).
L’assassinat de cette figure importante de la société civile pose bien des questions. L’enquête de Jean-Pierre Perrin a pris très au sérieux les accusations de Lokman Slim envers le Hezbollah, accusé de complicité avec le régime syrien et les russes dans un trafic de nitrate d’ammonium mis à jour par la chaîne arabe al-Jadeed, destiné à contourner les sanctions contre Damas, produit chimique dont Bachar aurait besoin pour élaborer ses armes chimiques. Cette piste est pourtant corroborée par l’assassinat mystérieux de plusieurs responsables du port de Beyrouth après l’accident, par le fait que les propriétaires de l’entreprise mozambicaine Savaro united restent… inconnus et par l’ensemble des pressions exercées de toutes parts pour enterrer l’enquête, établir les responsabilités et mettre à jour la corruption de tous les hauts responsables. Bref, cette hypothèse est nettement moins stupide que celle du président Michel Aoun sur l’attaque d’un éternel ennemi extérieur. Par ailleurs, le Hezbollah n’a cessé de jeter de l’huile sur le feu, d’une part en prenant les armes dans la rue contre les forces libanaises, et d’autre part, en freinant les dossiers de responsables accusés de corruption via un juge de la cour d’appel appartenant au groupe allié Amal. Ses dénégations n’ont sans doute pas convaincu les électeurs libanais quand la thèse du simple accident et de l’incurie convient parfaitement aux occidentaux pas trop pressés de se frotter à Vladimir Poutine, encore moins aujourd’hui ! Macron a beau jeu de se poser en promoteur des réformes… Le crime profite en tout cas à beaucoup de monde, et une fois encore, la population libanaise, et donc Lokman Slim, en ont fait les frais.
Il est temps de reparler ici du trublion Christophe Karabache ! En effet, ce perpétuel chroniqueur de la dévastation a abordé à deux reprises la destruction du port de Beyrouth, une première fois avec la fiction hybride Kamaloca (2021) et très récemment dans le documentaire expérimental Kalashikov society (2022), édifiant à brûle pourpoint un diptyque passionnant. L’auteur le revendique, le film a été tourné dans un état d’urgence, la fiction venant au secours des images de destruction pour brosser une allégorie d’un état du monde au moment du big bang ce 4 août 2020, un « paysage d’évènements » (Virilio), un « panorama zéro » (Richer). Il y a d’abord la puissance du travelling avant parmi les débris, une caméra qui panote de bas en haut pour découvrir un front de mer ravagé, images qui s’entrechoquent et ne cessent de revenir à la charge, puis buttent sur la toute puissance monolitihique d’un gratte ciel et d’un pouvoir obscur, « el mur » contemporain qui sert d’écran et de mémoire, ce « démonstrateur de l’accident » comme l’appréhendait Virilio. Rarement Damoclès aura été plus présent dans les vues urbaines verticales du cinéaste. Et sa ville, les trippes à l’air…
Karabache va alors raconter, par spasmes, l’histoire de ce port depuis la banlieue parisienne en une démarche rimbaldienne. Ou caraxienne quand des personnages marchent rapidement dans Paris, que les corps se trouvent. Paris-Nevers-Beyrouth… Une même apocalypse. Plus loin, une fille cite opportunément Hakim Bey. Ex-TAZ, flux du périf’ plutôt que du net. Programme terroriste alternatif mais sans Bobonello, fantôme japonais sans Japon, mais avec mari sumo. Formidable plan d’une étoffe flottant sur la rue, prise dans les rets de la ville. L’espace sans fin d’une séquence, Karabache relie un environnement industriel blême à un couple maladif, aliéné, peut-être la séquence la plus forte d’un film éminemment rituel qui tente par la magie du cinéma de conjurer la catastrophe. Sabbat, androgynie, décadanse. Toujours en cultivant constamment l’inattendu, en rendant public le privé. En construisant son récit depuis le coeur des ruines, cette ruine même de ses origines. Les codes du polar viennent alors s’accoupler avec le cosmos pour muter sans préavis vers le torture porn. Il débarque in extremis et rien ne nous est épargné puisque catharsis. Chef opérateur portugais aidant (Pedro Perreira Gonzo), Kamaloca est un sommet visuel dans l’œuvre du réalisateur. Son montage a la force de la débâcle au printemps. Les prix pleuvent… Ses plans ont le plus souvent leur propre morale et tout y a un coût. Et voir plusieurs fois le film provoque la transe (mon royaume de vent pour une édition dvd!!).
« Sommes nous vraiment dans un nouveau genre de guerre ? » La question de cet habitant a du sens quand les intérêts des puissants ôtent la vie au peuple en un éclair. Il est aussi compréhensible que l’auteur soit aux prises avec son karma. Le plan d’arrivée de Kalashnikov society était pourtant grandiose et lumineux mais pythie moderne, Christophe Karabache plane sur la ville comme une menace. Au premier visionnage, il est facile de préférer la force du réel qu’aèrent des intermèdes fictionnés (si on peut le prouver!). Mais on est vite saisis par la variation, la répétition des plans du montage seulement altérée par l’accélération du temps. Karabache voit rouille et pourtant… Ulrich Beck parlait de « catastrophe émancipatrice », produisant du bien public dans l’urgence politique. Virilio suggérait lui de partir de la fin pour aller vers le commencement, d’autant que « la grandeur de la pauvreté, c’est de faire face ». Ainsi soit-il. Comme dans Beirouth kamikaze et comme depuis le commencement, Christophe Karabache n’échappe pas à son destin. Il a enregistré la vox populi, senti monter l’électricité, tout coule alors vers l’affrontement pas cool, même si, plus que la rage, la belle énergie de jeunes manifestants tambourinant aux portes du château de Kafka ne reçoit comme écho que le son des sirènes et le bruissement métallique des drones. Il choisit alors de filmer ailleurs. Ce paysage final est bien un commencement du monde, le début de quelque chose d’autre et avec Karabache, l’inconnu est toujours beau.
L’IESAV, les Beaux-arts et autres écoles, pépinières de talents
Le festival Né à Beyrouth aura permis la présentation de très nombreux courts-métrages, en premier lieu d’une bonne partie des cinéastes sus cités, mais aussi et plus modestement de tous les films étudiants tournés à cette époque. L’IESAV (Université St Joseph) a vu défiler pas mal de monde. On ne retient que très peu d’exemples, pris au hasard des découvertes…
The green zone (2008) de Raed Younan est un beau court qui commence bien avec un bon concept et des idées visuelles pour évoquer les cloisonnements sociaux des êtres. La première scène évoque ainsi la ligne verte de la partition de la capitale et aussi les enlèvements. Dommage que ce beau départ autour de la notion de présence-absence se perde un peu par la suite . Younan est à tous les postes côté son (montage, mixage, musique, prise de son), il deviendra par ailleurs l’un des techniciens libanais les plus en vue dans ce domaine. On lui doit aussi un très étrange court, Patchwork, qui a vraiment une belle ambiance (un poil underground, à la Karlitch). Toujours à l’IESAV et avec Djinn house productions, il réalise Vieux (2010) sans doute son film le plus abouti, sans paroles, avec un regard singulier (ou… une oreille à la place des yeux?), un montage au cordeau et une étonnante partition qu’il a lui même composée. Il est vraiment regrettable qu’il n’ait pas réalisé d’autres films par la suite !
Parmi les plus intéressants, le court d’animation The star keeper (2008) de Lama Sawaya, poétique et mélancolique, qu’on sent nourri d’une vraie force intérieure et d’une approche sensible et très personnelle, un court soutenu notamment par Rana Eid. C’est justement le département du son auquel se consacre par la suite cette cinéaste en herbe, rejoignant là encore de nombreux libanais préoccuppés d’expérimentation et de qualité sonore. Y aurait-il une véritable école libanaise de sound designers ? Oui, car elle s’impose comme une évidence par sa qualité.
Très récemment, Laetitia Moya Moukarzel y a tourné une timide adaptation de Maupassant (Hangman, 2012) mais pas exempte de qualités, avant de poursuivre ses études en France où elle a monté sur un scénario intelligent le projet d’anticipation court You are now connected qu’on serait curieux de voir.
Du côté de l’Université de Balamand, l’académie libanaise des Beaux-Arts (ALBA) a révélé le talent précoce dans le cinéma d’animation d’Ely Dagher avec Beyrouth (2007), à l’étonnant graphisme longiligne et sensuel entravé par une ville dystopique, qualités qui allaient vite être confirmées par la suite et couronnées de succès. Le plus souvent et comme dans toutes les universités du monde, on perd la trace des étudiants dont ne surnagent que quelques films de fin d’études. André Chammas présentait dans Wayn yo zahle (1998) un ton enjoué, une qualité technique mais sans convaincre tout à fait. Toujours avec un côté oriental prononcé, le Afif (2014) de Julien Kobersy rend hommage au cinéma, quelque part entre Il était une fois Beyrouth et La party. Un peu appuyé mais il y a de beaux plans qui surnagent dans cet ensemble de vignettes proches du music-hall. Il a plus tard été monteur de Fayez Abou Khater, auparavant auteur lui aussi dans cette même université du court Héritage (2013), sur deux gamines survivant durant la guerre civile, reconstituée façon images d’Épinal et filmée de façon peu convaincante en vidéo en un vague found footage.
À l’université Notre Dame, Joey Saad tourne Bel dollars ama bel Lebnene (2011), un court qui ne laisse pas encore entrevoir toutes les qualités techniques de l’excellent chef opérateur qu’il deviendra, notamment pour Mounia Akl.
Du côté de l’Université américaine de Beyrouth, Karim Kassem a réalisé de beaux débuts avec le court à fleur de peau Red pearl (2012), un néo-noir affichant des ambitions de styliste qu’il va ensuite développer dans de nombreux courts tournés aux États-Unis où il part étudier et dont certains retrouveront le Liban (The awakening et Father en 2017). Il exprimera cette double appartenance et cette crainte du retour dans son premier long Only the winds (2021). Puis présent à Beyrouth lors de l’explosion du port dans laquelle il est blessé, il en tire le fascinant film Octopus (2021). Un cinéaste suffisamment ambitieux et à part pour qu’on aie envie d’attendre la suite !
À l’ALBA-UOB, école des Arts décoratifs, on peut signaler le petit film d’animation de Chadi Aoun, Le baiser (2005), encore assez minimal. Appliquant ensuite aux arts graphiques dans la publicité, à la musique et autres domaines son slogan, « Le mouvement, c’est la vie », il a participé à différentes expositions dont Retrieving Beirut en 2016 avec Ghabra- the city notamment, réalisé l’étonnant clip animé Ahawa (Hey you!) dans un abri durant l’attaque israélienne de 2006. Ce contexte paranoïaque détermine chez lui aussi sa création. Il a ensuite rencontré un succès mondial en festival avec le très beau court animé et dystopique Silence (2016). Il tourne également des vidéos de danse pour les compagnies libanaises.
About Nés à Beyrouth et Abbout productions
En reprenant Abbout productions en 2005, Georges Schoucair avait pris soin d’agir également en aval sur la distribution des films libanais, arabes et internationaux, en créant Métropolis, le complexe art et essai de référence à Beyrouth. Son action s’est aussi diversifiée par la production et le soutien aux grands auteurs étrangers, occupant ainsi une place prépondérante dans le monde arabe, mais également très importante sur l’échiquier mondial. Depuis 2010 et plus encore après 2015, un cinéma d’auteur libanais plus grand public s’est développé et s’impose à l’international, ainsi que le déclarait Pierre Sarraf en 2017 à Joseph Korkmaz : « Depuis quelques années, pas un festival de catégorie A ne passe sans un film libanais au programme ! ». Selon Georges Schoucair, non seulement la production nationale a été multipliée par 10, mais « les films libanais sont aujourd’hui mieux structurés avec des qualités artistiques nettement supérieures (par rapport à l’image, au son aux décors et costumes…) », en tout cas au regard des standards internationaux des festivals, même si les financements patinent encore. Ceci s’explique par l’arrivée de la précédente génération d’étudiants libanais formés dans tous les secteurs (technique, production…). Pierre Sarraf est d’ailleurs enseignant aux Beaux-Arts pour la Production. Mais le boss d’Abbout prod pointe aussi un phénomène que l’on sent jusqu’à la France : la solidarité entre des acteurs professionnels et une passion commune pour le cinéma. La professionnalisation ne fait encore que commencer mais déjà la liste des films s’allonge…
Acteur, Bassem Breishe passe à la réalisation après 2007, signant trois courts-métrages témoignant d’évidentes ambitions formelles, avec Both (2007) présenté à la Semaine de la Critique, Ziu (2013) et Free range (2014). Il est également scénariste de films et de webséries et fondateur du collectif Scenario Beirut. La websérie Shankaboot (2009-2011), qui suit les péripéties d’un jeune livreur dans Beyrouth de façon réaliste, a fait parler d’elle et lui a valu des prix mérités à l’international. Depuis, c’est cette activité de scénariste qui semble primer.
Un des plus importants cinéastes libanais apparu dans les deux dernières décennies a été Wissam Charaf, un résident français depuis 1998 qui a d’abord travaillé pour la chaîne Arte comme cadreur pour des reportages sur des zones de conflits ou comme monteur et pu ensuite financer ses films courts, puis le long-métrage Tombé du ciel (2016) sélectionné à l’ACID et coproduit par Né à Beyrouth. Un cinéma qui fut d’abord d’apparence simple et qui fait la part belle à ses personnages du commun, héros de situations plus grandes qu’eux. Ainsi en est-il de son photographe sportif timide et rondelet amoureux d’une belle cavalière d’un milieu social huppé dans Hizz ya wizz (2004) et qui tente alors une communication épistolaire et poétique. Le ton est nouveau au Liban, il s’affirme vite. En 2007, L’armée des fourmis convoque l’esprit de Kaurismaki dans un court autour des dangers du déminage ou comment dénoncer la difficile situation du Liban rural en faisant rire du drame. Il y maîtrise d’ores et déjà l’espace, le timing des gags, ainsi que les couleurs.
Il réalise par la suite le documentaire It’s all in Lebanon (2012) sur une proposition de Georges Schoucair, sur l’alliage explosif entre prop et propagande et qui sera primé à Carthage. Puis en 2016, il tourne le court-métrage Après sur le difficile retour d’un libéré de prison dans son village d’origine. Très réussi le film se distingue par sa narration et son utilisation du non-dit. Le vécu des personnages subtilement éludé renforce l’intensité de la rencontre entre cet homme marqué, mais chez qui l’on sent une morale et cette jeune fille riche partie en vrille. Un érotisme tout en retenue car pour l’auteur, l’après-guerre crée « ce principe de l’incertitude. Ce refoulé qui a fait de nous… des refoulés ». Le mélange et la situation pourraient être explosifs, le film est une bombe à retardement mais qui au contraire du film précédent, n’explose pas, à l’image de cette séquence décalée où il retrouve un ami devenu handicapé en fauteuil roulant mais qui roule encore des mécaniques. « Eye of the tiger… » façon chevalier noir de Sacré graal. Chez cet exégète du portugais Joao Cesar Monteiro mais qui ne craint pas non plus de citer Carpenter pour son goût du démesuré, il s’agit toujours pour Charaf de « déminer la charge dramatique » !
Tombé du ciel (2016) fait partie des grands succès du cinéma libanais en festival, alors que paradoxalement il réveille la mémoire de la guerre civile à travers la figure du milicien redescendu de sa montagne et que tous croyaient mort. À noter la différence de traitement du sujet avec le protagoniste de Beyrouth fantôme. Il s’agit d’abord d’une figure sacrificielle qu’on croit d’abord dialoguer avec le Mohamed Chahine de La vallée, qui réactive l’esprit de la guerre civile dans le Liban contemporain en proie à la tension sourde et qui permet à Charaf de se moquer de toute l’absurdité des comportements. Le jeu burlesque est minimal mais pas neutre façon Suleiman. Une pointe d’ironie allume les regards de comédiens tout en retenue. On a comparé Wissam Charaf à, en vrac, Kaurismaki (ça n’est pas faux pour la composition des plans, le soucis du détail, les couleurs et surtout la maîtrise d’un tempo comique à contretemps), à Jarmusch (une certaine dérive), à Tarantino (la répartie) et à Suleiman (le clin d’oeil des policiers, l’ambiance sonore, le minimum de dialogues), ce qui prouve sans auncun doute qu’on tient un auteur d’importance ! Il a d’ailleurs un court et un long en préparation. Sa carrière ne fait que commencer et apporte un contrepoint à l’humour de Khaliffé.
Parmi les derniers succès internationaux du cinéma libanais, il y a le récemment sorti en France Liban 1982 (2019) de Oualid Mouaness, prix FIPRESCI et prix Jeune public au Cinemed de Montpellier, néanmoins étrillé par la critique française moins sensible à la force et l’ampleur de ses plans qu’au classicisme de sa bluette enfantine (on pourait penser en mode mineur au Chala cubain). Au delà du premier degré (l’angoisse du personnage de l’institutrice porté par Nadine Labaki), il semble y avoir quelque chose de plus sensoriel directement issu d’une expérience personnelle de ce moment historique. A contrario le film a emballé la critique américaine et a beaucoup plus touché le public. Originellement producteur de vidéo-clips et de quelques documentaires, Mouaness avait réalisé un court aux Etats-Unis au début des années 2000, puis d’abord été remarqué pour le beau court-métrage The rifle, the jackal, the wolf and the boy (2016).
Diplômé en réalisation aux Beaux-Arts en 2012, Mir Jean Bou Chaya a tourné 8 courts-métrages depuis 2008 dont Filmmakers (2012). Very big shot (2015) est son premier long-métrage et coup de maître. Il s’agit d’un polar sur fond de trafic de drogue à Beyrouth où se retrouvent empêtrés trois frères. Primé dans les festivals (Marrakesh…), le film a été bien reçu sur le marché mondial notamment américain (festivals de Palm springs, San Francisco, Toronto…)
En 2021, Michel Kammoun a fait son très attendu come back avec Beirut hold’em, une plongée dans le milieu du jeu, avec à nouveau une action située sur une journée dans le Beyrouth de l’après-guerre et toujours cette adrénaline, déjà contenue dans un impressionnant trailer et qui prouve que Kammoun reste un des grands cinéastes de la tension urbaine.
Ce cinéma libanais qui s’en vient
Après l’ALBA, Ely Dagher a étudié à Londres. Il s’intéresse tout autant à la peinture et à l’installation qu’au cinéma. Parmi ses genres de prédilection, le surréalisme, la science-fiction et même l’occulte dont il tisse ses fictions. Ely Dagher a obtenu la palme d’or du court-métrage pour Waves 98 (2015). On retrouve la même angoisse existentielle que dans Beyrouth et les visages dépressifs aux traits tirés. Dagher ajoute les images des médias qui elles gardent leur aspect visuel, comme si elles étaient autonomes. L’animation va alors servir à créer une échappatoire à la lisière du conte. Un éléphant en forme de cheval de Troie débouche sur une illusion psychédélique, une invitation à réécrire son quotidien sous un angle plus enchanté. Même si l’angoisse et la tension ne s’évaporent pas tout à fait, il y a une possibilité d’évasion vers l’ailleurs, une promesse contenue jusqu’à la fin. Un curieux court qui confirme la singularité de l’auteur.
Changement de style pour Face à la mer (2021), son premier long présenté à la Quinzaine des réalisateurs. L’ambiance est toujours la même, une ville « flottante » où tout semble suspendu, mais le traitement a l’apparence du cinéma réaliste et l’héroïne les traits de Manal Issa, décidément incontournable – la seule roquette jamais tirée en notre direction de puis le Liban ! – ici somnambulique. Face à la mer est encore un film de retour d’exil, ce qui est après tout de plus en plus fréquent dans un pays qui continue à se vider de sa jeunesse. Un film d’avant l’explosion, grave, lourd, prémonitoire, où la mer est grisée et la ville n’a jamais été filmée avec ces profondes plongées zénithales, qui plaquent les humains au sol. Un beau film qui retrouve la mélancolie de la génération de l’après-guerre.
Très attendu, le premier long de Mounia Akl a été primé dans de très nombreux festivals de par le monde (dont un prix de la critique au Cinemed de Montpellier).
Mounia Akl est une des auteures les plus représentatives de la nouvelle génération. Après avoir fondé Orange dog, sa structure de production, elle coréalise un premier court-métrage fondateur Beirut, i love you ( i love you not) (2009) qui constitue une variation sur Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (qu’elle n’a pas de mal à transcender, rassurez-vous, son sens de l’observation allant bien au-delà des chromos de Jeunet), musical, dynamique et totalement intégré à sa ville (le souk de Jbeil), au quotidien de la population beyrouthine, même si la romance constitue le coeur, moins resplendissant qu’elle, du film.
De ce petit coup d’éclat indépendant qui souffre à peine de quelques excès de montage, elle a réalisé avec son ami et coauteur Cyril Aris la websérie Beirut i love you (2011-2012) qui a connu un grand succès et 44 épisodes. Réalisée avec beaucoup d’imagination et d’enthousiasme, elle crée des situations farfelues en poussant la gradation de l’absurde juste un cran et demi au-dessu de la réalité. Dans l’épisode 12, déjà intitulé La chute du régime, de jeunes colocataires sont confondus par la dernière nouvelle des infos : le gouvernement a interdit la cigarette, autant dans la sphère privée que publique. C’est ce moment de bascule particulièrement violent qui est traité avec humour et lorgnant vers l’inventivité visuelle du mockumentary. Le sommet de sa collaboration avec Aris ! Et au final, un appel à la lutte sur la superbe chanson Eiskat al nisam de Zeid Hamdan (Soapkills). En 2014, elle s’intéresse aux religieuses dans Christine, son premier court à être primé dans les festivals étrangers.
Comme Nadim Tabet avant elle, Mounia Akl s’intéresse à la publicité, à la mode (11 minutes pour Sandra Mansour, très inventif et aux nombreuses beautés, le minéral Hymne à la vie pour Elie Saab et bien d’autres) au clip (Kinematik) ou au documentaire (2190 days in Beirut, sur une domestique éthiopienne) autant qu’à la fiction (elle en réalise aussi à l’étranger comme Eva) dans une curiosité qui paraît insatiable. Ayant initialement étudié l’architecture à l’ALBA, elle aborde le sujet de la reconstruction mais dans son rapport à la mémoire, dans le très trippant Skeleton heart- architecture film. Son directeur photo Joe Saade lui offre le meilleur de lui-même.
Submarine (2016) était un beau film de crise, un film de fin du monde où une population doit fuir les pluies acides provoquées par la pollution, hélas censuré au Liban. Les montagne de déchets y envahissaient cette fois l’espace privé de tout un chacun, à travers le quotidien d’une héroïne, une résistante jouée par Yumna Marwan qui, en plein déplacement forcé de population, cherche un ouvrier pour lui réparer sa fenêtre, pour peut-être, pouvoir rester. Le film était aussi celui d’une conception de la vie en communauté, en quartier, qui reprend ici dans ce cabaret l’espace d’un instant. C’est là que se réaniment tous ces gens qui semblaient figés dans le décor, dans l’irréalité et l’absurdité d’une situation trop totalitaire pour être vraie. Mais au Liban, la réalité a dépassé bien des fois la fiction…
La beauté de ce court-métrag réside encore une fois dans sa mélancolie, dans ces allers-retours et ces travellings entre les souvenirs du dedans qui survivent encore dans cette oasis et deviennent immédiatement déchets au dehors, en une façon de consommer le temps qui passe. Un cri d’alerte émouvant comme cette marche sur la colline d’ordures qui remonte le temps jusqu’aux vestiges antiques, avant que dans un volte face, la fille ne lâche prise et prenne elle aussi sur la plage originelle de l’éternel recommencement, le chemin de l’exil. Manière d’inscrire sa lutte dans une perspective réaliste, car on peut soulever des montagnes mais peut-être pas aussi facilement celle de Saïda ! Ici encore, on retrouve cette envie de stopper le temps, la petite nostalgie amélipoulinesque, fondatrice de son cinéma depuis Beyrouth i love you, (i love you not). Submarine a connu un parcours exemplaire et mérité dans les festivals du monde entier. Il clôt sans doute cette période de formation de la réalisatrice qu’elle s’apprête à devenir.
Ce film lui a servi de tremplin pour aborder le sujet des déchets dans Costa Brava, Lebanon (2021), en salles en France ce mois de juillet. Oubliez l’Espagne car ce nom évoque une décharge gigantesque et problématique de la capitale (la vision cynique du gouvernement de « châteaux en déchets »?). L’auteure a largement participé à l’époque au mouvement citoyen (voir son beau clip The lebanon i dream of). En centrant son scénario sur une famille d’ancien militants bobo écolos (Saleh Bakri et Nadine Labaki), vivant en autarcie dans la montagne, la cinéaste a fait du sujet de la pollution et de la corruption l’affaire de tous les libanais, dont pas un seul ne peut penser échapper au problème. Le film lui permet également de traiter de la pression qu’exercent les affaires intérieures du pays sur la cellule familiale et sur une population en perpétuel état de crise. Le film a trouvé un important écho dans le monde arabe, notamment en Égypte.
A l’instar de Submarine, le conte n’est jamais loin, ici à hauteur d’enfant et il permet à la métaphore (un pays poubelle) de se déployer. Autre atout majeur, la bande-originale de Zeid Hamdan, primée au Cinemed de Montpellier. Et question fidélité encore, c’est aussi le succès d’un accompagnement commencé avec Abbout productions bien en amont (le court poético-fantastique El gran Libano (2017) coréalisé avec Neto Villalobos et déjà présenté à la Quinzaine. Mounia Akl est donc la « belle personne » du cinéma libanais et on s’attend à la voir briller pour longtemps dans les festivals du monde entier, d’autant qu’il risque d’être risqué d’essayer de la faire taire.
Issue de l’académie des Beaux-arts, Rana Salem s’est faite remarquer par son film de fin d’étude First floor to the right (2004), présenté notamment à la Berlinale et qui dévoilait une surprenante maturité et une irrésistible attirance pour l’intime, une drôle de façon de filmer les intérieurs, une narration musicale et un sens inné de l’image. Ces caractéristiques, elle les exporte ensuite lors d’un échange avec une école du Danemark (Essay from a room, 2010, quasi bergmanien) imposant dès lors une pâte. En 2006, pour le projet Vidéoavril, elle tourne Window, une des vidéos les plus originales à être initiée durant l’invasion israélienne. Divers courts tous azimuths (Le ballon rouge, un mélange sympathique d’images réelles et d’animation), des webséries et pubs à gogo, complètent une première époque.
Pour son premier long-métrage, The road (2015), Rana Salem a tenu à représenter une image différente du Liban, sa face « interne » puisque s’il s’agit de retour, c’est à l’image de La montagne de Ghassan salhab, d’une recherche sur soi pour un couple décidant de se replier dans les hauteurs du Liban, sorte de préquelle à celui de Mounia Akl. La richesse formelle de certains plans le dispute à un naturalisme peu présent au Liban et il faut ajouter qu’elle interprète elle-même le personnage de Rana face à son véritable conjoint, poussant un peu plus loin l’autofiction. La musique joue un rôle central, autant les morceaux cultes et fondateurs de son bagage culturel, que le travail avec Charbel Haber. Autoproduit, ce coup d’essai et de maître augurait d’un bel avenir. Mais où est-passée Rana Salem ? A-t-elle préféré l’agriculture bio ?
Parmi les poulains d’Abbout productions, Ahmad Ghossein, réalisateur de All this victory (2019). Formé en théâtre à l’université St Joseph, puis à l’Académie nationale des arts d’Oslo. Son court Opération Nb (2004) sera primé au festival de Beyrouth, puis il se fait connaître hors des frontièrtes par le court documentaire My Father Is Still a Communist (2013), suivi de The Fourth Stage (2016) qui paraît très décalé. On le retrouve avec Abbout productions à Cannes en compagnie de Mounia Akl et de la Lebanon factory pour White Noise (2017), réalisé avec Lucie La Chimia et dont l’ambiance (et parfois une certaine fixité associée au grand angle) évoquent Suleiman en beaucoup plus cruel, comme avec ce personnage qui ne cesse de se jeter des ponts routiers. Il excelle à mettre en scène la ville dans l’espace, à l’utiliser. Il partage aussi avec le maître palestinien un même sens de l’absurde, le goût de la poésie et de l’onirisme. Pour son premier long, All This Victory (2019), il crée un espace poétique en plein conflit au sud Liban, qui devient au fur et à mesure plus claustrophobique et très symbolique. Le film a été primé à la semaine de la critique à Venise.
Un cinéma commercial et une véritable qualité
À partir du début des années 2000, on assiste à l’explosion graduelle d’un cinéma très commercial inspiré à la fois de la télévision et des méthodes hollywoodiennes, à la fois pour les scénarios qui s’en inspirent sans scrupules et pour la direction d’acteurs. Ça paie auprès du public, rentre de l’argent (ça tombe bien, l’argent est au centre d’au moins la moitié des intrigues !) et confirme qu’une industrie du cinéma libanais est bien née, malgré l’absence de soutien public et en dehors des financements internationaux. Un des artisans de cette réussite, le producteur Jamal Sannan et compagnon de route d’Elie F Habib.
Formé au théâtre et à la mise en scène à l’Université américaine de Beyrouth, Elie F. Habib fait comme beaucoup d’autres ses armes à la télévision libanaise au début du millénaire en tant que monteur, puis réalisateur et connaît le succès avec la série Ibnat al mohalem en 2005 avec Carmen Lebbos. Il va en tourner de nombreuses autres et puis deux longs au cinéma. Le second, Restez avec moi (2008), imagine une idylle entre un gentil chauffeur de taxi beyrouthin et l’ancienne compagne d’un maffieux (un « Nabil », prototype du moustachu borderline et fanfaron depuis Petites guerres) à la tête d’un important trafic de drogue. Ce polar romantique et volontiers mélodramatique est très bien réalisé, avec un goût et une sophistication qui rompent avec la manière de faire de la télévision. Autre qualité, la direction d’acteurs (Ammar Shalak et Nadine al Rassy face au très méchant Majdi Machmouchi) et des personnages qui portent ce beau film commercial où le peuple libanais a le beau rôle et prend sa revanche sur la corruption. Mais c’est en 2013 qu’il triomphe avec la comédie Bé Bé où une riche trentenaire de bonne famille se retrouve à la tête d’un pécule mais aussi avec un cerveau de huit ans d’âge mental.
Avec l’humour déjanté de Vitamin (2014) et sa sophistication visuelle, Elie F Habib transpose une nouvelle intrigue du même genre, centrée autour de l’argent, dans un village (à l’image d’une nation dans un film que l’auteur veut « patriotique » et y pousse les stéréotypes dans un jeu de massacre qui n’est sans doute pas du goût de tout le monde. Une comédie d’aventures atténuée par l’habituelle romance. C’est ensuite le kitsch qui prévaut dans Bingo ! (2016), mieux accueilli et qui met en scène dans des décors très colorés, un professeur de musique qui déteste les enfant et qui pour récupérer une fortune, doit prendre soin d’une vieille tante… âgée de sept ans ! Il enchaîne avec la comédie policière Wilaneh ! (2016) et la comédie sophistiquée Habet caramel (2017) où le caramel permet aux femmes d’entendre les pensées des hommes. Dommage qu’Habib ait un peu abdiqué ses ambitions de réalisateur qui se diluent dans des formes passe-partout trop télévisuelles au rythme de « chaque année un nouveau film », lui qui comparait les séries aux frites et le cinéma au caviar ! C’est un type intéressant et il pourrait beaucoup mieux faire.
Dans la même « écurie », Hannah Ramy (Time out, 2019), Nabil Lebbos (Kizbeh Baydha, 2018) et auteur en 2008 d’une nouvelle version de la vie de saint Charbel (Charbel, the movie, 2008) sous forme docu très fictionné mais peu affriolant, le comédien Amed Maher (Soue Tafahom en 2015) ou la comédie The second lady (2015), mais rien de bien remarquable en dehors des films à succès d’Habib.
Également venue de la télévision, Caroline Milan commence par la comédie de noël Christmas Eve (2011), autour d’une chanteuse pour enfants à succès qui rencontre le grand amour dans un quartier pauvre. Vient ensuite ce qui restera son film le plus ambitieux, Madame Bambino (2011), presque une comédie de remariage autour d’un conflit conjugal entre une épouse souhaitant se présenter aux élections et un mari qui refuse tout net cette idée. Ayant quitté le domicile familial, il devra se travestir en la gentille gouvernante Madame Bambino, mix évident entre Madame Doubtfire et la Tootsie de Dustin Hoffman. Les vieilles recettes marchant toujours et l’acteur Fadi Cherbel faisant le job, la transformation initiale pleine de couleurs et de musique et celle accidentelle et ses rebondissements, nous aident à passer le temps parfois agréablement, d’autant que le décorateur s’est lâché en créant un univers enfantin et kitsch avec perspectives déformées ou volumes modifiés. La cinéaste tournera quelques années plus tard une nouvelle histoire de mariage et d’héritage, Zafafian (2017), à l’argument plutôt mince (une grand-mère lèguera sa fortune à son petit fils s’il épouse une fille qui aurait pu être son amie), mais autour des origines arméniennes. La forme est toujours aussi télévisuelle, les couleurs et la direction artistique très présentes.
On doit à Shady Hanna une série de comédies sophistiquées (toujours dans des quartiers riches) et il commence par la comédie de mariage S.L Film (2000), qui se caractérise par une belle mise en scène empruntant largement, mais avec goût, au cinéma de genre et un humour, lui, totalement de mauvais goût. Franchement une curiosité ! Ce qui lui vaut d’être engagé pour signer la suite du succès de Khaliffé, Single, maried, divorced… 2 !
Après des études de cinéma à Beyrouth et New York, Sami Koujan est devenu à 34 ans un des plus prolifiques réalisateurs de la nouvelle industrie libanaise avec 10 courts-métrages et 5 films à son actif, dont la réussite de Cash Flow (2012) où une carte bleue presque magique procure 1000 dollars par jour à celui qui la possède, sauf que le type doit de l’argent à des mafieux qui ont vite fait de s’apercevoir de la manne. Encore une fois cette obsession pécunière en dit long sur une société libanaise étouffée par les crises économiques successives. Le film est correctement réalisé et se regarde plaisamment.
Enfin, Saif Shaikh Najib, lui aussi venu de la télévision (la série Alekhwa notamment), a débuté au cinéma avec Bel-Ghalat (2017) où quatre amis se retrouvent mêlés à un business louche à cause de WhatsApp. Un machin bien lisse et dans l’air du temps qui a d’ailleurs plu. Réalisé à la façon de la pire télévision, Welcome to Lebanon (2020) propose un portrait du Liban à travers un road movie ente la fille d’un immigré américain qui découvre son pays, un chauffeur de taxi un peu spécial et un maffieux pour guide. L’état d’esprit et la verve comique sauvent à peine l’ensemble…
Mais il est un auteur comique accessible au grand public et qui peut réunir les factions derrière son humour et ses comédies. Formé en Europe (Haute école d’art et de design de Genève ESAV-HEAD), Elie Khalifé a coréalisé dès 1996 de beaux courts sur le Liban avec Alexandre Monnier et financés par la Suisse dont Taxi service (1996) primé dans le monde entier et notamment à Locarno, centré sur une Mercedes, véhicule emblématique de la capitale comme on l’a vu précédemment. On y retrouve notre marchand d’armes préféré depuis Beyrouth fantôme, Hamza Nasrallah, aux prises avec le monde -réel- des fous. C’est drôle, sans prétentions et parfaitement bien réalisé !
Quant à Merci Natex (1998) sur l’intrusion chez une famille de paysans montagnards de la télévision et de ses telenovelas, c’est l’occasion de retrouver le grand acteur d’After shave, Rafic Ali Ahmad, dans une comédie rurale proche de Vers l’inconnu de Nasser, où les valeurs rurales éternelles et les habitudes se trouvent bousculées par une véritable épidémie de bêtise télévisuelle. La mise en scène qui inscrit cette historiette dans des paysages sublimes et un cadre de vie majestueux, fait tout le prix de cette perle, parfaite ambassadrice du renouveau du cinéma national. Viendront ensuite Love and cigarettes (2006) ou le très bref C’est la loi (2009), simple mais décalé et très léger.
En 2010, toujours avec son coréalisateur, Khalifé tourne enfin son premier long métrage, Yanoosak (2010) produit par Abbout productions et caractéristique d’un cinéma d’auteur grand public. Il a ensuite réalisé Single Married Divorced (2015), une comédie romantique à fort potentiel commercial qui décolle nettement du lot grâce à la beauté de sa mise en scène qui rend toute sa noblesse à la ville, en magnifiant notamment son front de mer et en tirant des plans étonnants du port, pas si éloignés du cinéma d’auteur de Salhab, pour une sophistication de la bourgeoisie locale et un point de vue féminin qui peut aisément rivaliser avec Caramel.
Enfin, State of agitation (2020) sur un très beau sujet où un cinéaste beyrouthin se trouve dans un état d’hyper inspiration caractérisé par un débordement d’idées sans fin, changera-t-il la donne à l’international pour cet auteur exigeant dont la singularité comique (« je rends hommage à toutes mes références cinématographiques comme John Turturro dans Barton Fink des frères Coen ou encore Nanni Moretti. ») mériterait de trouver une place dans les salles françaises après un beau parcours en festivals ? On peut toujours rêver de découvrir ce road movie dans le Nord du Liban ! « Je voulais montrer que rien n’est jamais abouti au Liban. Même un scénario tout simple peut s’empêtrer et aller dans tous les sens. »
Les cinémas indépendants et underground persistent et signent
Né en 1983, Badran roy Badran grandit à Beyrouth pendant la guerre civile, durant laquelle il découvre le cinéma grâce à un vieux stock du vidéo club voisin ayant mis la clé sous la porte. Après son diplôme, il rencontre le succès avec sa pièce St Simon est mort (qu’il qualifie de pièce chrétienne occulte !) mettant en scène 40 acteurs et qui fait 3000 entrées en une nuit, avant d’être interdite par l’Église. Il a aussi constitué durant ses études, une petite équipe de collaborateurs avec lesquels il réalise des vidéos présentées à Beyrouth. À 23 ans il commence à écrire A Play Entitled Sehnsucht qu’il imagine comme le premier film abstrait du Moyen-Orient. Il décide de traiter de la tendance à l’autodestruction des libanais (un des premiers sujets traités au Moyen-Orient?) à travers l’histoire de l’astronome Bernard Zeidan, mort en hôpital psychiatrique en 2008, décès qui entraînera un discours polémique de Badran accusant la guerre civile de son enfermement et son déni de l’avoir tué. Il semble en réalité qu’il n’ait pas vraiment existé réellement, même si le réalisateur aurait passé deux mois à observer un astronome interné dans des circonstances similaires. Film totalement indépendant, Badran mit cinq ans pour réaliser A play entitled Sehnsucht, sorti en 2012, devenu culte et peu diffusé depuis. On sent dans le trailer l’influence des formalistes des années 80 et 90 particulièrement de Lars Von trier ou de Caro et Jeunet. Le cinéaste a forgé un mythe, on aimerait le voir devenir réalité et au moins que ce film météore puisse trouver les spectateurs que sa folie créatrice mérite.
Née au Koweit mais élevée entre Beyrouth, Londres ou New York, Farah Al-Hashem est diplomée en journalisme de l’Université américaine, puis des Beaux-arts de l’Académie du film de New York. Ayant commencé à tourner en 2011, elle est remarquée dès 2013 et son premier court-métrage 7 heures, home movie épistolaire tourné en super 8, sur une liaison entre Beyrouth et l’Amérique, présenté à Cannes et primé dans de nombreux festivals et que l’on sent très autobiographique. Un film bien dans l’air du temps des réseaux sociaux ! Son long-métrage documentaire, Breakfast in Beirut (2015) sur treize libanais vivant en exil, mélange à nouveau les régimes d’images et reçoit un accueil élogieux, excepté dans son pays d’origine, le Koweit, lorsque le film est banni du festival national par la censure (elle consacrera le documentaire Femmes du Koweit à ce pays en 2018). Il constitue sans doute sa proposition formelle la plus aboutie à ce jour.
Farah Al-Hashem radicalise pourtant le geste et se tourne esthétiquement vers le film indépendant américain en tournant Ces petits riens (2018) dans un noir et blanc granuleux, jouant cette fois sur la composition du cadre et le format de l’écran. Le ton est toujours intimiste et la narration assez lâche. La citation de Camille Claudel en début de générique indique un film centré sur l’art alors qu’il s’agit à nouveau de l’histoire d’une relation, entre Paris et le Liban. Elle s’y moque de la stupidité de l’intelligence artificielle, réalisant un film où l’action est souvent sans action. Un film intéressant, avec de très belles choses, mais aussi un peu frustrant. Elle commence à Lyon une thèse consacrée à Bohrane Alaouié dont on peut sentir l’influence lointaine sur son travail, avant lui consacrer le documentaire Le cinquième jour (2018) qu’elle n’a pu sortir avant la pandémie et Confined in Paris (2020) présenté au festival de Beyrouth. Encore une personnalité forte et avec un bel avenir devant elle !
Selim Mourad, formé à l’IESAV avec l’essai documentaire Lettre à ma sœur (2008) et assez expérimental (A trip to the barbershop, 2010, un projet avec le Danemark), puis + (2010), déjà une mise en abyme de son cinéma et de ses obsessions, suivi des fictions La démolition (2011), puis La conception (2012, toujours pour l’IESAV) avec l’actrice Carole Abboud, une mise en abyme de ses travaux à venir, avec déjà l’idée de sa propre mort. Avec This little father obsession (2016), Mourad dénonce le patriarcat et sa mainmise sur le Liban à travers une forme qui combine le cinéma du réel et des passages purement fictionnels. Un film passionnant notamment présenté à Visions du réel.
Enfin son long-métrage Agathe Mousse (2021) est présenté l’an passé au festival du film libanais de Paris, alors que Mourad est en résidence à la Cité internationale des arts dans la cadre du programme NAFAS. Un film très actuel présenté à Rotterdam, où les personnages se cherchent sans cesse dans un contexte incertain et qui met en scène l’auteur lui-même dans une curieuse autofiction prémonitoire, assortie d’une forme qui évoque les installations qu’il mélange à ses films, notamment pour une trilogie débutée avec Linceul (2017), expérience en vase clos sur la nudité et les limites du corps développée avec cinq comédiens et Cortex (2018). Mourad est un auteur à suivre de très très près. Au marché du film de Cannes, était d’ailleurs présenté cette anné son court Tea with Adonis (2022), portrait d’un gay beyrouthin de 73 ans, synthèse de ses questionnements sur l’homosexualité le corps et la nudité.
« J’ai assisté, il y a 35 ans, à l’enlèvement d’un homme que je connais. Il a disparu depuis. Il y a dix ans, j’ai vu son visage en sillonnant la rue, mais je n’étais pas sûr que c’était lui. Des parties de son visage ont été arrachées, mais ses traits sont restés intacts depuis l’incident. Pourtant, quelque chose était différent : Il n’était pas le même homme. » raconte Ghassan Halwani dans Erased, Ascent of the Invisible (2018), qui revient donc sur les disparus, recréant les preuves qu’on a escamotées, grattant les murs, redessinant des visages. Son premier film court, Jibraltar (2005), était un film d’animation et il est connu pour ses collaborations, notamment avec Joreige et Hadjithomas dans The Lebanese rocket society. Un des films les plus forts et créatifs de ces dernières années.
Une force documentaire toujours renouvelée
Le cinéma documentaire libanais s’est déjà pas mal penché sur son histoire, qu’il s’agisse de Laïla Hotait ou plus encore Hady Zaccak.
Enseignant à l’IESAV, Hady Zaccak a également consacré un livre à l’histoire du cinéma libanais (Le cinéma libanais : itinéraire d’un cinéma vers l’inconnu, 1997) ainsi que plusieurs documentaires Cinéma de guerre au Liban (2003), Le Liban à travers le cinéma (2003), avant d’aborder d’autres thèmes via le documentaire : Refugees for life (2006), Kamal Joumblatt, témoin et martyr (2015) Marcedes (2011) ou 104 wrinkles (2017) sur sa grand-mère Henriette, 104 ans et qui a vécu une bonne partie de sa vie au Brésil.
Il n’y a rien de mieux qu’un film de montage bien ficelé pour donner le goût de découvrir une cinématographie. Sous les mains d’orfèvre de Zaccak, tout extrait du Liban au cinéma devient de l’or, même les films d’un Mohamed Selmane si peu réputé. Un film tragique s’y fait comique, comme cet extrait ubuesque d’Hors la vie virant au pathétique. Le film s’attarde pas mal, et c’est tant mieux, sur le cinéma d’avant-guerre. C’est la grande qualité de ce travail court mais dense (à l’image de Il était une fois Beyrouth) de donner envie de dénicher ces perles et d’en faire sa propre réévaluation. La pluvalue d’un érudit comme Zaccak, c’est d’apporter un regard pointu mais aussi affectueux, de ceux qui ne se construisent que dans un rapport intime au cinéma tout au long d’une vie. Reste le regard de l’artiste qui ici se trouve dans la narration, le ton décalé mais qui dit pourtant quelque chose de l’état du cinéma libanais et de sa précarité systémique. « Car peu importe les recettes si l’œuvre et sublime » ! Le premier fait d’armes d’un grand amoureux du cinéma.
Il se fait plus sérieux et didactique pour le suivant, car le sujet l’impose : Cinéma de guerre au Liban. Il consacre d’abord un long passage au film prophétique de Bagdadi, interviewe les ténors du genre (Chamoun), mais relate aussi des faits moins glorieux, des affrontements politiques, des négociations et des compromissions comme quand Schloendorff parvient à obtenir un cessez-le feu pour tourner certains passages du Faussaire, en en retrouvant les témoins qui nous donnent à comprendre les conditions de création de ce cinéma de la période. Comme dans le cas du Liban malgré tout (1983) d’André Gédéon, qui ne pouvait jamais tourner plus d’une prise à la fois. Le choix de filmer les comédiens, techniciens et cinéastes le plus souvent au volant de leur voiture est également raccord avec la modernité du cinéma de cette époque. Il en retrouve aussi la logique, comment on passe du réel à la fiction, quelles histoires raconter dans un tel marasme. C’est alors selon les termes d’un d’entre eux l’arrivée du « bon cinéma », qui obligera le cinéma d’action et commercial à adopter définitivement le dialecte libanais comme le rappelle Mohamed Soueid. Et la guerre qui oblige les cinéastes à partir tourner le Liban à l’étranger, faute de sites à filmer. Un document précieux qui complètera la vison des films de cette période douloureuse.
Dès 1000 et 1000 nuits (1999), Hady Zaccak se plait à mélanger les images d’archives à celles reconstituées, tout particulièrement ici, dans le genre comédie orientale. Il fait d’Aladdin un palestinien et de la bataille pour sa lampe une métaphore de la situation politique de la région, prise entre « nation arabe » et Israël, intégrant jusqu’à la manne pétrolière d’Ali Baba. Le génie est lui passé à l’ennemi. Bref, une histoire presque sans fin et dont on rejoue éternellement les mêmes intrigues dans un même récit-cadre. Un peu naïf mais sympathique. Il intègrera à nouveau la fiction pour reconstituer l’assassinat de Kamal Joumblatt, cette fois de façon beaucoup plus mesurée. Le film a été très apprécié dans le monde entier. Marcedes a encore le but de réécrire l’histoire du Liban, cette fois à travers ses rapports avec la célèbre voiture, jusque dans ses anecdotes les plus sombres et ce grâce à un très beau travail d’archives. Il est vrai qu’on la voit un peu partout et elle écrase sans peine la BMW, qui devient alors la voiture du peuple et des miliciens du Hezbollah ou d’Amal (Hors la vie). Ici il s’agit seulement, exclusivement, de la Mercedes Ponton (modèle 180). La Mercedes est bien un acteur de la vie libanaise et du cinéma et Zaccak la célèbre aussi à grands renforts d’animations du meilleur goût.
Son approche documentaire s’affinant de film en film et dans ce cas présent, évoluant au fil du projet dès lors qu’il filme sa grand-mère centenaire, mais qu’elle ne le reconnaît plus et que le parcours de vie devient peut-être à ce stade moins important que le présent. 104 wrinkles (Ya omri) ne nous épargne rien au cours de prises de vue éffectuées dans son intimité durant trois ans – mais Hady Zaccak la filme depuis 1992, ce qui permet de nombreux flashes-back et une structure que le réalisateur définit comme « puzzling », et c’est bien ce qui en fait un beau film, « un acte de vie » selon la définition de l’auteur (entretien avec Joseph Korkmaz) sur le très grand âge et qui prouve qu’on perd plus tôt ses facultés mentales que son caractère ! Un de ses meilleurs films. En 2018, Zaccak consacre un court documentaire à Jalal Khoury qui s’est éteint l’année précédente et reste une personnalité phare du théâtre libanais et dont il fut l’élève. Il y a d’autres films à découvrir dans sa filmographie, plus d’une vingtaine de titres qui gagneraient à être mieux mis en lumière.
De son côté, l’ancien communiste Maher Abi Samra a quitté la militance politique pour le cinéma documentaire de création et a d’abord réalisé Chronicle of returning (1994), Aging on sea waves (1995), Femmes du Hezbollah (2000), diffusé sur Arte et sorti en DVD qui jetait pour la première fois un regard non manichéen sur ce mouvement et sur l’implication des femmes dans la lutte. En 2007, il réalise le court essai My friend (2003) et en 2004, le 52 mn Rond-point de Chatila, Ulysse du documentaire au Cinemed de Montpellier. Il tourne enfin sur la condition féminine, Juste une odeur (2007), un essai expérimental en noir et blanc autour des photographes de guerre, primé à Leipzig. Il revient sur son passé en 2010 pour Nous étions communistes (2010) et réalise un film remarqué sur les conditions des travailleurs immigrés dans Chacun sa bonne (2015).
Du côté des artistes visuels pluridisciplinaires dont certains essais peuvent parfois être assimilés au documentaire, Mahmoud Khaled a tourné notamment A memorial to failure (2013), où il inverse dans un premier temps les rôles entre professeur (le théoriecien autonome italien Franco « Bifo » Berardi et peintre abstrait, qui a depuis longtemps affirmé que la solution aux difficultés économiques n’est pas économique et qui a créé le concept de « cognitariat » pour tous ceux dont le capital est savoir) et l’élève, lui-même, étant à ce moment là dans un programme pour artistes indépendants internationaux diplomés ayant lieu à Beyrouth, en préférant se faire interviewer plutôt que de montrer son travail et demandant à Berardi quelles étaient les conditions qui gênaient sa créativité. Au long de la réponse, une parole sur la peur de l’échec, la révolution les changements sociaux, l’activisme et l’art. En contrepoint, un portrait intérieur du penseur par un voyage aérien en deux temps depuis les funiculaires respectifs des villes de Rio de Janeiro et de Jounieh. Un dispositif qui permet de prendre de la hauteur, donc du recul et transmet une forme d’objectivité, mais allié à un sentiment de surveillance et qui permet en outre de confronter la recherche de l’artiste au monde extérieur.
À l’opposé, At five in the afternoon (2012, rétrécit le champ et confine le spectateur en présence d’un autre lui-même assis dans une salle vide à regarder une vidéo de corrida. Auteur de plusieurs installations, Khaled a notamment tourné une vidéo littéralement incrustée dans le corps d’une sculpture massive (Proposition for a romantic sculpture, 2012) dont la vidéo très triviale est accompagnée de la chanson Ne me quitte pas de Jacques Brel. Camaraderie (2009) est enfin un montage de found footages de You tube montrant des culturistes égyptiens et proposant une réflexion sur la place du corps masculin.
Né à Beyrouth en 1980, Nadim Mishlawi commence la musique dès l’âge de 10 ans, puis est diplomé des Beaux-arts, puis du Cinéma en 2005. L’année précedente, il présente sa première installation sonore et crée un studio d’enregistrement avec Rana Eid. Il a depuis composé de nombreuses musiques de film pour Soueid, Hachem, The lebanese rocket society, Ghadi ou plus récemment Liban 1982). Il réalise en 2011, Sector zero avec Abbout productions, qui explore le site et la mémoire de Karantina, sur les hauteurs de Beyrouth, qui fut le lieu d’un terrible massacre commis par les phalangistes le 18 janvier 1976 et qui coûta la vie à 1000 à 1500 personnes. Le parti pris de ce voyage sensoriel ? Traiter l’horreur sans jamais la montrer, mais en figurant ce qui pourrait bien être une représentationde l’inconscient collectif malade des libanais. Partir des lieux et de leur mémoire pour mieux lutter contre le déni. Le montage image et la création sonore sont ici d’une grande force créatrice.
Il faut noter l’importante place des femmes dans la dernière génération de documentaristes.
Laïla Hotait a tourné en 2005 avec sa sœur Nadia, Beirut coming back to you is not painful où elles donnent la parole à trois cinéastes exilés parmi les plus importants : Ziad Doueri, Ghassan Salhab et Nigol Bezjian. Une bonne entrée en matière pour les néophytes. Après The south is back (2008), un 52 minutes sur l’invasion du sud Liban, elle tourne un court de fiction sur cette même période Absent spaces (2009), puis ce qui restera son grand film, le documentaire de création Crayons of Askahan, où l’évocation de la détention de plus de quinze ans de prisonniers palestiniens condamnés à perpétuité en 1975, qui parviennent à survivre et à s’évader par le dessin et par leur imagination. La cinéaste recrée en des scènes oniriques, souvenirs et sensations. Elle met aussi en scène la réalité et les rituels de la détention, où certaines maltraitances sont visiblement reconstituées, filmées par plusieurs caméras. Le résultat comme le montage sont époustouflants (scène des parloirs au découpage très précis et à la bande son toute aussi travaillée). Un film à voir.
Elle coréalise en suite avec Rania Tawfik, le court documentaire From a distance (2014), où des trentenaires exilées se remémorent cette fois des souvenirs et des sensations de leur enfance pour un court très poétique aux images superbes et à la narration originale. Body water, probablement réalisé en Amérique du Nord (elle vit entre Beyrouth et le Mexique), rappelle par son travail sur le corps, Mon corps vivant, mon corps mort de Salhab dans une démarche similaire. Elle a participé à de nombreuses installations comme le montre sa vidéo en triple écran, The connivence of the watching birds, qui est une toute autre manière de voir Askahan.
Comédienne dans des satires politiques à la télévision libanaise, Zeina Daccache est aussi dramathérapeute et concentre son activité sur les prisonniers ou des personnes en marge de la société libanaise à qui elle permet de s’exprimer.
En 2009, c’est la première expérience, unique en son genre au Liban, menée à la prison de Roumieh où elle encadre 45 détenus, pour la plupart condamnés à de lourdes peines (de 15 ans à la peine de mort), pour meurtres, viols ou trafic de drogue. 12 angry lebanese (2009) est une variation sur la pièce 12 hommes en colère où ces hommes vont à leur tour devenir jurés ou juge pour statuer sur le cas d’un adolescent ayant assassiné son père. La pièce est l’occasion d’introduire des éléments documentaires sur la propre expérience des prisonniers. Le documentaire enregistre le travail au long cours des détenus, leurs retours sur leur vie, sur leurs actes, une réflexion sur leur avenir et leur manière d’appréhender cette expérience. Le film est simple mais son montage complexe (avec l’incontournable Michèle Tyan !), coupant à même l’expérience collective parmi les prises de vue de sa chef opératrice Jocelyne Abi Gebrayel. Il met en valeur un rapport basé sur la confiance mutuelle, de personne à personne, de metteur en scène à acteur (elle est rebaptisée Abu Ali par les prisonniers, un genre de dur) et se focalise sur la responsabilité et le travail à accomplir pour parvenir à cette forme de libération, début d’une guérison. La fin en compagnie des pouvoirs publics est un peu utopique mais le spectacle écrit en commun est parvenu à toucher les gens personellement jusqu’au plus haut niveau de l’état. C’est au moins le début d’une collaboration avec cette prison-ci.
Dans Le journal de Shéhérazade (2013), ce sont les détenus de prison de femmes de Baabda à Beyrouth qui présentent leur spectacle après 10 mois de travail et témoignent plus généralement de la difficulté d’être une femme au Liban et dans un monde arabe patriarcal dont la mentalité pousse bien souvent ces femmes au crime. En 2016, elle travaille avec les travailleurs immigrés, une population, estimée à 200 000 personnes, travaillant sous le régime du Kafala, un genre de sponsoring qui les met à la merci de leurs employeurs et rend ces « domestiques ou « sri lankais » victimes de racisme et de mauvais traitements. Zeina Daccache met en scène la pièce Shebaik lebaik (2016) à l’issue de onze mois de travail. Le titre, le même que celui du film, se réfère à une circulaire datant de 2014 qui interdit aux domestiques immigrés d’avoir des relations domestiques sur le territoire libanais. Elle tourne actuellement dans les festivals du monde entier avec The blue inmates (2021), où les détenus de Roumieh s’interrogent sur la situation de détenus laissés pour compte, « fous et possédés » et souvent incarcérés à vie en raison de leur état mental.
Parmi les collaboratrices de Daccache, la célèbre ingénieure du son Rana Eid, diplomée de l’IESAV, également souvent responsable du montage sonore et du mixage des films (plus particulièrement de Salhab, Zaatari, Hadjithomas et Joreige). Rana Eid est elle aussi passée à la réalisation en compagnie de Rania Stephan pour Panoptic (2017), film personnel où elle adresse une lettre à son père décédé, un travail de mémoire qui est aussi un geste de réconciliation avec la période chaotique de la guerre civile. Pour ce faire, elle sonde les monuments et met à nu certains secrets. Produit par Abbout productions, ce film a notamment été présenté à Locarno. En 2021, en parallèle de la présentation de Memory box, Rana Eid a présenté au festival de Berlin une composition sonore sur Beyrouth, « une ville qui n’en pouvait tellement plus qu’elle a fini par exploser ».
Rania Stephan est elle-même devenue réalisatrice après avoir étudié à Melbourne, par exemple pour Train-trains (où est la voie ?), à la fois documentaire de création sur le trajet ferroviaire Beyrouth-Damas, autour d’une ligne tombée en désuétude et qui permet de redécouvrir le Liban et un film de montage incorporant des images de trains de nombreux autres films. Elle revendique d’ailleurs le fait d’être contaminée par les images des autres, à l’image de son pays composé d’une multitude de cultures et d’histoires. En 2005, elle revient au Liban et entreprend la réalisation de Terrains vagues (2005), un documentaire d’investigation composé de rencontres et qui tente de trouver des réponses à une situation politique complexe. Puis avec Liban/Guerre (2006), elle interroge comment les citoyens vivent le conflit de 2006. Dommage (2009) est un bref film sur la violence et autour de la Palestine. Le festival de Douarnenez lui a consacré une rétrospective en 2008.
Née à Beyrouth en 1983, Myriam El Hajj a étudié le cinéma au Liban puis à Paris. Elle s’est ensuite tournée vers le théâtre durant sept ans. On lui doit deux courts dont Je n’ai pas vu la guerre à Beyrouth (2009), sélectionné dans de nombreux festivals et de plusieurs vidéos. Trêve (2015) est son premier documentaire, produit par Abbout productions. Son oncle Riad est un vétéran des milices chrétiennes. Comme les autres, il garde la nostalgie de la guerre et des armes à feu à travers sa petite échoppe, car « La guerre, c’est la vie ! ». Elle confronte alors leurs idéaux de jeunesse et un Liban qui n’en finit plus de couler. Lors de sa présentation à Beyrouth, les anciens ont fait salle comble et la polémique et les bagarres ont éclaté, révélant toute la nécessité de la prise de parole alors que les tensions montent du fait du contexte politique, économique et social. Elle prépare son premier long de fiction Regarde la ville qui brûle où la corruption politique est au centre du sujet, à travers le personnage d’un père ministre emprisonné pour avoir commis un attentat. Elle prépare également un documentaire avec l’égyptien Mohamed Siam, Amnésie.
Tomorrow we will see (2013) est un documentaire sur l’état de la création artistique au Liban. Il a été réalisé par la libano-japonaise Soraya Umewaka, ancienne étudiante en politique ayant réalisé auparavant des films au Brésil ou en Équateur. Elle y rencontre une dizaine d’artistes dans autant de disciplines différentes comme l’architecte Bernard Khoury. Un portrait plutôt sage et très partiel, mais qui donne un petit aperçu de la très intense création libanaise de l’époque.
Haut et fort !
Enfin, pour clôre ce premier voyage en terre du Cèdre, abordons le sujet qui fâche encore trop une société qui n’a pas vraiment eu l’occasion de déconstruire ses stéréotypes et schémas d’exclusion : l’homosexualité et le genre. Si l’homosexualité n’est toujours pas dépénalisée (article 534, élaboré sous le mandat français), elle n’est pas tellement acceptée non plus dans l’opinion publique puisque d’après une étude d’il ya quelques années, 6 % de la population libanaise seulement y est favorable. Récemment, juges et cour d’appel ont pu contourner la loi pour acquitter quelques personnes jugées pour homosexualité, ainsi qu’une personne trans. La soit-disant tradition de tolérance du Liban est donc mise à mal et nettement moins grande que par exemple, dans les pays du Maghreb, un peu à l’image du retour de l’intégrisme en Égypte. L’assocation Helem de défense des droits des LGBT+, la première du monde arabe, s’est fondée à Montréal en 2004 mais opère surtout à Beyrouth, mais n’a jamais été reconnue par l’état libanais. Rien d’étonnant à ce que l’ambassadeur du Liban à Paris, Rami Adwan, vienne d’ailleurs de prendre à partie des militants LGBT+ qui ont recouvert d’affiches arc en ciel la porte de l’ambassade à l’occasion de la dernière marche des fiertés !
Pour autant, le tourisme, la vie urbaine et culturelle ont développé des nuits hautement agitées dans la capitale… et des lieux spécialisés. «La géographie de l’homosexualité à Beyrouth, notamment celle des espaces festifs et des lieux de drague, est donc fragmentée et éphémère. Si les lieux de l’homo-sociabilité ont tendance à se multiplier et sont tolérés dans la plupart des cas, ils demeurent contenus, peu visibles, parfois menacés, et largement dominés par une fréquentation masculine. Eux-mêmes divisés en fonction de l’appartenance sociale des personnes qui les fréquentent, les espaces de loisirs et de rencontre des homosexuels à Beyrouth jouent un rôle clé dans la formation d’une identité gay libanaise. » (Gay paradise- kind of. Les espaces de l’homosexualité masculine à Beyrouth, Marie Bonte)
Premier coup de semonce, Help (2009), film réalisé par Marc Abi-Rached, qui sera finalement interdit dans son pays, ayant pourtant obtenu la licence d’exploitation. Il s’agit justement ici de prostituées et de personnes trans qui vivent leur sexualité dans des appartements chics. L’autre ligne narrative est attachée à un gamin de la rue, un ado qui survit sans sa famille et vit dans une carcase de voiture. Il va être fasciné par ce monde de fête, cette légèreté. Une ambiance trouble de néo-noir teinte l’ensemble, Almodovar n’est alors pas loin mais avec une réalité sociale plus dure, des rapports beaucoup plus vite exacerbés. Le féminicide y est par exemple normalisé à travers le comportement de l’ancien amant-client maffieux, Jacques. Prostitution (avec la fille d’un député qui se dénude à peine, Joanna Andraos, par ailleurs formidable photographe et comédienne notamment pour les courts-métrages muets et tournés en super 8 de Sandra Fatté, primés au festival de Nice organisé par Regard indépendant et dans Faim de communication de Caroline Tabet avec qui elle collabore étroitement), mafia et zone à tous les étages, bienvenue dans l’underground beyrouthin ! Il y a chez ces apaches toutes sortes d’illégaux et on peut lire la critique sociale en filigrane. Elie Yazbek y voit lui le contraire de Caramel, des marginaux qui luttent pour développer leur humanité. La très belle fin, morale, va d’ailleurs dans ce sens.
Plusieurs crans au-dessus mais sans scènes de sexe explicites entre hommes, Crie le haut et fort (2011) de Samer Daboul, proclamé comme le premier film gay du Liban, raconte avec de petits moyens mais beaucoup d’amour, l’histoire de Jason (Rudy Moarbes), un jeune qui se cherche, traumatisé à vie par un attentat qui a emporté son père. En parallèle, un de ses amis, Rami (Ali Rhayem), fait son coming out un soir face à ses deux amis et leur apprend qu’il a une relation passionnelle avec Ziad (Jean Kobrosly), un garde du corps. En vrais amis, ils prennent la chose avec beaucoup de légèreté, même le plus sceptique, Jason. Menacés de mort par leurs familles respectives, Zias et Rami doivent fuir. C’est une fille rencontrée sur internet, Nathalie (Eliane Kherdy), qui leur proposera un refuge dans une maison à la campagne dans les vignes (la Bekaa?) où la petite communauté pourra refaire le monde dans la joie et la bonne humeur. Le film a là encore eu maille à partir avec la censure, mais a surtout du se tourner en partie sous la protection de l’armée, essuyer les pressions et agressions. Cette adrénaline ne leur a pas facilité les choses mais aura achevé de souder l’équipe autour du projet de Samer Daboul dont c’était le second film de fiction après le thriller Finding interest, tourné en 1995 aux Etats-Unis avec Trevor Sands.
Crie le haut et fort déstabilise un peu en mélangeant les genres, passant, comme dans la vie, de la comédie au mélodrame ou au film social, puis au drame en poussant les potards aussi loin que possible. La mise en scène n’est sans doute pas tout à fait à la hauteur, mais l’ambiance emporte sans aucun problème le morceau, avec des scènes oniriques, notamment celle blasphématoire où Nathalie épouse ses trois amis et que des zaffés, des danseurs traditionnels de blanc vêtus, arrivent pour la célébration mais n’arivent pas à comprendre qui est l’heureux élu. Tant pis pour eux puisqu’à la fin, on verra quand même la famille au complet et leurs filles grandies dans cette bulle de tolérance, rendue possible par le sacrifice d’un des leurs et l’intervention de l’état. Un message clair. Le personnage féminin est pour beaucoup dans la chaleur qui émane du film, et même si tous les coprotagonistes ont été voulus attachants. Il y a vraiment ici l’idée de faire un film populaire qui puisse toucher les familles et conscientiser sur les droits des LGBT+. On sent aussi les codes du cinéma queer, avec pléthore de symboles phalliques à gogo et assumés, une esthétique globalement à fleur de peau et l’émotion, torrentielle.
Le bilan du cinéma queer est donc bien maigre et il existe sans doute dans l’underground des films plus directs, voire trashes comme partout ailleurs sur la planète. Mais ici, les précautions pour aborder le sujet s’imposent, ce n’est pas de la fiction ! La dernière polémique en date sur Netflix vient de le prouver. Pemier film arabe produit pour la plate-forme, la comédie, de sous sous genre de repas du producteur Wissam Smayra (Capharnaüm…) On se connaît ou pas (2022) fait scandale en Égypte (coproductrice) pour la seule présence d’un personnage à l’homosexualité évoquée, pour une promotion du mensonge à travers l’adultère, la présence d’alccol, les conversations sexuelles, bien plus que pour une scène légèrement dévêtue. Mais puisque le film est libanais, l’Égypte ne peut pas faire retirer le film… Les acteurs sont également montés au créneau pour épingler une foi de peu de foi. Le pitch est bien dans l’air du temps -il est d’ailleurs le remake d’un film italien, déjà refait en France par Fred Cavayé dans Le jeu. Des amis, un repas et une « idée de génie » : un jeu où chacun s’engage à faire lire aux autres tous les messages reçus sur toutes ses applis au cours du repas. Le genre de truc qui cartonne sur la plate-forme ! Film de dialogues et d’acteurs (on y retrouve Nadine Labaki, mais y a-t-il encore des films où elle n’apparaît pas ?), où les répliques fusent entre les situations supposément scabreuses, n’a pas grand intérêt cinématographique, mais un énorme potentiel sociologique.
« Le Liban ce n’est pas seulement les gens qui sont sur place et qui parlent arabe, c’est aussi dix millions de Libanais au Brésil, 3 millions en France. C’est l’éclatement d’une population dans le monde entier dû à un conflit. C’est un pays multiconfessionnel, son identité est un mélange de toutes ses cultures et on ne peut pas tuer cette tolérance et cette richesse avec des armes. » déclarait Zeid Hamdan à Benjamin MiNiMuM sur Aux sons, quelques temps après avoir échappé à la mort, sa maison ravagée dans l’explosion du port. Le cinéma est particulièrement le reflet de cet état de fait avec de nombreux créateurs un pied sur chaque continent, mais aussi pas mal de jeunes qui voyagent à travers les programmes d’échanges, les laboratoires et autres résidences. Dans ces conditions, il est impossible d’avoir un panorama exhaustif de ce cinéma qu’on avait cru moribond.
De nombreux noms et œuvres manquent ici à l’appel, parce qu’il n’a pas été possible de voir les films, des images ou même d’accéder àde simples renseignements sur leurs auteurs. Mais aussi parce que la thématique a été circonscrite aux libanais sans intégrer la création dans les camps palestiniens ou par les réfugiés syriens (collectif Biddayat), déjà traités dans les Mondociné sur leurs pays respectifs. Faute de temps aussi, parce que ce si petit pays s’avère l’un des plus créativement dense de la planète. On peut regretter que le public libanais ne soit pas le premier à en profiter et que ces talents, cette qualité esthétique et intellectuelle, ne puisse pas jouer son rôle dans tous les débats de société. Il manque sans doute des médiateurs et des moyens pour porter le cinéma libanais à même les foyers (et voir comment projeter sans électricité et sans fuel ?). Cette absence de reconnaissance de son public est peut-être le prix à payer pour un cinéma trop chevillé à la réalité. Les thèmes devraient évoluer avec le temps vers de nouveaux horizons, comme il en a été le cas chez les cinéastes palestiniens de la dernière génération. Il manque encore d’autres sources de financement et d’autres moyens que la voie classique pour trouver des recettes que celle du ticket en salle ou du dvd. Une économie du cinéma à réinventer sans l’état, ainsi qu’il a toujours prévalu, et qui pourait alors servir de modèle à de nombreux pays qui ont jusqu’ici bâti leur cinématographie sur la subvention, dans un monde où la place de la culture est de plus en plus laminée par l’économie capitaliste et l’horizon trompeur du numérique.
« Le Liban, s’il arrive à exister, c’est qu’il saura tirer bénéfice de ce qui l’a défait. » disait Ghassan Salhab. Au moment où tous les indicateurs économiques sont au rouge (Tripoli a été classée la seconde ville la plus pauvre du monde) et où la population libanaise s’apprête à rejoindre les réfugiés du monde entier dans la grande transhumance migratoire, il apparaît évident que le problème de cette société libanaise, c’est d’abord l’état libanais et sa classe politique bientôt moribonde. Rien ne sera moins facile que d’hériter des conséquences de leurs actes, que de composer avec l’instabilité de la région, la dictature syrienne ou l’agressivité israélienne, que de maîtriser ces partis libanais d’un autre âge, mais aussi de calmer les appétits occidentaux ou russes qui entendent toujours profiter des richesses et même du rôle ambigu de la France qui entend assurer une domination culturelle en finançant un maximum de projets. Pour aider les cinéastes libanais, on peut déjà s’intéresser à leur travail. Aligner les fragments, les réagencer à son goût. Les programmer, les diffuser. Attendre et soutenir leurs projets futurs, car même si l’humanité venait à tout ruiner, il resterait toujours un ou une cinéaste, et vu leur capacité de résistance, peut-être bien une libanaise, pour en témoigner.
Pour la première fois, c’est d’ailleurs grâce aux acteurs et professionnels du cinéma libanais que cet atelier et ce tour d’horizon ont pu être menés. Sans eux, il y aurait eu moins que des fragments…
Chaleureux remerciements à Antoine Waked et Abbout productions, Christophe Karabache, Nadim Tabet et Zeina Daccache qui m’ont permis de visionner leurs films afin de présenter leur travail dans les meilleures conditions. La palme est attribuée à Johnny Karlitch qui s’est battu contre les coupures de téléphone et d’internet durant plusieurs semaines jusqu’à ce que ses films arrivent ici !
Remerciements tous particuliers au soutien sans failles de Raja Tawill à Montpellier, enthousiaste, érudit et mélomane, et dont on retrouve les chroniques dans l’émission Oblik sur Divergence.fm et à Amélie Arnaudet qui a pu déterrer son mémoire pour m’éclairer.
Bibliographie :
–Mélancolie libanaise, le cinéma après la guerre civile, indispensable ouvrage de Dima El-Horr (L’harmattan) !
–Regards sur le cinéma libanais, Elie Yazbek (L’Harmattan)
–Le théâtre chi’ite au Liban (Sabrina Mervin), Ziyad Rahbani, une figure inédite de l’homme de théâtre au Liban (Arnaud Chabrol), Mapping out the sound memory of Beirut : a survey of the music (Thomas Burkhalter), Itinéraire des cinéastes liabanis de l’après-guerre : le parcours d’une reconstruction (Laila Hotait), Des représentations de l’histoire et de la mémoire dans l’art contemporain au Liban (Monique Bellan), L’art, la guerre et la mémoire au Liban (Victoria Chenivesse), tous textes dans Itinéraires esthétiques et scènes culturelles au Proche-Orient, sous la direction de Nicolas Puig et Franck Mermier, IFPO.
–Présence du cinéma libanais, Joseph Korkmaz (L’Harmattan).
–Cinémas de la mélancolie, Raphaël Millet (L’Harmattan)
–Dictionnaire des cinéastes arabes du Moyen-Orient, Roy Armes (L’Harmattan)
–Les écrans du croissant fertile : Irak, Liban, Palestine, Syrie, Yves Thoraval (Séguier)
–Au Moyen-Orient, tous les cinéastes sont des Palestiniens, Jacques Mandelbaum, in Au Sud du cinéma (Cahiers du Cinéma, Arte ed.)
–Mémoires libanaises, fiction et réalité, (Sources), Amélie Arnaudet, octobre 2004.
–L’essor des réalisatrices libanaises, Institut d’Etudes Politiques Lyon 2, 2008. Aline Fontaine
–Et il y a des moments où je suis presque heureux de vivre, hommage à Ghassan Salhab, Raphaël Millet, FEMA de La Rochelle, 2010.
–Entretien avec Ghassan Salhab, Dérives autour du cinéma,www.derives.tv, Laura Ghaninejad et David Yon, juillet 2011.
–Heiny Srour : « Leïla et les loups survole huit décennies d’engagement des femmes du monde arabe », entretien avec Heiny Srour pour la restauration de Leila et les loups par le CNC
–Three questions to Lynn Kodeih, entretien avec Barbara Coffy, Libalel, juin 2011.
–Christophe Karabache, la possibilité d’une individualité, Johnny Karlitch, revue Noun, octobre 2008.
–Christophe Karabache, la pureté du regard, Johnny Karlitch, revue Noun, mai 2009.
-L’ensemble des articles de Michel Amarger consacrés à Christophe Karabache sur Africiné
–Roger Assaf, le théâtre contre l’injustice, Jad Semaan, L’Orient littéraire, juillet 2009.
–C’est à partir de l’agitation imaginative que se crée un film, entretien avec Elie Khalifé, Colette Khalaf, L’Orient-Le jour, 14 juillet 2021.
–Hady Zaccak, l’historien de la mémoire, Gisèle Kayata Eid, Agenda culturel
–More than your daily vitamin, entretien avec Elie F Habib, Jasmina Najjar, Step feed, décembre 2014.
–Une histoire des réalisatrices, Cahiers du cinéma n°751, juillet-août 2019.
–Lebanese movies, Investment development authority of Lebanaon, presidency of the council of ministers, 2015
–Rapport sur la censure au Liban, Nouveaux droits de l’Homme (NDH) Liban, 2003.
–Histoire du Cinéma, Georges Sadoul.
–Le Liban inventif et tolérant de Zeid Hamdan, Benjamin MiNiMuM, Aux sons, novembre 2021
–Gay paradise -Kind of. Les espaces de l’homosexualité masculine à Beyrouth, Marie Bonte, in EchoGéo 25, 2013 : Moyen-orient, espaces et passeurs du changement.
–Paul Virilio, l’accident comme ressource immatérielle, Jean Richer, Les Cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère, 11/2021 Penser l’architecture par la ressource.
–Catalogue du festival Travelling, Rennes Métropole, 11 au 18 févier 2020.
Le cinéma libanais en DVD (éditions françaises) :
Maher Abi-Samra : Femmes du Hezbollah, JBA
Marc Abi Rached : Help, Epicentre
Danielle Arbid : Seule avec la guerre + Aux frontières, Blaq out
Dans les champs de bataille + Un homme perdu, MK2
Peur de rien, Ad Vitam
Beyrouth hotel, les films Pélléas
Passion simple, Pyramide vidéo
Maroun Bagdadi : L’homme voilé, Les films du collectionneur
Valtche Boulgourdjian : Tramontane, Ad Vitam
Randa Chahal Sabbag : Le cerf-volant, France télévisions
Wissam Charaf : Courts-métrages, jhr
Tombé du ciel, Epicentre
Jihane Chouaib : Pays perdu, pays rêvé, 5 films (dont Go home) , La Huit
Samer Daboul : Crie-le haut et fort, Optimale
Ely Dagher : Face à la mer, jhr
Ziad Doueiri : L’attentat, Tamasa
Khalil Joreige et Joanna Hadjithomas : Memory box, Blaq out
The Lebanese rocket society, Urban distribution
A perfect day + Cendres, Tamasa
Je veux voir, Shellac
Christophe Karabache : Zone frontalière + Cinexpérimentaux, Re-Voir
Mazen Khaled : Martyr, Optimale
Nadine Labaki : Caramel, Bac film
Et maintenant, on va où ?, Pathé
Capharnaüm, Gaumont
Ghassan Salhab : La vallée + La montagne, Survivance
Nadim Tabet : Le Liban en automne + Cinexperimentaux #11 Voyage dans le cinéma expérimental à Beyrouth (Mahmoud Hojeij, Ghassan Salhab, Nesrine Khodr, Lamia Joreige), Re-voir
Hany Tamba : Une chanson dans la tête + After shave, Mabrouk again, Les barbiers de cette ville, France télévisions
De nombreux cinéastes cités dans cet article disposent par ailleurs d’une chaîne Viméo (et parfois d’un site personnel à leur nom). Les films commentés ci-dessus sont pour certains accessibles en ligne gratuitement.
Certains films, notamment ceux de Maroun Bagdadi, de Philippe Aractingi et d’autres sont visibles sur Netflix.
Certains, trop peu, sont visibles en VOD sur Universciné (Terra incognita de Ghassan Salhab) ou chez Tënk (Trêve de Myriam el Hajj).