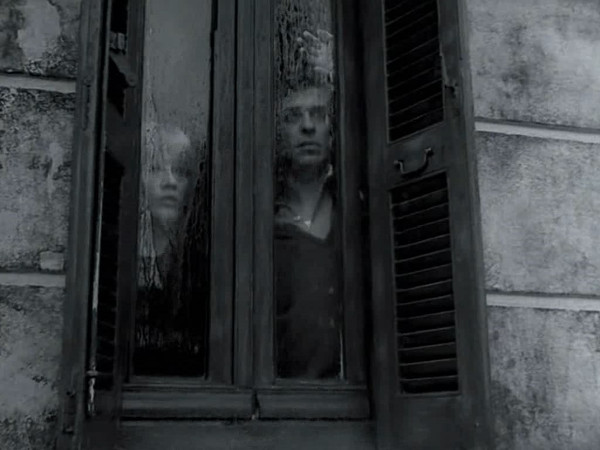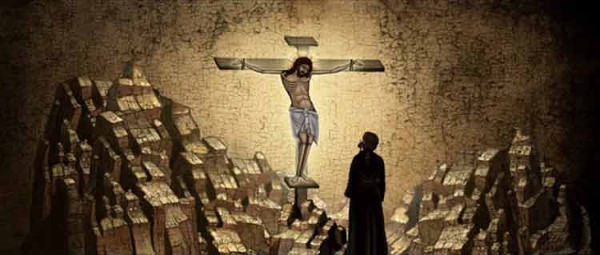INTERVENANT :
Lieu
L'Ancri'er, Florac Voir sur la carteUn rapide sondage et la constatation est redoutable : le cinéma grec est tout simplement méconnu, mal diffusé ou absent des radars et les grecs, si souvent prompts à acclamer leurs célébrités dans les autres arts, semblent on ne peut plus critiques et même trop, vis à vis de leurs propres réalisateurs. Bien moins représentée à l’international que le voisin turc, cette cinématographie peine donc à exister et si ce n’était chez nous, une récente édition de Tamasa sur Cacoyannis et l’intégrale de l’internationaliste Papatakis, Angelopoulos et Lanthimos occuperaient seuls la case face à Panos Koutras et à quelques étoiles filantes.
Il serait grand temps de briser la glace et de réparer cette injustice en exhumant quelques uns de ses plus beaux classiques, ses genres bien spécifiques et en examinant comment ce cinéma grec, bien qu’attaqué de toutes parts, résiste à tout, même au pire. Cette infamie est politique. Déjà lourdement handicapé par le veto de l’église orthodoxe qui ne porte que trop bien son nom, le mépris ou la haine des nationalistes de différents régimes, jusqu’à la méfiance même de marxistes plus que critiques, le cinéma grec est avant tout un cinéma de colonisés ( Papatakis écrivait même « société esclave »), son parc de salles étant surexploité par les américains comme un de leurs innombrables dominions, quand on ne connaît déjà que trop bien leur politique étrangère et leurs coups de main. Bien plus que la grande Turquie voisine flattée à l’excès par l’OTAN, la Grèce est un terrain de jeu et le laboratoire de la CIA, le berceau de la civilisation occidentale étant vendu depuis belle lurette aux pays étrangers quand sa population survit tant bien que mal et tente malgré tout de sauver ce qui peut l’être encore.
Ses différentes périodes en témoignent : comme bien des territoires ayant connu la férule des dictatures mises en place puis portées à bout de bras par les occidentaux (voir le Mondociné Thaïlande), les grandes étapes de son cinéma sont calées sur ses épicentres politiques. Après des débuts tardifs, épars et franchement timides, c’est la fin de la guerre civile qui marque le début d’un premier âge d’or qui n’aura pas le temps d’aborder le virage mondial des années 60, fauché en plein vol par la dictature des colonels dont le grand fait glorieux sera la mise en place de la télévision avec les mêmes résultats que l’on connaît dans tous nos pays : une baisse presque totale de la fréquentation des salles obscures. La fin de la dictature marque l’avènement du Nouveau cinéma grec, courant majeur de la cinématographie mondiale que Théo Angelopoulos est bien loin de résumer à lui seul. Avec Papandreou, la gauche a porté à la Culture la grande actrice Melina Mercouri dont l’enthousiasme en matière de production ne sera pas toujours proportionnel aux résultats et ne verra surtout aucune amélioration dans la désertion totale du public national.
La Grèce fut donc un laboratoire pour les nationalismes, les néo-héllénistes et tous les poètes du 19ème siècle, puis pour le plan Marshall qui imposait pour toujours un modèle quasi unique au parc de salles grec, pour le tourisme de masse qui va toujours dans le sens du vent, pour les anti-marxistes qui y appliqueront drastiquement les leçons de l’école des Amériques quant à l’exception de l’Espagne franquiste et du Portugal de Salazar, l’Europe portait à incandescence le conflit de génération et la libération sexuelle, pour les ciné-clubs artistiques aussi qui comme en Espagne planteront la graine de la subversion et de la nouveauté, pour l’Europe et la Banque Mondiale qui ont fait de la Grèce contemporaine cette économie en ruines, pour la forteresse Europe qui en fait sa porte de Brandebourg du flux migratoire, mais aussi parfois, pour des zones de liberté plus modestes mais bien réelles, des spécificités comme autant d’îles dans sa géographie éclatée. Un peu caricatural comme tableau mais la situation du cinéma grec est très tôt paradoxale.
Ce labo n’est pas que politique, même si le septième art qui en ressort l’est lui bel et bien. Au delà de ce cinéma populaire bruyant et chantant promu par Finos film, les auteurs grecs sont de puissants créateurs qui synthétisent le plus beau d’une culture millénaire où philosophie, poésie, tragédie, comœdia, musique, danse, architecture, sculpture et autres formes d’art et de pensée viennent exploser le carcans du récit à l’américaine, pour notre plus grand plaisir quoiqu’en prétendent certains jeunes cinéastes grecs dépressifs, aveuglés par le modèle dominant. La Grèce est aussi ouverte aux vents d’autan et à l’air du temps, où se décèle une forte influence italienne, quelques vagues allures françaises, et même psychédéliques puis baroques. Jusqu’au covid, ses cinémas de plein air étaient devenus en été une institution et l’offre est plus diversifiée que ce que l’on pourrait en attendre. Pionnier en matière de système D, le cinéma grec actuel est à chercher en dehors des frontières traditionnelles et sur de nouveaux supports, un terrain vague non défriché et même ensauvagé. Si on peut s’attendre à lire notre avenir politique et social dans le sillage ou les cendres de l’exemple grec, il y a fort à parier que la création mondiale s’épanouisse plutôt dans ces zones là. Alors peut-être, la Grèce aura à nouveau droit de cité.
Wikipédia ayant pour une fois parfaitement bien fait son travail, le panorama y est assez exhaustif, ce qui témoigne bien de la curiosité envers ce cinéma. En voici une vue en coupe, très partielle et subjective, avec quelques éclats et des pistes mystérieuses où peut-être s’aventurer.
La bergère et le satyre
On a pu lire ça et là qu’à l’origine, il y a entre la Grèce et les opérateurs Lumière le premier rendez-vous manqué entre culture grecque et septième art et que ce décalage là ne sera jamais véritablement comblé. Les vestiges sont plutôt manquants et les restes peu impressionnants, mais on s’attachera plus à ceux-ci qu’au cinéma invisible des pionniers. Le plus ancien film encore disponible, Les aventures de Vilar (1926) de Joseph Epp est une adaptation rudimentaire des Keystone comedies, ou mieux comme le remarque Fotos Lambrinos, des films de Max Linder, mais qui vaut pour un final avec quelques velléités surréalistes. Plus fascinants peut-être, des restes de la captation du Prométhée enchaîné mis en scène à Delphes en 1927 par Angelos Sikélianos qui embringuera quelques américains dans son délire néo-classique. Ce cinéma primitif va être le berceau du genre national dit de films en fustanelle, en référence au costume grec du 19ème siècle. Le Maria Pentayotissa (1929) mis en scène par le grand comédien de l’époque Achilleas Madras a une grammaire rudimentaire, une interprétation très amateur au dire des grecs – qui ne plaisantent pas avec cette question, mais aussi un vrai souffle épique, ce qui est le moins qu’on demande au genre ( la comparaison avec le film de 1957 penche d’ailleurs pour la première version). L’amoureux de la bergère réalisé en 1932 par Dimitris Tsakiris (également remaké en couleur en 1956) et premier parlant, enfonce le clou des stéréotypes balkaniques de l’époque mais n’apporte guère plus à son drame paysan. En tout cas, le genre enracine des archétypes solides et autres valeurs indécrottables de la structure familiale et patriarcale. Toujours dans ces comédies pastorales héritées de ce drame satyrique antique qui prenait place dans des cadres champêtres ou sylvestres, on peut lui préférer Astéro (1929), remake local du Ramona d’Edwin Carewe avec Dolores Del Rio pour la beauté de ses images du pélopponès eseul survivant des pionniers, les frères Gaziadis connus pour leurs courts et surtout leurs actualités sur la tragique retraite d’Asie mineure de l’armée grecque. Orestis Laskos, future figure du cinéma commercial, passe à la postérité pour les scènes de nus très pudiques de Dahnis et Chloé (1931) plus que pour une réelle beauté plastique des paysages de sa comédie bucolique, qui garde toutefois un charme naïf enfantin et use d’un vrai découpage. En 1932, le muet Corruption sociale a le mérite de nous y montrer des grévistes et des apaches (et même un plan sur un toxicomane entrain de se shooter!). Il aborde la misère, les violences faites aux femmes, la répression politique mais surtout la corruption morale de sa protagoniste féminine par un environnement déliquescent (le monde difficile des théâtres). Il est aussi écrit et tourné dans le sillage du rapatriement de nombreux grecs d’Asie mineure et veut dénoncer à chaud les conditions de vie difficile dans la capitale. Proche en esprit des films de la république espagnole, il est nettement moins avancé techniquement et plutôt primaire cinématographiquement. Ce premier film à teneur sociale bénéficie peut-être d’une très courte période de stabilité politique mais subit de plein fouet la précarité économique où croupit le cinéma de l’époque. Rien de comparable pourtant avec l’ère Metaxas à partir de 1936 qui porte un coup d’arrêt à l’industrie cinématographique balbutiante, qui pour survivre est condamnée à l’exil et à tourner des coproductions dans les studios égyptiens avec des artistes de music-hall grecs en tournée.
On ne pourra reprocher à Filopimène Finos de ne pas avoir fait franchir un pallier au cinéma national en construisant des studios en banlieue d’Athènes, même si les beaux extérieurs de son Chant du départ (1939) sont aussi tout à fait représentatifs du cinéma des années 30. Par ailleurs, on y chante et de ce côté là, et surtout à Finos films, plus jamais on ne se taira. Après quelques faits d’armes et de résistance, il récidivera et deviendra le plus important producteur grec et grand pourvoyeur de cinéma populaire dans tous les grands genres jusqu’au début des années 70. Il faut louer la technique impeccable, le soin et l’enthousiasme de films n’ayant pour autre ambition que de divertir et de caresser le public grec dans le sens du poil en idéalisant la réalité. Pour qui veut comprendre la société grecque de ces années là, les stéréotypes sont édifiants dans le sens où ils révèlent ce qu’ils taisent. A ce titre, un des plus brillants metteurs en scène de la maison est Alekos Sakellarios dont la comédie Les allemands reviennent en 1949 est tout à fait savoureuse. Dans cette dystopie critique, des grecs à peine libérés et qui ont retrouvé le goût de râler sont déjà tout à s’étriper lorsque les médias annoncent la grande nouvelle : Hitler est toujours vivant et grâce à ses nouvelles armes, il a déclenché une contre offensive générale ! La Grèce ne tarde pas à être envahie, à reprendre ses vieilles habitudes de survie… et le maquis. Grâce à son argument onirique, Sakellarios ose, et il est bien l’un des seuls, évoquer la guerre civile en pleine vague de terreur blanche, alors qu’aucun film ne pourra traiter le sujet avant les années 70. Prix à payer, il y caricature un marxiste pur jus tout à fait délirant qui ne dépareille pas dans cet asile de fous, hommage à Un ami viendra ce soir de Raymond Bernard que découvrent sur grand écran les héros du film. Sakellarios s’imposera tout autant dans la comédie (La tante de Chicago), notamment avec sa starlette des années 50 et 60 Aliki Voyouklaki (Aliki dans la marine, Ma fille est une socialiste), que dans le mélodrame (Marina). D’autres cinéastes tirent leur épingle du jeu à la Finos sur cette même corde comme Nikos Tsiforos (Viens voir le tonton !, La belle d’Athènes), qui fera par la suite bien pire.
Athènes ville amère
En 44, c’est le film Applaudissements qui voit la naissance d’un excellent cinéaste, Yorgos Tzavellas au départ auteur dramatique, première prémisse de la naissance d’un cinéma grec plus adulte et raffiné. Tzavellas s’impose dans le mélodrame par la qualité de la mise en scène, de ses sujets et de ses interprètes, jusqu’au triomphe public de L’ivrogne (1952) qui ne vaut pas la même année le réaliste poétique L’Agnès du port. Autant de titres grâce auxquels le mélodrame devient un genre majeur en Grèce et à la Finos films.
A situation économique et sociale idoine, les conditions de production influencent l’esthétique et le cinéma grec se teinte peu à peu de néo-réalisme avec Pain amer (1951) de Grigoris Gregoriou, où on sent l’influence de De Sica et La terre noire (1952) de Stellios Tatassopoulos sur un mode plus rural mais radicalement opposé aux fustanelles. Bien que fraîchement rentré en Grèce, Gregg Tallas parvient lui à retrouver Rossellini dans sa manière de croquer une bande d’enfants dans une Grèce occupée par les nazis (La bataille des va-nu-pieds, 1954), très très loin de son Femmes préhistoriques tourné aux États-Unis. Enfin en queue de peloton, Alekos Alexandrakis tourne Quartier le rêve (1961) avec les gens du quartier et trouve la poésie, mais reçoit une interdiction totale de la censure.
De son côté et de très loin le meilleur d’entre tous, Nikos Koundouros introduit le public dans les bas-fonds, les quartiers pauvres et cabarets mal famés au grand dam de la censure alors toute puissante. C’est d’abord La ville magique (1954) où la solidarité des réfugiés d’Asie mineure au Pirée avec un jeune camionneur s’oppose au trafic des truands de la Magic city sous évidente influence américaine. Entre les détails de cette ville magique touffue, l’étude de caractères, le cadre des chantiers navals et celui du quartier, il est normal que le gouvernement de l’époque n’ait pas souhaité être représentée par ce film qui dresse de la vie grecque un portrait terrible : misère, corruption, usure, mirage de l’argent et de la vie facile. Le cinéma grec lui tient là son premier très grand film néo-réaliste. Mais il marque aussi pour un prologue incroyablement moderne, avec une voix-off en forme de cri qui dévoile de façon quasi documentaire le théâtre du drame. Enfin et comme toujours chez ce cinéaste, il vaut pour sa photographie, sa musique, son érotisme surprenant mais plus encore pour la qualité de son interprétation avec un Yorgos Foundas qui se détourne des charmes époustouflants des filles de mauvaise vie pour les beaux yeux de Margarita Papageorgiou, qui sera ensuite la Baby de L’ogre d’Athènes (1956). Il s’agit du second chef d’œuvre du réalisateur qui y mélange les influences dans un film miroir de M le maudit (voir les multiples rappels du fameux ballon de baudruche) où un faux coupable prend un moment la place de son double maléfique et découvert, en subit le destin tragique. Mais c’est plus encore par son ton tragi-comique que le film nous marque que par son esthétique plurielle mais personnelle. Des saillies comiques illuminent un destin cruel et le zeibekiko, danse finale sur la musique de Manos Hadjidakis, l’un des deux compositeurs qui a popularisé le Rebetiko, cette musique populaire alors au ban de la société, est un des plus grands moments du cinéma mondial. Dans ce moment où pour la première fois de sa vie, ce petit employé (on songe aussi à Lattuada des débuts et notamment au Manteau) ose, le héros danse sa souffrance puis en paie le prix, comme jadis M face au tribunal de la pègre. Koundouros va vite quitter ces influences pour s’engager dans une voie plus subversive.
De même que passé la très fraîche comédie Le réveil du dimanche (1954), réchauffée par ses interprètes Ellie Lambeti, Dimitris Horn ou encore Yorgos Pappas et sa lumière naturelle, Michael Cacoyannis s’engage dans une autre démarche esthétique entre le noir et blanc crépusculaire saisi par l’anglais Walter Lassaly pour l’implacable Fille en noir (1956) et la profondeur de champs de Fin de crédit (1958). La fille en noir est indubitablement le plus grand drame grec des années 50. Il immortalise son cadre, l’île d’Hydra et démonte l’oppression dont sont victimes les femmes et l’hypocrisie villageoise et sociale. La sécheresse de la mise en scène compense la photographie aveuglante et la légèreté des vitelloni locaux. Si Cacoyannis ose dépasser le drame atroce, c’est par nécessité que la catharsis conduise à une renaissance et resserre les liens. Il dit simplement que Marina a droit à la vie tout autant que ces morts innocents, drame qui perdure longtemps dans notre esprit après la fin du film. Fin de crédit est brillamment écrit et interprété et enregistre comme chez Welles la décadence de la classe aisée. Profondeur de champ et dérapages vers le film noir tranchent avec quelques escapades inconfortables dans la réalité du peuple. Il n’est cependant pas sûr que la fin vaille celle du Voyage en Italie. Le plus grand cinéaste grec de la période semble alors plus inspiré par sa comédienne ou au moins par son duo au sommet, que par une démarche politique, ce qui lui vaut l’ire de la critique nationale et assez rapidement internationale et le conduira à rénover ensuite son cinéma en revenant à la tragédie antique.
L’antique et la modernité
C’est Yorgos Tzavellas qui a brisé le tabou des adaptations de drames antiques à l’écran avec Antigoné (1961), les captations en étant même interdites à une époque. Tassos Goudelis précise que le pouvoir de l’époque, également coupable d’Hubris, ne pouvait tolérer la puissante symbolique tragique. Tzavellas ayant apprécié les fêtes delphiques au point de vouloir en étendre la portée, eut le courage et l’intuition de s’attaquer au sacré au moment même où en France la Nouvelle Vague soufflait. Il profite aussi d’un contexte plus favorable en Grèce où depuis quelques temps, des tragédies étaient jouées en plein air pour attirer les touristes. Bien qu’il ait su préserver la puissance magique du logos tragique ainsi que le rappelait Aglae Mitropoulos, le film est souvent taxé d’échec à cause de son faible score dans les salles grecques. N’essuie-t-il pas plutôt les plâtres en ouvrant une voix royale à Cacoyannis pour libérer le drame antique de la nécessité d’un espace scénique, si on en croit le dénuement et la profondeur des paysages d’Électre (1962) qui en ont fait le succès, de même qu’il est permis de penser que Tzavellas a mené à l’épanouissement tragique d’Irène Papas, déjà à l’honneur dans Antigoné ? Il a aussi pris le risque de tailler dans le texte, prouvant que le logos continue bien au-delà du verbe. Concernant Cacoyannis, le choix d’Euripide convient mieux à cet humaniste dont le grand apport fut de rendre à la tragédie toute son actualité, d’où le succès international que l’on connaît et qu’il poursuivra avec Les troyennes (1971) et un superbe Iphigénie (1977). Il faudra ajouter le Phaedra de Jules Dassin, la pièce transposée dans la Grèce de riches armateurs des années 60. Mais si l’antiquité est présente partout, il n’y aura plus guère qu’Alceste (Tony Lykouressis, 1986) pour se frotter à la tragédie en tant que telle. Mais ses codes se sont fondus dans le genre n°1 durant l’âge d’or, le mélodrame grec, aux stéréotypes très précis, en particulier chez Klak films, menant comme toujours à la catharsis, la différence résidant dans l’origine politique et sociale du drame.
Koundouros a aussi tenté de réconcilier histoire contemporaine et tragédie pour Les hors la loi (1958), film qui a été le début de ses soucis avec la censure et les producteurs, qui massacreront successivement La rivière et ses petites aphrodites (du titre original) dont il désavouera le montage final. Pour autant, Nikos Koundouros subvertit le premier la comédie pastorale antique dans Jeunes aphrodites (1963) pour en tirer un récit universel du premier amour, de ce temps d’avant la tragédie, l’âge de l’innocence des hommes à une époque où nous étions presque égaux aux animaux. Du jeu à l’amour – et en cela l’érotisme du film est au moins aussi fort que chez le Bergman de Monika -, du sédentaire au nomade plutôt que l’inverse, le cinéaste nous immerge dans une poésie primitive, sensualiste et spiritualiste et aucun autre mythe n’a jamais paru autant à notre portée. Très plastique, le film doit tout à l’imbrication de ses éléments, roche, eau, chair, soleil. Par ailleurs la musique d’un jeune compositeur Yannis Markopoulos nous transporte en quelques rythmes au cœur de la fête païenne. Les grecs sont bien sévères sur ce film magnifique dont Koundouros ne put tout maîtriser, ce qui ne découragea en rien ses velléités contemporaines pour le suivant.
Car un vent nouveau souffle sur la Grèce. Jusque dans le cinéma populaire où la romance se fait plus passionnelle, plus érotique (voir par exemple l’influence de Plein soleil sur un film comme Monemvasia (1964). D’autres starlettes se font un nom dans la série blondinettes qui mettent le public grec en émoi. C’est maintenant le tour de Zoé Laskari qui fera tourner la tête de Yannis Dalianidis et pour la quelle Finos films s’encanaille jusqu’au film de prison de femmes. Stéphania (1966) n’est pas avare d’étonnantes idées de mise en scène, passant alors dans ses délires du mélo teenager au film d’exploitation débridé. On devra à ce duo quelques beaux films musicaux et colorés (Les perles bleues, 1973) avant que le cinéma populaire ne s’effondre, assassiné par la dictature de la télévision. Des classiques se font aussi plus osés comme Grigoris Grigoriou (quoique Trouba 67 (1967) reprenne pas mal de motifs à Ville magique revu sauce sixties) ou Kostas Manoussakis et son portrait de violeur dans l’excellent La peur (1966). On en retient un découpage et une mise en scène particulièrement oppressante où chaque élément de la vie rurale (animaux de basse-cour, grange, maison) ou du paysage (les marais) devient anxiogène. Le cinéaste ne choisit pas entre cinéma d’exploitation et cinéma d’auteur, utilisant le voyeurisme comme moteur des pulsions. C’est néanmoins la fin qui contient la charge politique, lors du bal de mariage où la communauté danse pendant que le cadavre de la servante muette, violée et assassinée par le fils d’une riche famille, refait surface. A noter la superbe photographie et encore une étonnante musique de Yannis Markopoulos qui utilise une rythmique à base bruits métalliques de la ferme, nous donnant vraiment l’impression que le meurtrier à la tête prise entre le marteau et l’enclume. Un film formidable qui nous fait regretter que Manoussakis ait arrêté prématurément sa carrière, alors qu’on en mesurait l’évolution depuis sa première romance avec Aliki Voyouklaki (Amour dans les dunes, 1958) en passant par le montage dialectique de Trahison (1964) qui le fit en son temps et bien avant Verhoeven, comparer à Leni Riefenstahl et lorsqu’il déclencha un scandale du à ses prix à Thessalonique. Il faut mentionner le beau film grave du metteur en scène de théâtre Dimitri Kollatos, La mort d’Alexandre (1966), film presque dénué de dialogue mais qui échappe au mélo pour traiter de l’agonie d’un jeune homme malade de leucémie.
L’occupation elle-même devient un sujet de dignité avec Éclat de gloire (Panos Glykofridis, 1966). Deux émigrés reviennent de France tourner des œuvres fortes et engagées : Ado Kyrou, le surréaliste de Positif, traite lui aussi de l’occupation dans le sobre Bloko (1965), trop brechtien pour le publique de l’époque, quand par contre Nicos Papatakis peut lui se lâcher et tourner des images baroques au noir et blanc profond de Jean Boffety pour Les pâtres du désordres. Cette métaphore de la situation grecque à la veille du coup d’état est traitée à travers les conflits endémiques des différentes classes sociales d’un petit village. Le symbolisme puissant évoque parfois Bunuel, mais certaines scènes dont celle dans la cour de l’école, doivent tout à la tragédie. Le final dans les rocailles est somptueux et achève de faire de Papatakis un vrai poète de l’espace, dans un pays qu’il semble n’avoir jamais quitté. Il faudrait citer Z de Costa-Gavras, même si tourné à Alger, il a le mérite de montrer de façon très explicite comment les forces de la réaction avancent leur pions lors de l’affaire Lambràkis de 1963 et quand bien même il est tourné à rebours du coup d’état (1969). L’Oscar du meilleur film étranger prit donc un goût un peu rance. Formé par le documentaire et après deux comédies, Robert Manthoulis tourne Face à face (1966) sous influence française, un film en prise réelle avec les luttes politiques et sociales et conclue sur l’arrivée la dictature militaire. Il devra s’exiler en France et reprendra ses activités de documentariste pour la télévision. Enfin, peu avant le coup d’état, Dimos Theos a commencé le tournage d’un grand film politique sur l’assassinat du journaliste américain George Polke durant la guerre civile, Kierion (1967). Ce thriller porte la marque du meilleur film noir et de son époque angoissée. Certains considéreront qu’il s’agit du coup d’envoi du Nouveau Cinéma grec, car y participent d’une manière ou d’une autre, tous ses acteurs futurs, les Angelopoulos, Voulgaris, Sfikas, Ferris, Tornès, Marketaki, Nikolaidis, Panoussopoulos, mais la liste n’est pas exhaustive ! Fort heureusement Theos parvient à quitter le pays pour en achever le montage en Angleterre. Le film sera présenté triomphalement au festival de Thessalonique en 1974. Hélas, les films de ce personnage central du nouveau cinéma (monteur plus tard du Balamos de Stavros Tornès), tournés à raison d’un par décennie, seront toujours mal accueillis en Grèce et l’œuvre de Theos nous reste peu visible.
Un souffle nouveau
Un cinéaste moderne, Takis Kannelopoulos s’impose dès son premier court-métrage documentaire, Mariage macédonien (1960) où il retrouve des rituels antérieurs au christianisme mais bien vivants. Thassos (1961) est le portrait d’une île dont le commentaire contrebalance la beauté des scènes et des paysages. Photographié par le chef opérateur des Jeunes aphrodites, Giovanni Variano, mais aussi par Yorgos Danalis qui deviendra son collaborateur attitré, son premier long, Ciel (1962) porte l’influence de l’Antonioni du Cri. Il s’agit d’un magnifique film de guerre où celle-ci (la campagne d’Albanie, épisode sensément glorieux de l’histoire militaire grecque) se voit déconstruite et vidée de tout patriotisme. Le néant redonne du tragique à l’existence quand les soldats meurent de façon aussi absurde et triste. Avec ses ciels lourds et ses matins mouillés, l’art de Kannelopoulos annonce le futur cinéma d’Angelopoulos, comme né de cette boue. Beaucoup considèrent L’excursion comme son meilleur film mais on peut lui préférer le beaucoup plus formaliste Parenthèse (1968) qui par son sens de l’espace démonte ou raccommode une histoire d’amour, dans l’esprit des plus beaux films italiens de la pếriode. Avec Kannelopoulos, on ne sait pas vraiment si la romance constitue la raison d’être ou le masque. Raconté à la première personne en voix off par l’héroïne, le film est un pied de nez à l’idéologie phallocrate et doloriste en vigueur. L’adultère reste hors champ, il disparaît dans l’ellipse comme une formalité, tout le contraire de ce que le cinéma érotique produit par la dictature va s’échiner à montrer. Le jeu avec le récit se calque sur les égarements de l’âme, les accélérations cardiaques. Certaines idées trouveront leur prolongement chez Angelopoulos (un ballet de cyclistes s’enroule autour du couple, les chaises vides disposées sur la plage, l’hiver, déjà l’hiver). Ce chant d’amour inspiré par le Brève rencontre de David Lean hante le spectateur par bien des aspects (la texture éternelle des vagues renforcée par ce noir et blanc floconneux), alors que dans un mouvement de reflux, la narration ne cesse de nous mettre à distance, de nous perdre parfois pour mieux nous renvoyer à nos propres histoires. Trop évanescent, le film n’a pas trouvé preneur en son pays, déjà engagé dans un matérialisme politique quand cet acte de résistance par l’amour désarme pourtant le régime un temps assoupi. Par la suite l’apparition de la couleur n’affadira en rien le cinéma mystérieux de Kannelopoulos, bien au contraire, sa manière de cadrer s’accorde merveilleusement à la simplicité de ce qui est filmé, évoquant des œuvres essentielles comme Reis et Cordeiro (Chronique d’un dimanche en 1975) et retrouvant un format à peine plus traditionnel pour Sonia (1980). Un cinéaste absolument majeur dans l’histoire du cinéma et qui n’aurait jamais du tomber dans l’oubli.
« Apollinien et dionysiaque » selon Manos Efstratiadis, Alexis Damianos tourne en tout trois films à commencer par Jusqu’au bateau (1966), immédiatement reconnu et primé en Grèce comme en France, film passionnel composé trois histoires se déroulant dans un petit village et qui contenait déjà une scène érotique parmi les plus belles du cinéma grec. Il annonce celui que la critique considère comme le plus grand film grec du siècle, Evdokia (1971) dont une des figures centrales est à nouveau une prostituée. Bestialité et passion amoureuse sont les traits principaux d’un film qui reprend les mêmes lignes tragiques du récit précédent. Acteur dans de nombreux films ou série (il joue le père dans La peur), Damianos ne pourra tourner qu’un seul autre film au bout de vingt ans d’efforts, L’aurige (1994), où il renoue plus directement avec les mythes originels pour revisiter l’histoire grecque.
Mais il semblerait que le film grec le plus à la fois contemporain et international de la période soit l’exercice de style Vortex, d’abord titré le visage de la méduse et entamé par Nikos Koundouros en 1967, pour un tournage fini en Italie dans des conditions plus que précaire. Son récit en forme de brèche antonionienne, sa mise en scène voyeuriste de la sexualité reprend d’ailleurs Blow up mais s’inspire aussi déjà beaucoup des love in et performances californiennes, ainsi que sa manière de tourner (une mise en abyme du cinéma underground qui montre comment la sexualité peut être appréhendée et travaillée en tant que matériau artistique) furent perçus comme un exercice autistique et une pâle imitation de ce qui se faisait ailleurs (le Bergman du Rite, Godard, Pasolini, les nudies, le jeune cinéma allemand). Le film reste une réelle curiosité plus qu’un échec – toute expérience matérialiste ne saurait l’être -, qui dit avant même 68 que la représentation de la sexualité ne conduit qu’à sa consommation et avec elle, à la consumation du spectateur-voyeur. Reste à apprécier l’aspect rituel, les mythes reconvoqués et la musique d’Aphrodites child pour une œuvre mondialisée avant l’heure. A redécouvrir avec une mise en perspective de son processus !
On ne compte plus les futurs grands cinéastes qui se lancent dans le format court : Costas Ferris avec Ta matoklada sou lamboun (1961) où dans ses dérapages chorégraphiques se dessine déjà son amour du rebetiko, Stavros Tornès et Kostas Sfikas pour l’étonnant Santorini (1967), visite d’une île colonisée par le tourisme étranger et habitée par leur caméra fureteuse, Nikos Nikolaidis, Pantelis Voulgaris et son savoureux Jimmy le tigre (1966), Tonia Marketaki avec Giannis and the road (1967) si ancré dans son époque avec ce mélange de rapidité et de gravité, cette manière de saisir la ville, ou plus important encore pour le théâtre encore et notamment en France, le metteur en scène Dimitris Kollatos avec un court sombre et sobre, Les Oliviers (1964) sur le mariage forcé en Crète, qui sera interdit jusqu’en 1974. Dimos Theos et Fotos Lambrinos ont tourné le très engagé Cent heures de mai (1963), écrit et réalisé à chaud sur l’assassinat de Lambràkis. Bref, le champs documentaire se permet plein de libertés et on y ose beaucoup comme en témoigne encore le traitement de Cases of No (1965) sur les horreurs de l’occupation qui commente dessins et photographies (Lakis Papastathis et Dimitris Avgerinos). Le court documentaire va se faire de plus en plus satirique (situation politique oblige) et mordant avec ses images de dictatures à travers les âges dans le Visit Greece (1970) de Fotos Lambrinos, qu’il monte lors de son exil moscovite.
Qu’as-tu fait à ta femme mon colonel ?
Le cinéma des colonels n’a que peu d’intérêt. Les films de guerre ultra nationalistes envahissent tout y compris la télévision mais vont vont laisser bien peu de traces dans l’art cinématographique. Leur coût idéologique est sans doute plus élevé… Il faut heureusement rendre hommage au courage politique du plus grand acteur comique grec, Thanassis Vengos. Déjà ses comédies des années 60 (Haut les mains Hitler, Famille nombreuse, Un Vengos fou, fou, fou, Le concierge aux pieds fous) se distinguaient par leur manière de capter l’air des années 60. Mais c’est à partir de son antimilitariste Qu’as tu fait à la guerre Thanassis ? (dont le titre français ne laisse aucun doute quant à ses influences) que son statut change aux yeux du public. Défini par Dinos Katsouridis comme une satire anti-guerre, il dénonce dès les premières scènes la famine orchestrée par la dictature. La première poursuite totalement délirante, absurde et néanmoins tragique à laquelle doit échapper le héros, le met en parallèle avec un résistant. A travers lui et comme lui, c’est tout le peuple grec opprimé qui se met à résister : scènes de torture sauvages, bêtise militaire avec des soldats au comportement de troupeau lobotomisé et par opposition de beaux personnages féminins défilent à un rythme frénétique. La mise en scène a quelques morceaux de bravoure et n’a rien à envier aux angry young men brittons. C’est surtout son sens de l’espace qui marque, comme si Thanassis habitait un pays réduit à l’état de château fort, de kommandantur plus précisément ! Dans la meilleure tradition burlesque, Vengos a un rôle très physique (Keaton rencontrant De funès) et il est difficile de ne pas éprouver les conflits et péripéties qu’il traverse malgré tou avec élégance. Son style comique fait référence au karaghiosis, le théâtre d’ombres grec, où il s’agit toujours d’une variation improvisée sur un même thème. A l’instar de certains burlesques américains, le scénaristes et cinéastes s’adaptaient en effet à la verve comique et au talent d’improvisation de Vengos. Le succès fut d’ailleurs phénoménal et il irrita le régime le qualifiant de « machination du parti communiste grec » ! Ça ne les empêchera pas de tourner dans la foulée un Prends ton fusil Thanassis (1972), où le duo se renouvelle totalement sans rien perdre de sa verve.

Prend la queue comme tout le monde Thanassis ! (Thanassis Vengos dans Qu’as-tu fait à la guerre Thanassis?)
Le cinéma de genre parvient parfois à se distinguer, comme par exemple Nikos Foskolos dans son western Les balles ne reviennent pas (1967). Il séduit à la fois par le primitivisme de son scénario centré sur des bandits de montagne de l’époque ottomane (Klephtes) mais plus encore par l’utilisation des paysages qui parviennent à rendre à peu près crédible sa chasse à l’homme, mais il vaut d’être mentionné dans le paysage du western européen que les grecs appellent eux plutôt un « drame social rural », inspiré des romans klephtiques.
L’Italie restant le voisin de référence, le giallo et le polar font de timides incursions avec Kostas Karagiannis ou Nico Mastorakis, toujours entre la Grèce et une carrière internationale qui culminera dans les années 80 avec son Blind date, variation habile sur le cinéma d’Argento, mais le reste de sa carrière mérite qu’on y revienne et. Quelques films lorgnent vers le thriller et l’action, voir ceux de Pavlos Filipou dont Le petit témoin de l’orient express circulera bien chez nous en vidéo mais qui n’est quand même pas très affriolant.
Mais la grande affaire de la période est la même que dans les autres pays occidentaux : le film érotique. Et en Grèce, il lorgne vers la pornographie et sa part dans la production totale atteint quand même jusqu’à 80 % de tous les films réalisés. Le genre dit « des 3 S » (« soleil, sexe, souvlaki ») commence à poindre au début des années 60, d’abord franchement chez Dinos Dimopoulos (Amok en 1963 avec la torride Zeta Apostolou qui connaît un beau succès à l’étranger), puis de plus en plus pimenté dans la relation entre Zoé Laskari et son cinéaste fétiche, Yannis Dalianidis (Katisforos, Iligos et dans une moindre mesure Stephania). La Grèce prend donc avec enthousiasme le virage hardcore (au sens propre, comme le raconte L’insatiable dans ses n° 2 et 4 puisque les sociétés avaient pris l’habitude de se jouer de la censure en assurant elles-mêmes le caviardage de leurs films), les films sortant directement en cassettes en Grèce. C’est l’heure de gloire du pape du genre, Omiros Efstratiadis (Des diamants sur la peau, Provocation, L’insatiable) et dans son sillage de Vangelis Serdaris (le cultissime Love on a horse retitré en France La fille à deux places) qui fut longtemps l’assistant de Kostas Karagiannis (Tango of perversion), de Pavlos Parashakis (Mirella, Nature dépravée, Passion beach, Peau contre peau en 1972), Marios Retsilas et Dimitris Papakonstantis (Sexomania), Yannis Kokolis (Metamorfoseis), Erricos Andreou (Lesbian august, Anazitisis), Andreas Katsimitsoulias (Koftes Diakopes), Pavlos Filipou (Les déchaînées du plaisir) ou encore d’ Ilias Mylonakos, rendu célèbre par sa collaboration avec Laura Gemser (Les secrets érotiques d’Emmanuelle, 1980) et dont, comme pour Efstratiadis, la productivité déborde très largement sur les décennies suivantes. Pour une étude poussée des œuvres et sous-genres, la lecture du fanzine L’insatiable, consacré à ce seul genre dans ce seul pays, est chaudement recommandée car elle nous en dit long sur l’importance numérique et osons le, artistique. Comme en France et ailleurs à la même époque, l’érotisme a aussi contaminé bien des auteurs engagés à gauche et a profondément influencé la décennie suivante et ses cinéastes plus esthètes ou auteurisants, considérés, eux, comme respectables.
Pas la fiction, le problème
En attendant, la fin de la dictature ne peut déjà plus contenir la poussée, pas seulement celle sexuelle qu’ils ont encouragés gaillardement, mais surtout politique et artistique. Certains cinéastes sont d’ailleurs engagés très physiquement, jusqu’à l’action clandestine et armée. En dehors de Kierion et du court-métrage, on s’accorde à dire que le nouveau cinéma grec prend son envol en 1970, année du premier film de Théo Angelopoulos, La reconstitution, film enquête et drame social hivernal, œuvre cryptée pour échapper à la censure. L’auteur est en outre le premier à oser s’attaquer aux tabous historiques dès le sublime Jours de 36 (1972) qui pose les bases du style Angelopoulos que la génération suivante caricaturera ainsi : « des films de guérilla sous la neige très très lents » (Dracula d’Exarcheia). Les mythes se réinvitent très vite dans la structure même du scénario, la recouvrent ou le perturbent et bientôt jusqu’à la mise en scène.
Le voyage des comédiens (1975) reste un des plus grands films grecs et pose aussi le problème Angelopoulos, cette « autorité avec laquelle il a établi son style » d’après Michel Ciment, soit une mise en scène opératique, baroque, avec ses travellings infinis, chorégraphiée et coulée dans les grands cycles historiques et qui reviendra dans la dernière partie pour ses films plus internationaux (Le regard d’Ulysse, Le pas suspendu de la cigogne, L’éternité et un jour et le posthume La poussière du temps) qui deviennent alors la vitrine de la Grèce. Si ce très (trop ?) gros travail de distanciation moderne et critique appelle à la réflexion, limiter à cela son cinéma, ou à son coût de production, à sa portée comme à cette renommée non usurpée, serait une insulte aux capacités de renouvellement d’Angelopoulos dont chaque film fait œuvre par son acte même de création, précisément à un moment où le cinéma était synonyme de résistance et avec lui, il va le rester comme pour la fantastique fresque villageoise Alexandre le grand (1980). Conscient du danger, guidé par sa seule mélancolie, Angelopoulos devient le cinéaste de l’errance et va se laisser rattraper par le fait historique le plus important de la fin du siècle, les grandes migrations. En réalité, comme déjà mentionné la Grèce (et les Balkans avec elle) n’a jamais cessé d’être un lieu de passage et d’accueil de réfugiés mais aussi l’entonnoir d’une imposante diaspora grecque.
Bien sûr, le dispositif un poil solennel ne saurait faire échapper son œuvre à la critique, mais personne ne peut décemment en contester l’importance artistique et historique. Des détails peuvent ici ou là s’avérer problématiques. Doit-on pour autant laisser accuser Théo Angelopoulos d’être l’instrument de la perte du cinéma grec, en ayant siphonné les subventions au seul profit d’un cinéma de prestige ou en ayant fait de l’ombre aux autres auteurs ? Un auteur saurait-il être responsable d’être au bon endroit au bon moment quand d’autres sont condamnés, et certains bien volontairement, à être décalés et à toujours jouer les poètes maudits ? Il est un peu trop simple de réduire Angelopoulos au système qui lui a permis de s’exprimer, (comme le fera Amengual en France pour Jancso, un des inspirateurs d’Angelopoulos), pas plus qu’on ne peut en rendre responsables Mercouri ou Papandreou. Dans les années 70, les films grecs sont là, pour plus d’une trentaine de titres, brillent dans les festivals et y raflent les prix. Le cinéma grec connaît alors des sorties en salles à l’ouest qui ne seront certes pas suivies d’éditions vidéo, et il faut exhumer un certain nombre de perles et de noms.
Lui aussi sera accusé d’être trop coûteux et trop gourmand. Pantelis Voulgaris commence à marquer le cinéma dès Les fiançailles d’Anna (1972) dont l’atmosphère et le scénario le rapprochent des films de Saura sous Franco, en plus dépressif. Au contraire malgré son thème (une île camp de concentration pour prisonniers politiques de l’après-guerre, gouvernée par l’absurde), Happy day (1976) est un film solaire et vite rattrapé par les démons poétiques, théâtraux et chorégraphiques du cinéma grec qui en font une œuvre résolument moderne et à part quoiqu’à la résonance réellement universelle, bien que violemment rejetée par la gauche grecque en son temps. Dans les années 80, ses grandes mises en scène (Elefthérios Venizélos (1910-1927) (1980) ou Les années de pierre (1985), contribuent elles aussi à réhabiliter l’histoire grecque, mais prouvent que Voulgaris est d’abord un immense metteur en scène, exigeant, visionnaire mais aussi accessible au grand public. Ce dernier film est d’ailleurs primé en Grèce et à l’étranger, quoique sévèrement critiqué aux États-Unis par Dan Georgakas. La suite confirmera cet embourgeoisement et ce virage pris vers un cinéma de qualité (Jours tranquilles d’août, 1991, Les mariées en 2004) loin des « formes nouvelles » qu’appelait l’auteur au début des années 70. Quoi que moins ambitieuses et plus classiques, ses dernières œuvres n’ont pas de mal à se hisser dans le haut du panier de la production grecque actuelle (With heart and soul, 2009) qui est hélas presque la seule « table rase » réussie par le modèle économique appliqué à la Grèce.
L’œuvre de Kostas Ferris, également critique, échappe plus au canon du genre, à l’instar de sa première parodie réalisée dans les années 60. Avec Rebetiko (1982), il donne néanmoins à l’Histoire grecque et au Nouveau cinéma une œuvre phare. Ici, la scénographie grecque a pris la forme d’une rue, d’une impasse et quoique ses musiciens se déplacent dans la géographie (et jusqu’aux États-Unis, jamais on n’échappe à ce cocon intime où brille Marika dont l’histoire nous est contée. La narration vient directement de la musique et c’est la Grèce qui chante, ouvre et clôture le film, avec ce genre entier et ses artistes enfin réhabilités après avoir été exclus ou emprisonnés. Le travail musical est formidable et le legs culturel, extraordinaire. Cette fois, Ferris a contenu ses débordements esthétiques qui ont fait sa marque de fabrique dès La meurtrière (1974), histoire d’une vielle infanticide. Le trauma récurrent semblait tout droit emprunté au giallo et les visions surréalisantes n’avaient rien à envier à celles d’un Luigi Bazzoni (Le orme). Après tout, Ferris est quand même l’auteur des paroles de l’album 666 des Aphrodite’s child écrites durant son exil parisien. Son Prométhée enchaîné à la deuxième personne sera bien plus qu’une captation, plutôt une réflexion sur le pouvoir teintée de philosophie et nourrie des tentations expérimentales de l’auteur comme ce sera toujours le cas dans Oh Babylone son dernier film en 1988 d’après Euripide, délire dionysiaque qui contient des scènes purement clipesques et qui sera récompensé à Thessalonique. Scénographie et expérimentation photographique marquait aussi son adaptation des Nuits blanches de Dostoïevski, Deux lunes en août (1978).
Quatrième grand nom, Nikos Panayotopoulos dont Les couleurs de l’iris en 1974 fait date dans le cinéma grec de par sa modernité et sa mise en abyme et qui annonce dix ans plus tard L’état des choses de Wenders. Il adapte ensuite Cossery pour Les fainéants de la vallée fertile (1978) qui restera culte et recevra un léopard d’or à Locarno. Il y excelle à mettre en scène son huis-clos, point commun avec l’univers d’un Nikolaïdis. L’enfermement politique débouche sur un rapport à l’espace et au monde réduits dans lequel la fiction se délite et qui va de pair avec le minimalisme du jeu. Mélodrama (1980) semble un retour orthodoxe aux valeurs du Nouveau cinéma, voir même de la modernité des années 60 qui engloutit le héros, quand tous semblaient conclure à l’impasse de ce type de cinéma. Panayotopoulos préfère convoquer Bazin pour rouvrir la fenêtre… En fait, avec ses obsessions de l’esprit des lieux ou pour la musique, le langage de Panayotopoulos est un des plus énigmatique, personnel et cohérent de tout le cinéma grec et même si après les années 2000, il a paru perdre jusqu’à ses fans, il y a toujours quelques beaux moments chez lui. Il réintroduit de la fiction, puis des genres, mais en dépit d’une rétrospective à La Rochelle, il n’a pas trouvé de reconnaissance publique à ce jour.
Au retour de la démocratie, le travail de mémoire devient l’obsession de Nikos Koundouros (excepté pour Les photographes en 1998) qui d’un Chants du feu (1975) documentaire aux fresques 1922 (1978), Bordelo (1984) puis Byron, ballade pour un démon (1992) a traité l’ensemble des problèmes de la Grèce à la racine, ne cessant de développer une mise en scène de plus en plus baroque.
Quelques auteurs se distinguent, passant de la politisation (Sous un prétexte dérisoire, de Tassos Psaras (1974), Jean le violent (1973) de Tonia Marketaki, qui elle-même participera brillamment à la révision historique avec Les nuits de cristal (1991), à la dépression (Oui mais… (Pavlos Tasios, 1972), Exile on main avenue et les hippies déçus de la politique de Nikos Zervos en 1977) ou se réfugiant dans la satire (Déluge de balles de Nikos Alevras, les films de Nikos Zervos comme Dracula d’Exharchia (1983) et toute la suite dont Telecannibals… ).
Dans le documentaire, de nombreux créateurs vont continuer à défendre certains préceptes éthiques et esthétiques. Citons le beau Polemonta (1975) de Dimitris Mavrikios sur la diaspora en Italie ou le Le lieu du crâne (1973) de Kostas Aristopoulos dont le sujet rappelle O acto da primaveira du portugais Oliveira, mais dans une perspective très locale et même, nue.
Anatreptiques
En marge, il faut parler de quelques œuvres uniques, de « films différents ou d’une pensée libre » selon la belle expression de Stella Théodorakis qui convoque l’Anatreptikos, l’esprit de la subversion selon Platon.
D’abord celle anarcho-esthético-nihiliste de Nikos Nikolaïdis. Après deux courts remarqués dans les années 60 et un passage dans Kierion, il met à profit la dictature pour écrire un roman. Cet exil intérieur va devenir le moteur de sa création avec un premier film en huis-clos, Eurydice BA 2037 (1975) qui marque par sa sécheresse cette descente aux enfers contemporaine d’une jeune femme, par ailleurs déjà en proie à des fantasmes érotiques, d’où une scène limite perturbante avec une poupée. Hormis l’agression du prologue dans le genre Home invasion, plusieurs scènes hallucinatoires organisent un paroxysme dans sa psychose. Esthétique et thématiques sont déjà bien en place dans ces débuts de Nikolaïdis qui rénove ici le film de genre (une atmosphère de science-fiction povera) et lance sa trilogie « Femmes du cauchemar à venir » qui s’achèvera avec son ultime film. Film halluciné, truffé de symboles et tourné avec des noirs profonds (il fera mieux encore avec Singapore Sling à la fin des années 80). Ce film fit une grosse impression au festival de Thessalonique. La débauche s’étend au groupe dès son second long-métrage, Les misérables chantent encore (1979). Un film rock n roll et un ton littéraire beat qui ont séduit le public de l’époque par leur originalité et une fraîcheur qui tranchait avec l’esprit de sérieux bien pensant du cinéma politique mis en valeur. Le film fait plus directement référence au film noir et à la culture populaire quand les kourelia, la bande de jeunes désœuvrés du titre, chantent les tubes américains des années 50 qui ryhment leurs exactions (viols et meurtres). Se dessine déjà l’exceptionnel talent visuel du cinéaste, peut-être encore plus flagrant en couleur si on en juge par les plans hâlés des jardins. Un vrai sens de la mise en scène. Quant à la suite, elle n’est pas moins culte, en particulier Tendre gang (1983) et son groupe de jeunes sous surveillance, à la limite du phénomène sociologique. La bande encore. Il enchaîne sur un post apo littéraire Morning patrol (1987), avec un monde où survivent encore les salles de cinéma. Mais le film noir revient vite par la fenêtre. Son film suivant sera un vrai néo-noir, expression bien galvaudée quand peu de films prennent autant de risques pour être fidèle à une atmosphère, un film tourné selon l’auteur « dans une atmosphère érotique humide, violente et très dangereuse » (L’insatiable n°3) Que le film soit le plus connu car distribué en France en dvd chez E.D ne le rend pas plus aimable : esthétique fulgurante mais scatologie, érotisme à tous les étages, fétichisme et sado-maoschisme pimentent d’arsenic ces vieilles dentelles. Et les huis-clos continuent, See you in hell my darling se teinte de nécrophilie, continue ses jeux avec ses actrices et s’aliène le public qui avait fait le snob devant Singapore sling (1990). Une strip teaseuse noire trône dans Losers take all tourné au coeur d’Exharchia, comédie crépusculaire qui accompagne l’évolution d’Athènes et de la Grèce vers l’abyme de la dette. Nikolaïdis boucle une œuvre unique avec son film testament The zero years (2005). Il n’aura jamais « débandé », ultime rejeton d’une génération tournée vers les autres. Mais pour autant, toujours maudit, toujours à part.
Changement total d’univers mais presque ésotérique et puisé à même l’univers avec l’oeuvre poétique de Stavros Tornès qui aura d’abord hanté les films des autres comme comédien – avec toujours cette présence étonnante à la caméra – avant de tourner ses premiers courts dans son nostalgique exil italien. En dehors des modes et de tous codes, entre le documentaire et le conte antique, Balamos (1982) témoigne de ce regard singulier sur le monde. A l’occasion d’un documentaire de commande sur les chevaux de Thessalie, Tornès tourne un voyage au coeur de la fable du côté des roms grecs, un retour à la source dans tous les sens du terme dont le cheval est le dieu. Du cinéma libre. Avec Karkalou (1984), le jeu se fait plus fictionnel mais la narration est toujours aussi erratique. Un héron pour l’Allemagne rentrera plus dans les clous mais pas suffisamment pour que Tornès soit accepté dans le paysage du cinéma grec.
Du cinéma expérimental, on a retenu le nom international du duo Maria Klonaris et Katerina Thomadaki qui de leur exil français prêchaient pour une féminité radicale et un cinéma autre. « La culture féminine a besoin de procédés ouverts, mobiles, non assujettis, libres ». Figures majeures du cinéma expérimental, elles tournent à partir du milieu des années 70 de nombreux films courts assez bien diffusés en occident. L’ange amazonien en 1993 synthétise pas mal de leurs recherches et se révèle toujours aussi puissant.
Kostas Sfikas donne lui toute sa pleine mesure de son long Modelo (1974), traduction dynamique et cinématographique du marxisme, avant de revisietr l’histoire grecque avec Allégorie (1986). Cinéaste-colleur, Thanassis Rentzis commence à la même époque, coréalisant Noir + blanc (1973) avec Nikos Zervos, puis livre en 1981 un film très abouti Electric angel, suite de collages, de dérapages pop, de duos amoureux et autres obsessions érotiques autour du corps comme point sublime.
Il faut mentionner l’envoûtant documentaire musical de Fotis Psychramis, Polytope (Mycenes Alpha) Hybrid cinema (1978) qui a immortalisé le concert de Iannis Xenakis à l’Acropole, innovant alors dans le domaine de la musique électro-accoustique conçu comme une véritable installation son et lumière. Psychramis en tire un film de montage à la fois archaïque et visionnaire.
Antoinetta Angelidis commence par un cinéma poétique plus classique dans les années 70 : Idées fixes-Dies irae (1977) est tourné en France, puis elle se dirige ensuite vers quelque chose de plus directement grec, un film antique, chorégraphique, archétypique et plein de tableaux, Topos (1985). En 2001, Voleur de réalité est un incroyable délire on ne peut plus théâtral et féministe, mais dont on a le plus grand mal à s’extraire une fois happés par son langage visuel et chorégraphique. À cette cartographie secrète, il faut ajouter le film très libre de Pantelis Voulgaris, Les grandes chansons d’amour (1973 ou O megalos eroticos) mal compris lors de sa présentation à Thessalonique. Que penser de l’oeuvre de Vassilis Mazomenos depuis les années 80 (bien que les dix dernières années, il se soit dirigé vers la fiction narrative). Son style hybride surprend dès ses premiers courts (City, 1988) avec un travail sur l’immobilité, la non-animation ou presque et le mélange des textures et des images. Il va d’ailleurs porter à l’extrême cette démarche singulière en ornant ses films livres d’antiques vestiges architecturaux, qui ont pour effet de limiter ou d’encadrer le mouvement de toute image filmique.Il s’est attaqué successivement à l’Histoire en mélangeant gravures et images d’archives dans The triumph of time (1996), à l’économie dans Money, a mythology of darkness (1998), qui fait dans le minimalisme pompier s’il n’était pas bâti sur un sérieux sens de la dérision. Cela excuse-t-il pour autant l’utilisation d’images des corps décharnés des camps nazis, au centre de plans purement graphiques, comme si la séquence n’avait pour fonction que cette de réveiller le spectateur plongé dans l’ennui ? Au-delà de la pauvreté recherchée de l’animation, ce qui fatigue c’est la répétition du motif du livre et du même mouvement de caméra en une pauvre interface. Mazomenos s’intéresse déjà à la notion de catastrophe (Days of rage, 1995), au corps et à ses souffrances dans Remembrance (2002) qui croise celle d’autres êtres en migration (Words of sins, 2004) dont les images réelles ont quelque chose du cinéma amateur et premier et donnent donc envie de découvrir ses fictions présentées en festival, ne serait-ce que pour savoir si elles échappent au plombage en règle de l’imaginaire grec.
Télé cannibale
Dès les années 80, le nouveau cinéma se délite peu à peu dans une forme plus classique sauf chez les grands auteurs qui poursuivent leur sillon.
Définitivement rentré au pays après quelques brûlots tournés en France (La France de Giscard, 1977), Dimitri Kollatos continue de révolutionner le théâtre national à travers le théâtre de la complainte et de tourner de temps à autre un film sur un sujet difficile. Ça tombe bien, La vie avec Alkis (1989), film autobiographique et interprété par son son fils Alexandre, devenu plus tard à son tour comédien et metteur en scène, fait partie des rares beaux films sur l’autisme. Pas de misérabilisme mais de la justesse. On retrouve Alkis devenu jeune homme dans un film visuellement sublime et bouleversant, Je t’ai coupé une rose (1991), qui traite aussi de la disparition de sa compagne française, Arlette Baumann. Le duo père-fils revient encore dans Alexandre et Aishe (2001), une histoire d’amour située dans une ville où habite une importante communauté musulmane, reprenant ici un de ses thèmes de chevet : la religion et le rôle de l’église. En 2005, Destinée est une confession publique sous forme de film, puis en 2009, c’est à nouveau la religion qui est visée dans Le testament de l’abbé Meslier. En 2011, Kollatos crée le mouvement politique Porte à porte qui expérimente une nouvelle forme de débat et de communication pour lutter contre la politique du gouvernement grec et sa soumission à la Troïka. Il écrivait en 2014 « L’art c’est le scandale ! Ça devrait stimuler le citoyen au lieu que la science le rassure. Malheureusement de nos jours, l’art pousse le spectateur à dormir et la science l’inquiète ! ». Il a livré un nouveau pamphlet très personnel au festival de Thessalonique avec La revanche de Dyonisos (2014), dans lequel il remet en scène des situations désespérées ou simplement hallucinantes de la vie de tous les jours dans la Grèce en crise.
Autre documentariste seventies, un peu à la traîne du modernisme et qui cultive une errance un peu trop parasitée par le réalisme des année 80, Takis Papayannidis, dont on peut citer Ville natale (1987).
Dans En avant vers la gloire ! (Yorgos Stamboulopoulos, 1980), le récit mélange l’enquête d’un reporter et un vrai tour d’horizon de la musique populaire grecque touchée alors de plain fouet par le disco. Un curieux exercice de distanciation mais assez édifiant ! Il enchaîne avec le très esthétisant Attention danger ! (1983) qui réconcilie les tendances et recherches esthétiques de deux décennies. Le thème est ce que les grecs nomment les « thrillers sociaux du péché ». Affreux, sales, méchants et surtout extrêmement violents, une famille vit repliée sur elle-même pour expier un traumatisme (un père poignarde sa femme devant ses trois enfants, scène générique au ralenti éprouvante). Ils vivent dans un coin paumé du Damari (un des nombreux caps de l’Attique) au bord d’une ligne droite à flan de colline et prtaiquent la besogne de naufrageurs de la route au grand dam des villageois. Dépanneurs-casseurs, ils dépouillent leurs victimes à l’agonie. La violence est aussi intérieure, le père et la fille consommant volontiers leur inceste tout en excitant le fils aîné demeuré qui rêve de s’émanciper de l’encombrante tutelle paternelle qui l’oblige à squatter une carcasse de voiture pour tout logis. Enfin le plus jeune et peut-être le seul à sauver, enchaîne fugue sur fugue mais ne peut se résoudre à quitter la famille pour vivre avec son amante commerçante. L’arrivée d’un géomètre et le passage d’une famille de gitans vont perturber le petit commerce et créer une issue fatale. Pour autant, ce résumé ne vaut que comme cadre, tant il est transcendé par la mise en scène volontairement allusive dès la nuit tombée, avec un sérieux sens du découpage et des couleurs fulgurantes. Les années de survie dans la publicité auront été bénéfiques pour Stamboulopoulos qui a acquis une virtuosité technique rare chez ses collègues et quisuscite l’admiration des américains dans Variety. Puis ce sera ensuite le baroque Deux soleils dans le ciel (1991) sur le conflit entre disciples de Dyonisos et chrétiens. Ce retour à l’antique débouche comme pour tous ses collègues sur le film historique avec Pandora (2006). Dommage que la télévision ait trop accaparé Stamboulopoulos !
En ce début d’années 80, la Grèce est touchée comme ailleurs par une tentation esthétisante, parfois kitsch du côté du genre (La ville ne dort jamais d’Andreas Tsillifonis en 1984, qu’on jurerait parent avec Gilles Béhat, Luc Besson période Subway ou pire… Michael Schock !), parfois chic chez Dimitris Panayiotatos dans Les nuits avec Silena (1986) et ses obsessions voyeuristes, l’érotique science-fictio-fantastique Lovers beyond time (1990), ses couleurs vives et ses visions géométriques ou le néo-romantisme de Loneliness Everywhere, Loneliness Nowhere en 1998. Un curieux film d’action au féminin, Olga Robards (Christos Vakalopoulos, 1989) marque notamment la fin de la décennie. Côté thriller politique très bizarre mais léché et avec quelques scènes hallucinantes, Passage souterrain (1983) d’Apostolos Doxiadis. Il ne tourne hélas qu’un seul autre film, Terirem (1987) sur le théâtre d’ombres. Mais le passage au cinéma de cet écrivain pourtant né en Australie mérite vraiment le détour. Enfin, un peu moins osé mais pourtant plus connu côté Etats-Unis, le thriller de Georges Lazopoulos, Medousa (1998) est resté un one shot et on ne peut que le regretter, vu son atmosphère et sa sobriété.
Les stylistes ne sont pas exclusivement dédiés au genre. Deux des plus grands auteurs suivent un sillon bien spécial : libertin et dyonisiaque pour le grand chef opérateur Yorgos Panoussopoulos (Kyrou, Theos, Damianos, Voulgaris…) qui après un drame voyeuriste (Ceux d’en face, 1981), bien dans son époque, s’est orienté avec Mania (1985), le très sensuel et délirant Love me not (1989), puis M’aimez-vous ? (1995) vers des choses plus en rapport avec le Pan mythologique et son monde arcadien, particulièrement dans le sublime Mania où une jeune informaticienne violée par un satyre, déclenche une panique sensuelle dans un parc athénien. À partir de Testostérone (2004), son humour se dilue dans la profusion et ses ambitions esthétiques le quittent. Serait-ce que le bouc divin a quitté son cinéma ? Il en reste toujours les cornes comme le montre la danse exécutée par une femme dans un de ses derniers films, sans doute plus amusant à tourner qu’à regarder.
Intéressant le parcours de Fotos Lambrinos, prolixe documentariste de la décennie précédente qui va trouver à se renouveler dans la fiction, historique comme de bien entendu, mais avec une période moins traitée, l’époque médiévale dans le curieux Doxombus (1987). De même, après ses courts des années 60 et 70, Lakis Papastathis attaque les années 80 avec un grand film historique sur les bandits du début du siècle dernier, When the greeks (1981) et enchaîne avec un beau biopic de Theofilos (1987), le plus grand peintre grec moderne, puis dans La seule journée de sa vie (2001), avec celui de l’écrivain Georgios Vizneyos, mort dans un asile de fous et qui prouve qu’il sait toujours tourner de beaux films quelle que soit l’époque et le budget. Journée à Mytilene (2010) évoque avec émotion le retour d’un exilé parisien dans son île. Avant l’antique dans Alceste (1986), il y eut pour Tonys Lykouressis, les… antiquités dans Le sang des statues (1982), qui y furent même prises en otage ! Mais quelle mise en scène ! Il revient vint ans plus tard avec Approach (2017), un curieux film métaphorique dont les personnages étaient coincés dans des ascenseurs.
Après son premier film Angelos (1982) qui fut un des premiers à traiter le thème de l’homosexualité à travers la prostitution d’un jeune soldat, Giorgos Katakouzinos réalise Absences (1987), un film très académique sur la bourgeoisie du début du siècle mais superbement photographié au noir. Il disparaîtra après Zoé (1995), son troisième long. Christos Siopachas brise enfin la galace et relate l’extermination de l’armée révolutionnaire dans le déchirant La descente des 9 (1984), dont l’esthétique totalement réaliste quoi qu’immersive, est réchauffée par une belle lumière dorée. Aussi triste qu’inévitable. Transfuge des années 70, l’activiste libertaire Costas Zybrinis, cité par Nicole Brenez parmi les cinéastes militants les plus intéressants, était connu pour son court-métrage des années 70 sur les évévènements à Polytechnique où le gouvernement de la junte décida de briser la révolte en y envoyant un char qui y fit 24 morts le matin du 17 novembre 1973. Zybrinis tourne par la suite un bien classique Le dernier pari (1989), sorte de polar politique, dont l’introduction rappelle Le dossier 51 de Deville et qui porterait presque à sourire lorsqu’on se remémore les publications américaines à l’ère Reagan présentant Zybrinis comme l’un des terroristes grecs les plus actifs depuis son passage dans les camps du Liban. Espérons découvrir ses films pour peu qu’il soient aussi bons que ceux d’un Masao Adachi !
Côté documentaire, il faut mentionner le superbe Bon retour au pays, camarades (1986) de Leftérris Xanthopoulos sur le retour en Grèce de réfugiés hongrois. Xanthopoulos surprend avec sa profondeur de champ, l’audace naturelle et tranquille de sa narration, qui alterne de purs morceaux de réel avec de nombreuses scènes organisées, pour un film qui parle peu mais montre beaucoup et surprend par son langage en avance sur son temps, finalement plus proche d’Angelopoulos que du documentaire traditionnel. Hélas, on ne connaît du cinéaste qu’une fiction sortie en France, Le montreur d’ombres (1991) qui évoque le passage du théâtre d’ombres au cinéma mais déçoit par son conformisme. Ne reste peut-être que cette jolie scène érotique dans une salle de cinéma. Dans le champ documentaire, il faut aussi signaler le magnifique Rom (1989) de Menelaos Karamanghiolis, dont la force des images offre un tableau remarquable de la situation des roms grecs.
Dans une optique réaliste, on mentionnera l’apport inégal de Theodoros Marangos avec Apprends les lettres mon enfant (1981) qui retrouve la même observation sociologique que dans A vos marques (1973), où la religion orthodoxe devient le sujet principal de la vie rurale en Arcadie. Il y manque toutefois le mordant politique de son documentaire Grève dans les années 70. Il alterne un peu tout et n’importe quoi, mais il faut signaler Isovites (2008), comédie de prisonniers et adaptation de la série télé en marionnettes. Inégale encore la paire Giorgos Korras et Christos Voupouras avec Déserteur (1988), puis plus intéréssant les deux films ultérieurs de Voupouras en particulier le magnifique La danse des chevaux en 2001, héritier plus classique de Tornès mais qui mélange mythe et naturalisme pour une riche description culturelle, portée là aussi par de très belles images. Un film par décennie, ça reste un peu maigre.
La comédie était un genre en désuétude, si ce n’était l’inusable (?) Thanassis Vengos. Citons toutefois Alaloum (1982) de Giorgos Apostolidis, Giannis Smaragdis et Giannis Typaldos ou Harrys ou latinos (1984, Panos Angelopoulos), meilleur que le précédent, avec l’inénarrable comédien et chanteur Harry Klynn, à mi-chemin entre l’inspecteur Clouseau et Borat (en plus authentique surtout !). Mais l’école comique reprend du poil de la bête avec les comédies populaires très « pasok » de Nicos Perakis photographiées par Panoussopoulos, en particulier l’énorme succès de Planque et camouflage (1984), un M.A.S.H. à l’héllène. Nikos Zervos continue pour le grand écran ou la vidéo son travail autour de la satire et fait penser à un mix entre le meilleur de Jean-Marie Poiré et Jean-Michel Ribes sous substances, en particulier dans Patris, listeia, oikogeneia (1987), mais la parodie est peu exportable pour qui n’a pas les références. On peut préférer ses teen comédies coquines comme Girl-zoo (Ménagerie féminine, 1984) ou Boys house vs girl’s house (1985), l’érotisme soft étant souvent une constante du bonhomme à l’humour très vif. Les grecs le comparent à John Waters, ce qui n’est pas une mince référence !
Mais son morceau de bravoure reste sans conteste son Dracula d’Exarcheia (1983), génération rock oblige, au parfum anarchiste très prononcé et qui tourné in situ, tire sur tout ce qui bouge, avec notamment le controversé Tzimis Panoussis. Fondateur et leader des Mousikes Taxiarhies (les brigades musicales), le barbu rondouillet a introduit la satire politique dans le rock et a toujours eu maille à partir avec la censure grecque. Il fut aussi condamné pour avoir remplacé la croix du drapeau national par une faucille et un marteau et s’en prend assez régulièrement à l’église orthodoxe, ce qui reste toujours dangereux en Grèce. Ces dernières années, il s’en est souvent pris aux juifs dans son soutien aux palestiniens. Mais cet Aristophane du mauvais goût a cassé sa pipe en 2018. Il est bien entendu normal que dans ces conditions, ce Dracula d’Exarcheia tienne plus du Rocky horror picture show ou de Frankenstein (Dracula veut y créer le groupe de rock parfait!) que de Dracula mais qu’importe ! Le jeu volontaiment amateur, la virulence de textes n’hésitant pas à stigmatiser l’impotence du parti communiste grec, la bourgeoisie, le politiquement correct et même l’anarchisme et les nombreuses références, l’utilisation de symboles nationaux pour les tourner en ridicule et en renverser les valeurs en font dès lors un brûlot contre la politique des socialistes grecs (et leur soleil attendu pour réchauffer les grecs dans ce film de et pour noctambules), mais aussi une parodie du cinéma d’Angelopoulos. Le scénario se veut volontairement mauvais, le jeu outrancier, dans l’esprit camp du début des années 80. La mise en scène valorise par contre l’esthétique de l’underground grec alors développé dans le quartier d’Exarcheia pour une vraie création collective. Zervos est alors proche des positions du Nikolaidis de Tendre gang et de sa critique de l’abandon de la transformation de la société grecque par les socialiste, comme de l’émergence d’un nouveau fascisme mondial. Un travail sur le cinéma de Zervos serait vivement recommandé !
Dans les années 80, Tonia Marketaki donne à son tour dans le film historique, Le prix de l’amour (1984) qui se voit tout de même contaminé par un rituel caravalesque pour une belle séquence qui convoque la vie et la fête populaire. Mais la grande cinéaste grecque de la période, c’est surtout Frieda Liappa. Cette ancienne critique de Synchronos kimimatographos (équivalent grec des Cahiers, particulièrement actif dans les années 70) disparue à l’âge de 46 ans est considérée en Grèce comme une des meilleures cinéastes du pays même si ses films sont peu visibles. On peut néanmoins apprécier le superbe Une mort tranquille (1986) dont le traitement visuel évoque Mauvais sang sorti à la même époque, en plus intime, symbolique et sensuel. Un film secret, irrésisiblement attiré par la mort, envoûtant mais qui ne slivre jamais complètement.
Enfin, une dernière personnalité notable, Dimos Avdeliodis, jeune cinéaste originaire de l’île de Chios, repéré dès son premier court-métrage et qui se distingue avec L’arbre qu’on blessait (1986), tourné dans son île natale et qui impose un ton et un style atypique. Travaillant avec des acteurs amateurs, il semble épouser la naïveté de la fable, mais ça n’est qu’une apparence tant son cinéma est habité de souvenirs, de désirs et surtout de vie, non loin du Kiarostami de Où est la maison de mon ami ?. Mais c’est justement par la liberté qu’il prend avec le langage cinématographique, se refusant à suivre une ligne prédéterminée pour raconter et accoucher d’une oeuvre au plus près des palpitations de son personnage : ni totalement naturaliste, ni théorique, mais originale et pleine de trouvailles (de scories?) et s’imposant comme l’un des films sur l’enfance les plus entêtants de la décennie. Ses films suivants confirment cette approche non-conformiste de cet ex étudiant en philosophie, décidément plus intéressé par le burlesque, la farce et la culture populaire que par le cinéma pour lui-même. Et même en devenant plus professionnel, il reste de très belles scènes dans Les 4 saisons de la loi (1999) avec son garde champêtre amoureux, ses partie de chasse et ses envolées lyriques travaillant sur l’opposition entre la grande culture occidentale (Les 4 saisons de Vivaldi) et culture locale populaire (le rebetiko toujours). Son unique film tourné à l’extérieur, Niké de Samothrace (1990) vaut bien Kaurismaki avec ses chorégraphies décalées. Il s’y paie le luxe de faire chanter Stavros Tornès en pope et contient sa dose de réalisme magique. Avdeliodis s’est ensuite entièrement consacré au théâtre, notamment au Karaghiosis dont une fois encore, la forme narrative peut expliquer la manière de monter du cinéaste.
L’ombre de la crise
Les années 90 amènent une sérieuse crise du renouvellement. Tant que les auteurs sus mentionnés continuent de produire, le cinéma grec fait illusion. On pourrait citer aussi quelques vieux briscards encore en forme (Koundouros et l’étrange parabole Les photographes, 1998), un post apo unique en son genre) au gentil film pour enfants Les dauphins du golfe d’Ambracie (1993) de Dinos Dimopulos) ou qui feraient bien de raccrocher (voir la perte dégressive de budget et d’ambitions dramatique chez Stravros Tsiolis).
Avec l’arrivée des grecs d’Albanie, le thème de l’immigration s’invite dans le cinéma grec et ne le quittera plus. Ils viennent de la neige de Sotiris Goritsas est sans doute le plus connu, il y en aura beaucoup d’autres. Le meilleur est peut-être Hostage (2005) de Constantinos Giannaris, récit au plus près de la prise d’un bus en otage par un jeune albanais désespéré d’après un fait divers qui a marqué la Grèce. Ayant vécu de nombreuses années en Angleterre (Caught looking, 1991, parangon du court queer), Giannaris est sans doute la personnalité la plus forte révélée dans les années 90, avec notamment une majorité de films autour de l’homosexualité. La pâte de Gus Van Sant et du cinéma indépendant est prégnante (le sublime petit frère de Mala noche, North of vortex en 1991). A place in the sun (1994) témoigne d’une vraie fascination du cinéaste pour une société grecque métissée découverte à son retour de Londres à travers la sensualité de tous ces jeunes migrants des balkans. Sa love story se partage entre séquences intimes et branchées et trip urbains arty dans un langage sans doute influencé mais néanmoins personnel. Mais un film comme Garçon d’Athènes (1998) livre une vision sensible, vivante, de la prostitution des jeunes pontiques (russes d’origines grecques revenus il y a peu) dans la capitale. Le film pointe la différence entre la loi finançant le retour des grecs de la diaspora et la situation sur place, notamment l’absence d’accueil dans les banlieues défavorisées. Puis 15 août (2001) met en scène 4 récits parallèles et est peut-être sa plus belle mise en scène. L’éveil du printemps (2015) paraît moins ambieux. On est hélas sans nouvelles depuis.
Nikos Kornilios a justement étudié avec Xenakis. Compositeur, il est aussi metteur en scène de théâtre et de retour en Grèce au début des années 90, il se lance avec la même ferveur dans le cinéma. Equinox (1991) détient par contre un des records de la moindre fréquentation de tout le cinéma grec. Desert sky (1997) est un beau film post Kanellis en noir et blanc, autrement dit un post apo antonionien presque muet. Changement esthtétique radical, quoiqu’encore l’espace reste celui du Nouveau cinéma grec, avec le teen movie Le monde commence chaque jour (2002) bien accueilli dans les festivals internationaux. Le virage se poursuit vers un hyperréalisme qui alterne scènes de proximité avec les personnages et grands espaces déserts ou anonymes (11 rencontres avec mon père, 2012). Il aimait filmer les femmes, il s’engage avec 60 d’entre elles dans l’aventure documentaire et militante de Matriarchy (2014). The cypress deep down (2015) radicalise son style. On a quand même le sentiment que son cinéma n’a pas reçu l’attention qu’il méritait.
A mentionner l’incursion dans la fiction de l’excellent documentariste (Mediterranen stories, 2001) Stellios Charalampopoulos avec Hades (1996) où une enquête façon Nouveau cinéma débouche là encore sur le thème albanais. Par la suite, les biopics sur la peinture et le film historique seront ses domaines de prédilection.
Le biopic était un genre fort dans les années 80, il devient académique avec Yannis Smaragdis et Cavafy (1996) et aussi lourd qu’international pour El Greco, les ténèbres contre la lumière (2007). Dieu aime le caviar (2012) ? Smaragdis, Catherine deneuve, la télé grecque et les castings « évasion fiscale » aussi. Nous pas vraiment. Quant à Kazantsakis (2017)… Soyons clairs, Smaragdis est ce qui est arrivé de pire à la Grèce avec la Troïka ! Ce qui guette l’audiovisuel quand la télévision digère le cinéma. On sera à peine plus cléments avec Nikos Grammatikos dans une toute autre (absence d’) esthétique, on peut à la rigueur s’oublier devant Apontes (1996) sorte de vitelloni locaux qui n’ont pas inventé la poudre. Le reste…
Enfin, niveau comédie, à Alexis Kardaras (I listeia, 1999), on préfèrera Renos Haralambidis et le minimalisme de No budget story (1997) de meilleur goût et qui marche sur les plates-bandes de Ça tourne à Manhattan tourné deux ans plus tôt mais pour mieux y retrouver l’héritage de Jarmusch, se taillant en plus au fil du temps un petit succès populaire, chose rare dans le cinéma national de l’époque. Son héros, cinéaste raté et vrai galérien de la vie comme de l’amour, ne perd jamais une certaine élégance et évoque un Nicolas Cage jeune. Au delà des références à l’histoire du cinéma grec et des plans « mode », l’arrière plan social est juste et laisse venir doucement mais sûrement la crise économique et le sentiment d’abandon. Avec au coeur du récit sa mise en abyme, la mise en scène est assez sophistiquée pour rester agréable, fluide mais aussi inventive. Mais les temps changent et le public grec va préférer faire un triomphe aux comédie du duo Thanasis Papathanasiou et Michalis Roppas avec tout d’abord Safe sex (1999), Strictement adapté (2004) et Larmes bénies (2001), les deux premières tournant autour du sexe, on n’efface pas quinze ans de surproduction érotique aussi facilement ! Les scénaristes-réalisateurs y reprennent les recettes de la satire, tradition nationale s’il en est. Mais l’écriture est vive et les scénaristes ont pensé à relier les fils narratifs de belle façon d’où un raz de marée en salles. La mise en scène traîne un peu mais ils vont vite pallier à cela dès leur comédie musicale suivante qui se paie le luxe de parodier tout le répertoire grec en la matière dans un art du vintage consommé. Un changement de registre en 2003 (Oxygono) puis on se refait la main sur une bonne rivalité entre sex shops, assortis de décors et costumes aussi kitchs que possible pour Strictement adapté (2008). On tient avec ce duo l’équivalent de nos Ducastel et Martineau. Et ils frisent le haut du panier en comparaison de la médiocrité cinématographique du reste dont l’énorme succès de Île (Christos Dimas, 2009) qui flatte l’esprit grec, ce qui lui vaudra inévitablement une suite ou sur le bon vieux football, L’héritière (2009) de Panagiotis Fafoutis.
Philosophie de comptoir
On serait tentés d’ajouter le succès du plus roublard 100 % grec (Filippos Tsotsis, 2009), coécrit avec Kardaras et qui teinte sa satire un poil télévisuelle d’un fond tragique beaucoup plus dépressif. Le thème : la manie grecque de haïr et de rejeter les étrangers. En 2009, ils en sont encore à pourrir les « albanais », ces grecs d’Albanie à qui le gouvernement grec a prédit un avenir radieux en rentrant au pays. C’est donc l’histoire de quatre veaux de quartiers, occupés à glander devant leur magasin athénien toute la sainte journée rythmée par ses rituels incunables ( de même que les règles de l’Académie de Platon auquel se réfère le titre grec du film), pour commenter l’invasion du pays par la société multiculturelle. Ce dispositif un peu à mi chemin entre Plus belle la vie, Robert Guédiguian et Kaurismaki (une propension à l’absurde légèrement chorégraphié et au minimalisme) fait de la place une agora de la société grecque actuelle. La construction qu’on leur a plantée au milieu en hommage à la société multi-culturelle, fait d’abord tâche. Sauf qu’à la fin, on ne peut pas dire que ça ait de la gueule, même si symboliquement elle devient le lieu de réconciliation entre un chien et un albanais. Elle reste un concept un peu pourri qui peut passer, au mieux, pour du mépris pour les grecs en difficulté. On pourrait aussi se poser la question de la représentation du rapport de la Grèce au monde avec ici l’ouverture d’un magasin de mode italien tenu par des chinois, tellement nombreux et semblables qu’aucun grec ne parvient jamais à les compter. Sur ce fil, le film n’évite pas toujours la démagogie. Mais son coeur est bien une petite vieille qui retrouve la raison, la joie de vivre en même temps que son histoire et ses racines albanaises. Dommage que le récit n’utilise peut-être pas au mieux cet argument de départ, englué dans la même impuissance que ses protagonistes. Si le parti pris, vu et revu dans trente films grecs en vingt ans de repeindre son univers aux couleurs nationales est discutable, le film a une bonne idée : laisser faire le travail de réflexion au spectateur. Mais aussi d’autres moins pertinentes, comme cette propension à figer son constat sociologique légèrement caricatural. Il se reflète alors dans le regard blasé de son loser de héros (l’excellent Antonis Kafetzopoulos). Reste que le tableau est effrayant, à la veille l’arrivée de la vague migratoire que la Grèce a connu par la suite. Son minimalisme et son sens de l’absurde ont visiblement inluencé Lanthimos pour Alps qui a lui échoué à créer ce type de saynètes, déconnectées de personnages de chair et d’os. Le film suivant de Tsotsis, Unfair world (2011) ouvre sa mise en scène mais s’aligne hélas sur les films grecs du moment.
L’onirisme est peu présent dans le cinéma contemporain mais on peut citer la comédie fantastique Extended play (2006) où un homme jaloux meurt dans un accident mais se voit accorder cinq minutes d’existence supplémentaires. Le résultat est encore un peu timide. Mais en 2009, ce même Giannis Xhantopoulos réussit une comédie plus débridée autour d’un kidnapping, Ola tha pane kala, qui témoigne d’une ambition visuelle et cinématographique devenue rare en Grèce. Mais depuis, on perd sa trace au profit d’un footballeur homonyme.
Un ton qui nous conduit au cinéaste le plus délirant de la période, haut la main, Panos Koutras. Au moins, il y a chez lui l’ambition d‘exploser les frontières. D’ailleurs comme les cinéastes qui suivent, il a étudié et vécu à Londres et Paris. Elevé au 16mm, il en a gardé le goût du bricolage visuel et une vraie culture de l’image qui débouche sur une esthétique camp et foutraque dans L’attaque de la moussaka géante (1999) qui prouve au moment du changement de millénaire qu’il peut encore y avoir une vie en Grèce après la mort culturelle. Phénomène presque malgré lui, objet mode donc victime du sarcasme, il est plus à voir sous l’angle du cinéma queer que comme réelle remake de nanar, en l’occurence du Danger planétaire de Irvin Yeaworth. Malin comme un singe, Koutras sait que les grecs ne sont pas encore mûrs pour accepter une culture queer débridée, mais les thèmes et les coloris sont bien là. De quoi en faire un film culte pour de très bonnes raisons. Cinéaste en formation et auteur inégal, Panos Koutras s’égare un peu avec La vie véritable (2004), mais délivre ensuite un film phare de son époque, hommage à Cacoyannis et sublime variation dans Strella (2009), le plus beau film jamais réalisé sur un personnage trans. Filmé à fleur de peau et pourtant avec un soucis permament de la composition, Koutras venge l’amateur de cinéma grec de deux décennies de grisaille et de torture mentale constante. La comparaison avec Almodovar serait presque insultante, tant le film est pris dans la vie athénienne et plus encore dans les codes du mélodrame grec. Et quel plaisir à filmer les acteurs… Le kitsch devenant sa grande affaire, le seul reproche qu’on adressera à Koutras, c’est qu’il n’a pas plus besoin d’écureuils que de lapins géants dans le suivant, Xenia (2014), pour réveiller le public, quoi que si ça peut servir de faire avaler des lapins aux grecs plutôt que des lanternes pour les éclairer un peu sur la beauté de la communauté LGBT locale, on veut bien en supporter d’avantage. Un cinéaste à suivre de près donc…
Car sinon, qu’il s’agisse d’enfance ou d’adolescence, le cinéma grec est bien timide, par exemple avec le court-métrage de Theodoris Papadoulakis (Pilala, 2004) ou la bluette de Kostas Charalampous (Love at 16, 2004) bien trop classiques, de même que les jeunes du Fils du gardien (2006) de Dimitri Koutsiabasakos sont peu marquants en dépit d’un bon sens de la mise en scène et d’une bonne intrigue ancrée dans la ruralité. Encore plus classique, le film de Vardis Marinakis, Le pré obscur (2009) présenté à Montpellier, sur les amours d’une novice et d’un jeune janissaire blessé et recueilli dans un couvent orthodoxe du 17ème. Pas mal pour un premier film mais Zizotek (2019) a l’air plus ambitieux et personnel. On ne sait pas trop quoi penser de Laya Yourgou, ni du chouchou des festivals Spiros Stathoulopoulos, tant après son improbable film colombien en plan séquence unique (PVC-1, 2007) et racoleur, Meteora (2012) nous rejouait le film de Marinakis en plus orthodoxe et contemplatif. Son utilisation de séquences animées post Mazomenos paraît un peu gratuite, même si elles ont une vraie puissance graphique. Il en est de même de son iconographie religieuse, de la minéralité de ses paysages sublimement photographiés, mais il reste qu’en dehors de la part charnelle de cette romance impossible, ce qui limite la portée du film, c’est l’absence même de spiritualité et une approche cérébrale plus que poétique. Stathoulopoulos semble fasciné par le folklore orthodoxe qu’il sublime depuis son détachement. Il reste qu’on tient là une des œuvres grecques les plus importantes de la période. Le cinéaste est malgré tout reparti sur des sujets à l’étranger et des coproductions internationales.
Après avoir tourné aux Etas-Unis une dystopie onirique en vidéo qui mélangeait couleur et noir et blanc et qu’on paierait cher pour voir sur la seule foi de son trailer et d’un prix à Houston (The dream factory, 1990), Tassos Boulmetis est bien vite rentré dans le rang pour comettre Un ciel épicé en 2003, film d’une laideur visuelle insigne qui a triomphé dans un grand nombre de festivals. Mythopathy (2016) et son bizarroïde docufiction consacré à une équipe de basket, 1968 (2018) semblent confirmer une tendance à la boursouflure au service d’un opportunisme naïf.
Le cinéma grec contemporain est pourtant peu porté sur la gaieté, en témoigne le Réparation (2007) de Thanos Thanastopoulos, aperçu lui aussi au Cinemed (un type sort de prison et erre dans Athènes filmée en bleu et blanc…). La fille en 2012 n’a pas l’air plus gai, mais paraît plus attirant en termes de mise en scène. Mais c’est La dernière plage (2016), documentaire tourné à Trieste qui lui apporte paradoxalement une reconnaissance internationale.
Dans le genre efficace, Georgis Grigorakis vient de triompher dans les festivals avec Digger (2020), une vague fable écologique doublée d’un conflit de génération père-fils. Encore un portrait d’une Grèce meurtrie mais très correctement évoquée et dont la fin sauve le morceau, injectant in extremis un peu de symbolisme dans un ensemble beaucoup trop réaliste. Son précédent court-métrage, 45 ° (2013), appartenait à cette vague de films tirant le portrait de grecs prêts à basculer dans la violence anti-migrants en pleine crise économique et sociale. Ce n’est pas le thème qui choque – on commence à y être habitués -, ni la caractérisation du personnage ou l’intrigue, ni même la peinture d’une quelconque grécité si prisée par d’autres de ses contemporains, mais bien la façon de représenter cette population du point de vue du personnage. Des intrus présents partout dans les plans comme des corps étrangers indifférents, parlant une langue inconnue et jamais connectés aux grecs. La banalisation de pareille vision misérabiliste et fataliste est triste. En contrechamp, le monteur Yannis Sakaridis a tourné Amerika square (2016), avec Makis Papadimitriou, acteur bien identifié à l’étranger, pour vivre cette nouvelle Grèce métissée de l’intérieur par l’entremise de beaux personnages mais aussi avec pas mal de maladresse.
Les héritiers du Nouveau cinéma survivent au moins grâce à Giorgos Georgopoulos (Tungsten, 2011) pour une oeuvre bien filmée mais sans grand fondement. Mais l’auteur semble errer d’un genre à l’autre comme ses personnages, sa seconde fiction dystopique sur un virus sexuellement transmissible mais mortel pour les femmes, lorgnant visiblement vers la vague actuelle (Not to Be Unpleasant, But We Need to Have a Serious Talk, 2019).
Sur le très en vue, Yannis Economides, dont on se demande bien comment la mise en scène plombante et télévisuelle (voir même amateure) de Matchbox (2002) sur l’explosion de l’intouchable famille grecque a pu rencontrer un écho en Grèce (il rafle à chaque film le prix des critiques!) et à l’étranger (Cannes). Il faut attendre Knifer (2010, il a reçu plus de 7 prix) et d’incroyables images en noir et blanc et quelques trouées de couleur pour croire à Economides comme l’héritier du grand cinéma grec. Stratos (2014), portrait d’un mafieux atypique voit enfin les extérieurs grecs entrer dans le champ. Dans son dernier film, cet environnement social et dramatique difficile est tempéré par la romance (Ballade pour un coeur brisé, 2020). On va attendre la suite pour statuer…
Stellios Kammitsis s’essaie au look indépendant avec Jerks (2011), épopée nocturne de trois skaters à Exarcheia. Mais son nouveau film se situe lui hors des frontières. C’est toujours mieux que les films de Karlos Zonaras Pedro Noula (2016) ou Big hit (2010) qui peinent à convaincre.
Les féroces
Parfois, amateurisme et manque de moyens ne peuvent retenir l’inspiration. Il faut saluer le vrai talent d’Angelos Frantzis dont le road trip rural In the woods (2010) tourne selon l’auteur au conte de fée punk existentiel. Assez mutique, son trio de jeunes amoureux à la Jules et Jim, est filmé de manière tout à fait élégiaque avec une caméra pourrie mais un vrai sens du cadre et de la couleur. Cette crudité tempérée par la buée du flash back ou les flous distantiels dont le cinéaste joue à l’excès, sans oublier quelques effets sous-marins des plus osés comme cette fellation plein cadre, rend les scènes sexuelles plus proches encore, presque dérangeantes. Le triolisme amoureux final, sauvage et syncopé d’ellipses, saucissoné par le cadre dans un corps à corps éreintant, montre la passion, voire la folie amoureuse quand le scénario ne conclue heureusement pas sur un échec. Les expérimentations sont légion, via la saturation des couleurs, le filmage instinctif et un montage son très original où le réel quitte l’image ou au besoin, la surinvestit. Il faut aussi parler de l’interprétation sans faille de son trio en transe. On retrouvera Katia Goulioni chez le cinéaste, notamment dans Eftyhia (2019), biopic bien sage d’une célèbre chanteuse grecque qui nous fait désepérer d’Angelos Frantzis et chérir d’autant plus l’OVNI In the woods.
Par contre, ce qui dérange dans le cinéma de Stavros Tzitzis depuis L’amour est un éléphant (2000), c’est son minimalisme triste qui repose sur une assez grande pauverté visuelle et sonore et son goût un peu trivial pour la nudité 45m2 (2010), avec un peu plus de sophistication mais guère plus d’emballement dans Save me (2001). Autre cinéaste problématique, Constantatos Michalis et son Luton (2013) au viol final cathartique et un peu vulgaire. Il a d’ailleurs confirmé les craintes avec All the pretty little horses (2020), home invasion paranoïaque, bourgeois et presque malsain. Ayant vécu entre Athènes, Paris et Rio, la carrière internationale de Dennis Iliadis (The last house on the left, remake surfait de Craven) a fait étape en Grèce à ses débuts pour le putassier Hardcore (2004), film cru mais aussi complaisant sur les galères de deux heunes filles dans les bordels athéniens. Comme l’indique la scène initiale, l’image touristique du Parthénon s’effrite autant qu’il s’écroule pour laisser place à une réalité sordide vécue par deux jeunes filles à l’allure juvénile, et ce depuis la première scène de viol, insupportable et à la mise en scène discutable. Le racolage tient d’ailleurs lieu de mise en scène stylée. Mais on peut toujours couler plus loin, comme tente de le prouver Alexis Avranas, quand même primé à Venise car il a apparemment su exciter les sens et la pitié des italiens avec son Miss Violence (2013), peut-être aussi parce qu’il venait après un Without (2008) couvert de lauriers à Thessalonique et avant Love me not (2017) si on occulte un détour glauque aux Etats-Unis. Comme tous les précédents, ce film grec fait commerce du corps de ses interprètes sous couvert de dénonciation. Mais que la colère de ces jeunes cinéastes soit compréhensible et que cette réalité sociale existe ne change rien au problème. L’obscénité cinématographique a ses limites. D’ailleurs Avranas connaît bien les limites de la monstration, sauf que dans la lignée d’un Haneke, il parvient sans peine à prouver que la hideur morale peut être plus rebutante que sa représentation même. Le problème est donc bien de mise en scène et de point de vue, dès le premier travelling vertical qui veut nous emmener aux enfers. Faire souffrir les personnages, surtout les enfants, les spectateurs subissant le minimalisme glauque grec encore une fois, figer ses représentations dans un cadre-prison et ne libérer avec les mouvements de la caméra que les pulsions voyeuristes et si esthétisantes et pour finir, racoler le public mondial en marchant allègrement sur l’absurde de la greek weird wave, voilà qui est juste affligeant. Avranas voulait exprimer une colère à froid, il ne fait que réveiller le pire du populisme, en jouant sur un suspense immoral et des non-dits aussi lourds de sens que la dette de la Grèce.
On ne peut pourtant que le constater : la marchandisation des corps s’exprime dans tous les courants du cinéma grec, comme par exemple dans le thriller mou à photo laiteuse Tentations interdites (Nicholas Triandafyllidis, 2014) qui avec sa caméra caressante et son chic de pacotille ne fait guère illusion plus d’une heure. Le but reste le même : mettre en scène des femmes subissant des sévices sexuels, la fin restant plus morale et prévisible. Quant au Suntan (2016) d’Argiris Dimitropoulos, qu’il renverse la problématique pour faire des grecs la proie de touristes déchaînées, ça ne change rien au propos ni à l’ambiance aussi plombée que faussement ensoleillée. Disons que ça marche mieux que les comédies criminelles (Bank bang, 2008) et les skaters (Wasted youth, 2011). Monday (2020) semble poursuivre ce propos légèrement réactionnaire.
Qu’en est-il enfin de cette fameuse Greek weird wave, appelation inventée aux Etats-Unis pour qualifier les films du début du millénaire après l’avènement de Yorgos Lanthimos ? Son premier long-métrage, Kinetta (2005) a amené un nouveau style ssi on en croit les critiques grecs, « quelque chose d’extrême artistiquement et d’indéterminé au plan narratif » dans lequel les mouvements volontairement artificiels des corps créent quelque chose d’intéressant entre corps, personnages et espaces, un ton nouveau dans le cinéma grec. Lanthimos se rattache alors au Dogme 95 : absence de budget, intimité avec les acteurs, caméra mouvante. Il est bien difficile de reconnaître le style de son second long et on est peu convaincus par le film. C’est pourtant la même Athina Rachel Tsangari qui le produit.
Canine (2009) arrive opportunément pour donner un sens et un concept à cette vague de films déconstruisant le mythe de la famille grecque. Mais foin de réalisme, ici c’est l’asbsurde qui compte et l’arbitraire qui fixe les règles. L’aspect un peu bunuelien s’estompe vite devant ces licences ludiques mais peu convaincantes sur la longueur : des mots dont le sens a été modifié, volé par le pouvoir patriarcal, une représentation du monde réduite à la seule cellule, des rituels à la fois antédiluviens et contemporains dans le sens où la violence semble avoir intégré les coprs eux-mêmes, une tendance à étaler la sexualité, hygiénique et non amoureuse, jusque dans les jeux de langues des deux sœurs, une distanciation cérébrale et plus noire qu’il n’y paraît. Mais Lanthimos a purgé le film de ses éléments grecs et il fut perçu partout dans le monde comme une critique de Big brother. Pour le plus intéressant, il crée une nouvelle forme de théâtralité, de danse et de chorégraphie. Autrement dit, il décape la tradition grecque… Tous ces éléments ont fait de Canine un film culte pour amateurs de sensations nouvelles qui ont eu un peu vite fait de crier au génie comme la suite allait d’ailleurs le prouver. Avec Alps (2011), l’arbitraire règne et c’est le cinéma de Lanthimos qui devient système. Et montre aussi ses limites. Là encore les codes couleur n’échappent pas à la critique de la situation du pays où les apparences peinent à masquer la réalité. Mais le jeu sous toutes ses formes peut irriter au de là de la démarche chorégraphique originale de la française Ariane Labed, conjointe du réalisateur. C’est plutôt dans l’univers et le rythme qu’on situera le problème. Tout est apprêté, bien à sa place comme dans un décor de Kaurismaki mais ici les êtres sont plus autistes que finlandais. À tel point que la greffe ne prend pas et le scénario reste lointain, un défait qui deviendra récurrent chez ce cinéaste cérébral. L’univers visuel peut étonner (Mise à mort du cerf sacré) et même éblouir (l’ombre de Kubrick?), le scénario s’avérer malin (The lobster), il manque hélas toujours quelque chose (et cela ressort bien de ses courts-métrages). La favorite paraît alors à la fois moins original mais paradoxalement plus plaisant. Le cas Lanthimos demeure.
Ce weird qualifierait-il ce côté aussi personnel qu’autiste, ce minimalisme parfois frénétique ? Productrice des trois premiers films de Lanthimos, Athiná-Rachél Tsangári a débuté aux Etats-Unis, particulièrement à Austin (elle joue dans le Slacker de Linklater) et a affirmé une forte attirance pour l’absurde dès le court The slow business of going (2001). Sa première fiction Attenberg (2010) opère une variation sur les thèmes de Canine et trouve une approche plus personnelle, féminine aussi. En se centrant plus sur son duo de petites marguerites, elle permet d’échapper à l’enfermement qui reste néanmoins mental comme le montre l’utilisationde la musique d’Alan Vega et le paysage final très antonionien et crépusculaire (2010). Le court-métrage The capsule (2012) prouve que la cinéaste se cherche, quelque part entre spectacle vivant, animation et donc, la fameuse greek weird wave. Le jeu et la féminité en restent les ingrédients, la constante. Quelques effets naïfs font leur petit effet mais l’impression d’ensemble est plus frustrante. D’ailleurs, la cinéaste change radicalement de direction avec Chevalier (2015), pour un jeu viril, hilarant pour certains, plus ennuyeux en terme de cinéma pour les autres. Elle disparaît ensuite des radars.
Est généralement placé dans cette catégorie le L (2011) de Babis Makridis, écrit comme Chevalier avec le dramaturge Efthymis Filippou, sur le quotidien d’un homme vivant dans sa voiture. Bien qu’abusant du plan fixe, le film est bien mis en scène et inscrit son personnage au coeur du plan sans en jamais boucher l’horizon pour autant. Le quotidien est néanmoins brutal et minant et des saillies légèrement surréalisantes viennent perforer son ciel bas. Il est basé sur le décalage entre le jeu minimal de son acteur (Aris Servetalis) et les situations tragi-comiques où il est plongé. On ne criera pas au miracle.
Après dix ans de courts entre expérimentations et art contemporain, et bien que vivant en Hollande, l’ex étudiante de Leeds Janis Rafa rejoint le club des grecs chrorégraphes en tournant son premier long Kala Azar (2020) près d’Athènes. Une fois encore, le conceptuel prend le pas sur le narratif et cette œuvre est toute aussi peu loquace que les précédentes. Serait-ce finalement le mutisme ce trait le plus caractéristique de cette poignée d’auteurs ? Mutisme et minimalisme ? Mutisme, minimalisme mais chorégraphie On rajoute chez elle un lien particulier au paysage (elle parle de « chaotic, broken-down pieces of land ») assorti à des personnages entre l’homme et l’animal. Définitivement weird…
Cataplasme du réel
Le documentaire grec reste riche. C’est sant doute Evangelia Kranoti qui s’est le plus distinguée dans les festivals internationaux (elle a étudié en France au Fresnoy et à la Femis entre autres), dès son premier documentaire Exotica, erotica, etc. (2015) où durant quatre années elle a voyagé avec les marins de ports en ports. Elle confirme avec le sublime Obscuro barocco (2018) où elle suit un trans brésilien au Carnaval de Rio.
Mais c’est sans doute l’éloignement de son pays qui favorise la distance et l’ouverture sur le monde. Pour ce qui est de l’immersion dans la réalité grecque, il faut citer Des spectres hantent l’Europe (2016) de Niki Giannari et Maria Kourkouta sur la vie quotidienne dans le camp de migrants d’Idomeni à la frontière macédonienne, Prochain arrêt : utopia (2015) d’Apostolos Karakasis sur l’occupation d’une usine de Thessalonique, Park (2016) de Sofia Exarchou qui suit de jeunes skaters athéniens. Voilà pour le haut du panier.
Mais c’est plutôt le documentaire militant qui à la faveur de la crise s’est fait plus présent, plus ou moins bon avec les alter de Fascism INC, Debtocracy ou This is not a coup, plus classiquement militant avec le français Yannis Youlountas qui documente la solidarité de la poulation grecque en temps de crise dans Ne vivons plus comme des esclaves (2013), à la fois bourré de témoignages passionnants, mais aussi de tics ou défauts un peu irritants, puis Je lutte donc je suis (2015), également à la recherche d’une forme et enfin L’amour et la révolution (2018), heureusement plus sobre et assez émouvant. Les trois forment toutefois un ensemble assez déchirant sur la capacité de résistance des grecs. On espère que Youlountas ne s’arrête pas en si bon chemin et trouve la forme poétique qui correspondrait à ses alexandrins coquins.
Il faudrait parler de l’émouvant retour de Costa-Gavras qui a tourné à 86 ans un de ses meilleurs films depuis bien longtemps avec Adults in the room (2019) d’après Conversations entre adultes, les confessions du ministre grec des finances Yanis Varoufakis. Il y avait peu de thrillers financiers réussis jusqu’ici. Celui-ci est passionnant en plus d’être pédagogique, sans aprler de son esthétique européenne…
C’est d’ailleurs d’autres vieux briscards qui poussent les plus gros coups de gueule, Theodoros Marangos avec Je ne me tairai pas (2016) dénonce la politique du gouvernement dans un documentaire bien écrit et plus authentique que celui des jeunes. Enfin Fotos Lambrinos est toujours d’attaque et rend hommage aux militants communistes dans le film de montage La grande utopie (2017) avec un beau travail d’archive et un commentaire très personnel.
Finalement, il s’avère plutôt difficile de dénicher des films tracts ou pamphlets expérimentaux comme attendu. On peut voir Bearbeitung (2017, Vassilis Moralis) qui contient de beaux moments et le court de Vasilis Kekatos, soutenu par la fondation Onassis As you sleep the world empties (2020), qui s’il n’est pas le premier à essayer le film d’anticipation (sur le thème d’une contamination virale…) sait en tout cas tourner des plans et dénicher lieux adéquats pour en extraire l’esprit. C’est plutôt dans ces petites choses que dans les bêtes à concours qu’il faut voir la persistance de l’esprit grec, une philosophie de la vie qui débouche sur une vision esthétique du monde où tout ne fait toujours que recommencer.
Bibliographie :
–Le cinéma Grec (sous la direction de Michel Demopoulos, Ed Centre georges Pompidou 1995)
–Découverte du cinéma grec, Aglaé Mitropoulos, Seghers 1968)
–A history of greek cinema, Vrasidas Karalis (Continuum, 2012)
–Desmos, Le lien : regards sur le cinéma grec (2009)
–L’insatiable n°3, Spécial Nikos Nikolaïdis (2021)
–L’insatiable n°4, Violences sexuelles dans le cinéma grec (2021)
–Nikos Koundouros, a retrospective (Greek film center, 1998)
–Alexis Damianos, un poète à l’état pur (Festival international du film d’Amiens, 1999)
–Théo Angelopoulos, Michel Ciment et Hélène Tranchant (Ediligi, 1989)
–Jules Dassin, Jacques Siclier et Jacques Lévy (Edilig, 1986)
-Ecran 78- Ciném’action 1 : dix ans après mai 68… aspects du cinéma de contestation (1978)
-CinémAction N°10-11 : cinémas d’avant-garde (1980)
-L’Avant-scène cinéma n°164 : le voyage des comédiens (1975)
-Les textes de Michel Demopoulos pour le festival de La Rochelle